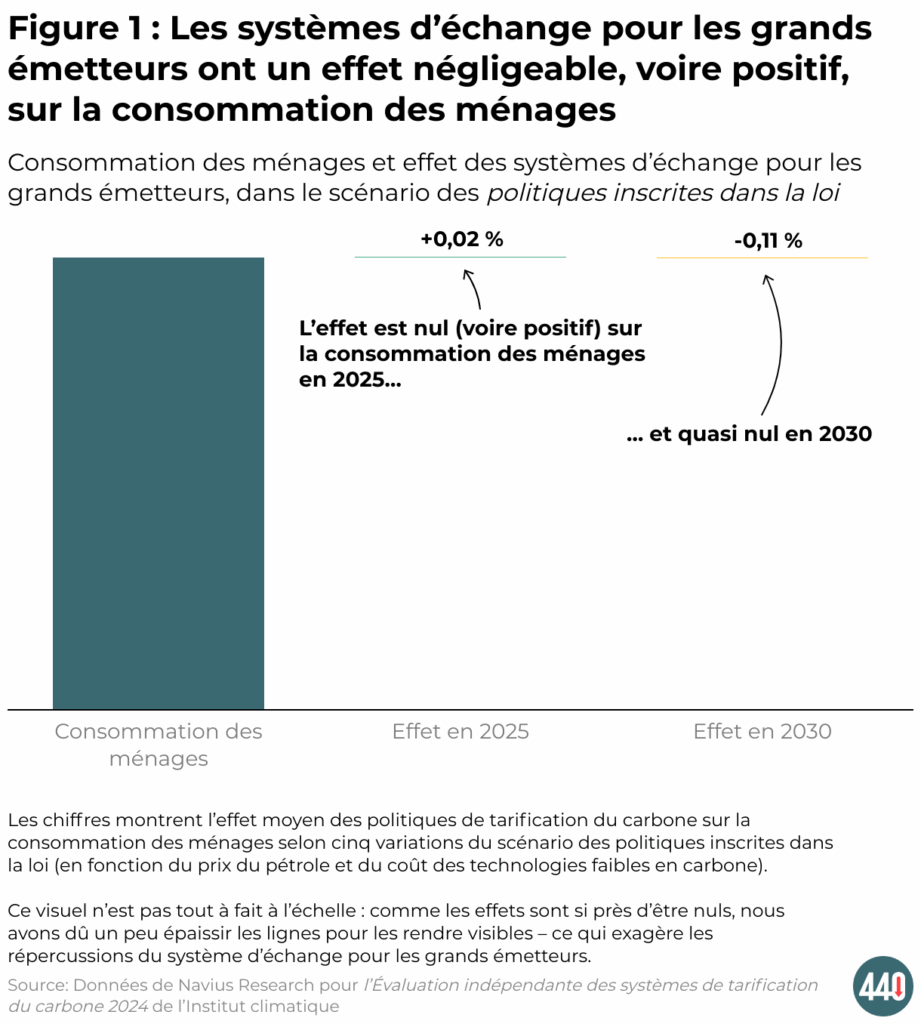Les logements malsains et de mauvaise qualité, ainsi que les coûts énergétiques élevés, sont parmi les défis les plus urgents auxquels sont confrontées les Autochtones au Canada. Cependant, les mesures actuelles visant à combler l’écart en fait de logement sont insuffisantes en raison de politiques cloisonnées et complexes qui privilégient les solutions à court terme au détriment de la résilience à long terme. Une nouvelle étude de l’Institut climatique du Canada et d’Indigenous Clean Energy recommande aux gouvernements d’adopter une nouvelle approche, afin de prioriser le développement de logements autochtones écoénergétiques, résistants aux menaces liées au climat et favorisant le bien-être général.
Le rapport conclut que combler l’écart de logement dans les communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis nécessite l’élaboration de politiques intelligentes et coordonnées, élaborées en partenariat avec les Autochtones. Il propose une perspective politique novatrice, celle de « logements écoénergétiques sains » qui peut s’appliquer tant aux nouvelles constructions qu’aux rénovations en profondeur dans les communautés autochtones. L’approche « Logements écoénergétiques sains » propose des recommandations stratégiques concrètes pour combler les lacunes quant au logement, réduire les factures d’énergie et améliorer la santé et le bien-être, tout en stimulant l’autodétermination des Autochtones et en favorisant la réconciliation.
Actuellement, les Autochtones sont près de trois fois plus susceptibles de vivre dans un logement nécessitant des réparations majeures que les Canadiens non autochtones. Les impacts des changements climatiques, comme les vagues de chaleur extrêmes, la fumée causée par les feux de forêt, l’érosion et les inondations, exacerbent les inégalités et exposent les Autochtones à des risques sanitaires accrus.
Afin de relever ces défis sous-jacents dans le contexte des changements climatiques, le nouveau rapport recommande aux gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux d’agir ensemble et rapidement pour déployer des logements écoénergétiques sains en coordonnant et en intégrant l’action gouvernementale, en élaborant conjointement des politiques et des programmes dirigés par et pour le leadership autochtone, en s’engageant dans des ententes d’investissement à long terme et des options de financement flexibles, en mesurant les coavantages d’un logement amélioré, y compris le bien-être, et en s’assurant que les programmes de financement sont accessibles et adaptés aux besoins de capacité des communautés.
Ensemble, ces solutions ouvrent la voie à une approche claire pour l’avenir. Grâce à la création de l’agence Maisons Canada de 13 milliards de dollars, les gouvernements ont la possibilité d’améliorer de manière importante le logement, le bien-être et la résistance aux changements climatiques des Autochtones. Bien que le succès exige également un financement flexible à long terme, les estimations suggèrent que chaque dollar investi dans le logement autochtone peut générer un retour sur investissement social d’environ 6,79 $, incluant des économies publiques estimées à 3,12 $.
CITATIONS
« Un logement est plus qu’un abri. C’est un lieu de rassemblement essentiel au bien-être physique, émotionnel, spirituel et culturel d’une famille. De nombreuses communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis mettent déjà en œuvre des projets de construction novateurs, résistants aux changements climatiques, écoénergétiques et favorisant le bien-être des gens. Il est nécessaire que tous les paliers de gouvernement éliminent les obstacles et élaborent conjointement une politique du logement conçue par et pour les peuples autochtones. »
— Maria Shallard, directrice de la Recherche autochtone, Institut climatique du Canada
« Ce rapport montre que l’amélioration de la politique de logement autochtone ne se limitera pas à offrir de meilleurs logements, elle permettra aussi de prévenir les visites à l’hôpital, de réduire les factures d’énergie, d’améliorer la santé mentale et de renforcer la résilience des communautés face aux impacts climatiques. En termes simples, s’ils adoptent rapidement ces changements de politiques, les gouvernements économiseront de l’argent et sauveront des vies. »
— Rick Smith, président, Institut climatique du Canada
« Les peuples et les communautés autochtones sont à l’avant-garde des efforts visant à accélérer la transition énergétique au Canada. Pourtant, le logement mérite beaucoup plus d’attention. Des logements sains sont essentiels pour améliorer la santé, lutter contre les changements climatiques, réduire les coûts énergétiques et améliorer le bien-être général de la communauté. Nous espérons que ce rapport incitera les décideurs et les institutions financières à reconnaître l’interdépendance de la santé, de l’énergie et du logement chez les Autochtones, et à encourager des solutions concertées qui répondent aux défis auxquels les communautés sont confrontées. »
— James Jenkins, directeur général, Indigenous Clean Energy
« Face à l’intensification des effets du changement climatique, qui touchent de manière disproportionnée les communautés autochtones, les considérations relatives à la résistance aux changements climatiques et à l’efficacité énergétique ne peuvent plus être traitées comme de simples ajouts aux questions liées au logement. Pour combler le déficit de logements, les gouvernements devront soutenir ces approches dans les nouvelles constructions et les rénovations, tout en améliorant la coordination des politiques avec les peuples autochtones. »
— Kayla Fayant, gestionnaire de projets d’efficacité énergétique, Indigenous Clean Energy
« Bâtir la force grâce à l’abri affirme la conviction de la Nation Métisse que les maisons écoénergétiques créent des environnements sains et sécuritaires qui sont essentiels au bien-être et à l’autodétermination de tous les peuples autochtones. En mettant de l’avant des solutions menées par la communauté, vous tracez une voie vers un mieux-être, une résilience et une équité durables. Le Ralliement national des Métis (RNM) appuie fermement les recommandations du rapport et félicite Indigenous Clean Energy, l’Institut climatique du Canada et l’équipe de recherche autochtone et Shared Value Solutions pour cette excellente réalisation. »
— Le Ralliement national des Métis (RNM)
« Un logement sain constitue la base de la santé et du bien-être, mais partout au Canada, les gens n’ont pas un accès égal à des logements sécuritaires. Ce rapport est un outil essentiel pour les décideurs politiques et un ajout important au corpus de recherche qui démontre les liens entre le logement, la santé, les droits des Autochtones et le climat. »
— Geri Blinick, RentSafe gestionnaire de projet, Partenariat canadien pour la santé des enfants et l’environnement
« Partout au Canada, un trop grand nombre d’enfants autochtones grandissent dans des foyers, des écoles et des milieux de garde qui nuisent à leur santé. Ce rapport fournit l’orientation politique dont les gouvernements ont besoin pour assurer aux enfants autochtones l’accès à un logement sécuritaire, sain et résilient face aux changements climatiques. Il propose une feuille de route inestimable pour faire progresser l’équité en santé et la justice en matière de logement, tout en honorant les engagements envers la réconciliation et en intégrant le savoir et le leadership autochtones. »
— Erica Phipps, directrice générale, Partenariat canadien pour la santé des enfants et l’environnement
« Ce rapport renforce le principe selon lequel le logement est un soin de santé et il plaide en faveur de solutions holistiques et fondées sur la culture. Il appuie la mission de l’AHMA de fournir une approche du logement « Par et pour les Autochtones ». Le rapport fournit la preuve que des investissements souples et à long terme dans des maisons écoénergétiques et résilientes face aux changements climatiques génèrent des avantages accessoires en matière de santé, sociaux et économiques. En présentant le logement comme un déterminant de la santé et en l’associant à la résilience climatique et à l’autodétermination, le rapport consolide le plaidoyer en faveur d’une réforme des politiques et de modèles de financement qui donnent la priorité aux voix, aux besoins et à la souveraineté autochtones. »
— Sara Fralin, gestionnaire de l’engagement et des services techniques, Aboriginal Housing Management Association (AHMA)
Ressources
Personnes-ressources
Claudine Brulé (heure de l’Est)
Cheffe, Communications et affaires extérieures
Institut climatique du Canada
(226) 212-9883
À propos de l’Institut climatique du Canada
L’Institut climatique du Canada est le principal organisme de recherche sur les politiques en matière de changements climatiques au Canada. Le volet Recherche autochtone de l’Institut élabore des politiques climatiques solides et respectueuses de l’autodétermination en privilégiant la recherche menée par les Autochtones. L’équipe poursuit ce travail en partenariat avec des organisations dirigées par des Autochtones, comme Indigenous Clean Energy, afin de valoriser l’expertise et les connaissances des Autochtones.
À propos d’Indigenous Clean Energy
Indigenous Clean Energy (ICE) est un organisme indépendant à but non lucratif qui favorise une prospérité vaste et durable en amplifiant le leadership des Premières Nations, des Inuits et des Métis dans le cadre de projets d’énergie propre. Grâce à un renforcement pratique et de haute qualité des capacités, de la formation professionnelle et du mentorat, ICE accompagne les Autochtones dans leur transition vers l’énergie propre, tout en promouvant une collaboration fructueuse avec les entreprises énergétiques, les services publics, les gouvernements, les sociétés de développement, les innovateurs en technologies propres, le milieu universitaire et les marchés de capitaux.