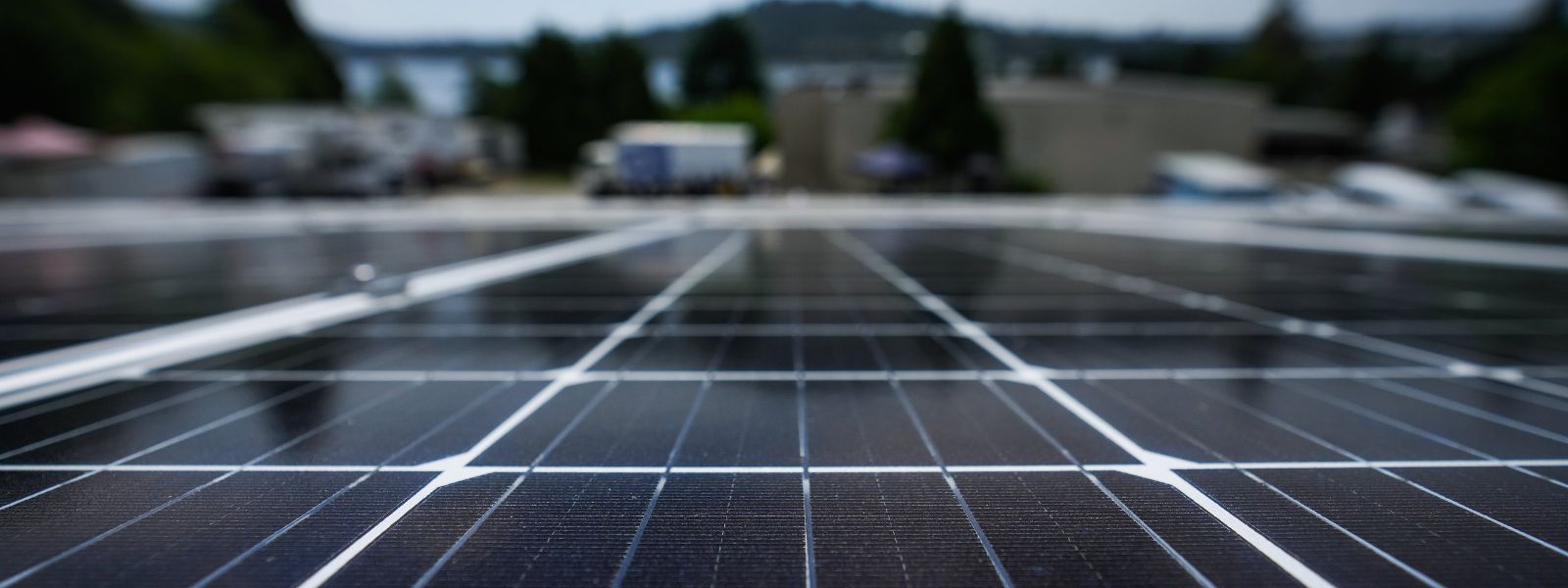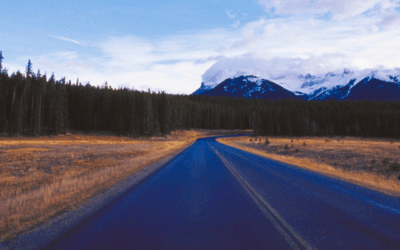L’écosystème énergétique mondial a entamé un virage radical, qui est généralement appelé à se poursuivre malgré les remous sur la scène politique aux États-Unis.
Avec l’électrification du transport et du chauffage, le boom de l’intelligence artificielle et l’adoption d’objectifs ambitieux de carboneutralité, la demande en électricité monte en flèche autour du monde, et il appert que les pays qui jouissent de ressources énergétiques propres, fiables et abondantes vont émerger en tant que leaders de l’économie moderne.
Le Canada, qui tire déjà environ 85 % de son électricité de sources non émettrices, a été particulièrement favorisé par la fortune; il ne lui reste qu’à bien jouer ses cartes. Mais avec la montée du protectionnisme, la menace de pénuries d’approvisionnement et l’impératif – non négociable! – d’abordabilité, il faudra que les gouvernements, particulièrement aux paliers provinciaux et territoriaux, fassent des choix politiques délibérés et proactifs.
Les tendances mondiales en investissement convergent vers l’énergie propre
Dans son rapport World Energy Outlook (Perspectives énergétiques mondiales) de 2024, l’Agence internationale de l’énergie fait état d’une hausse planétaire de la demande en électricité; selon les projections, celle-ci devrait grimper de 2,4 % à 3,5 % chaque année jusqu’en 2050, tandis que la demande pour les combustibles fossiles devrait atteindre son pic cette décennie. Le gros de la nouvelle demande en électricité provient des marchés émergents et des économies en développement, mais on s’attend aussi à ce que les économies avancées y contribuent.
Le Canada ne fait pas exception à la tendance mondiale. En Ontario, par exemple, la Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité a récemment accru de 15 % ses prévisions de la demande par rapport à l’année précédente, et projette maintenant une augmentation de 75 % à l’horizon 2050. Le Québec, la Colombie-Britannique, le Manitoba, Terre-Neuve et le Nouveau-Brunswick anticipent eux aussi une croissance considérable dans leurs propres réseaux au cours de la prochaine décennie.
Au Texas, l’État américain dont le réseau électrique grossit le plus (et le plus vite), on projette que la demande en électricité va doubler d’ici six ans à cause des centres de données et du minage de cryptomonnaie.
En parallèle de tout ceci, le secteur privé accélère le mouvement vers la carboneutralité. En effet, le nombre cumulatif d’entreprises qui ont pris des engagements et établi des cibles à cet effet est passé de 546 à 4 205 en trois ans.
À ce jour, près de 60 % des 2 000 sociétés en tête du palmarès des recettes annuelles se sont fixé de cibles de carboneutralité, et en date de 2023, les entreprises dotées d’objectifs fondés sur la science (science-based targets) représentaient 39 % de la capitalisation du marché boursier mondial.
Même si elles rencontrent dernièrement un certain vent contraire, les entreprises canadiennes n’ont pas laissé aller leurs cibles climatiques. Et sur la scène internationale, les capitaux mondiaux continuent de faire la part belle aux projets écologiques et aux biens et services sans émissions : les investissements en 2024 ont totalisé pour la première fois plus de deux billions de dollars, et ce malgré le ralentissement du taux de croissance. Même constat sur le marché étatsunien, où les investissements dans l’énergie propre ont atteint un sommet record dans le dernier trimestre de 2024.
Combinées, l’augmentation de la demande globale en électricité et la multiplication des promesses par les entreprises de réduire leurs émissions de portée 2 (qui normalement comprennent les émissions provenant de la production de l’électricité servant à alimenter leurs activités) créent une pression haussière sur la demande en énergie propre. Les géants Microsoft, Amazon et Google, par exemple, en nécessitent tellement pour alimenter leurs projets d’IA qu’ils pensent se tourner vers le nucléaire, qu’il s’agisse de nouvelles installations ou de centrales existantes, pour subvenir à leurs besoins futurs. Google s’est aussi adjoint une jeune société en géothermie améliorée, Fervo Energy, afin de mettre sur pied un projet pionnier au Nevada qui devrait assurer l’alimentation électrique de base de ses centres de données sans émettre de carbone.
L’électricité propre canadienne attire les investissements
Grâce à son électricité propre, le Canada jouit d’un avantage concurrentiel dans le marché en plein essor des biens et services carboneutres. Comme on l’a mentionné plus tôt, plus de 80 % de son électricité provient de sources non émettrices, comparativement à 40 % pour les États-Unis et à 28 % pour le Mexique. De plus, le pays arrive troisième parmi les 20 grands producteurs d’électricité non émettrice du monde.
Même que les gouvernements provinciaux vantent ce fait pour attirer les investissements étrangers et stimuler la production nationale de technologies émergentes. Pensons à l’Ontario, qui met explicitement de l’avant sa capacité à fournir de l’énergie propre à coût abordable pour courtiser les investisseurs, tout comme la Colombie-Britannique.
L’Ontario a misé sur la relative propreté de son système électrique afin de devenir une puissance dans la fabrication de véhicules électriques (VE) et de décrocher 44 milliards de dollars en nouveaux investissements uniquement pour ses usines de VE et de batteries. En 2024, Honda a annoncé qu’elle allait investir 15 milliards dans la province pour développer la chaîne de valeur intégrée des batteries pour véhicules électriques. Le groupe Volkswagen, lui, a lancé la construction d’une usine de fabrication de batteries pour VE – un projet de 7 milliards de dollars – qui constituera la plus grande usine de fabrication au Canada et générera une valeur d’environ 200 milliards de dollars.
Le Québec a aussi mis à profit sa capacité de production d’une hydroélectricité propre et faible pour s’attirer les investissements d’acteurs majeurs. En 2022, le vice-président de GM Canada annonçait la sélection de la province pour une nouvelle usine de matériaux allant dans les batteries en expliquant que le Québec avait été choisi pour ses nombreux avantages, parmi eux son électricité peu dispendieuse et faible en émissions de GES.
Le bouquet énergétique québécois fortement basé sur l’hydroélectricité est aussi attractif pour les entreprises en intelligence artificielle, qui ont besoin en tout temps d’un grand volume d’électricité. En 2023, Microsoft a investi 500 millions de dollars américains dans quatre nouveaux centres de données au Québec afin d’accroître la capacité de son infrastructure en IA et en infonuagique.
Les gouvernements du Canada investissent gros dans l’énergie propre
Le Canada devrait pouvoir continuer de s’afficher dans l’avenir comme une destination de choix pour l’investissement durable; il lui suffit de miser sur ses forces et de persévérer à étendre et à moderniser son secteur de l’électricité. Bien sûr, cela dépendra beaucoup des politiques à l’échelle des provinces, mais d’importants efforts s’observent déjà de ce côté.
Le tout dernier plan d’action d’Hydro-Québec prévoit l’injection de 185 milliards de dollars dans les 12 prochaines années pour grandement renforcer la capacité et la fiabilité du réseau afin de satisfaire à la demande en électricité, qui promet de redoubler d’ici 2050.
Anticipant un déficit entre l’offre et la demande énergétiques, BC Hydro a récemment conclu un accord d’achat d’énergie avec neuf projets éoliens, lesquels devraient accroître de 8 % son approvisionnement actuel en électricité (assez pour alimenter 500 000 foyers de plus).
Dans un même ordre d’idées, le gouvernement de l’Ontario vient de demander à la société d’exploitation du réseau d’électricité provinciale d’augmenter de 50 % l’objectif de sa prochaine ronde d’approvisionnement (de 5 000 à 7 500 mégawatts). D’autres provinces ont également fait de grands progrès pour décarboniser leur réseau électrique.
Plus d’électricité propre et intelligente : voilà comment le Canada rivalisera avec la concurrence tout en maintenant des coûts énergétiques abordables
Les provinces canadiennes gagnent à continuer de miser sur l’électricité propre pour attirer les projets et les investissements. Mais elles ne devraient pas s’asseoir sur leurs lauriers : si elles veulent conserver cet avantage concurrentiel, il leur faudra prioriser la modernisation et l’expansion stratégiques de leur réseau électrique.
À long terme, cela nécessitera une vraie volonté politique ainsi qu’un financement en ce sens de la part des organismes publics, en plus d’améliorations aux politiques afin de garantir que les investissements se matérialisent et que l’énergie demeure abordable pour tout le monde au pays.