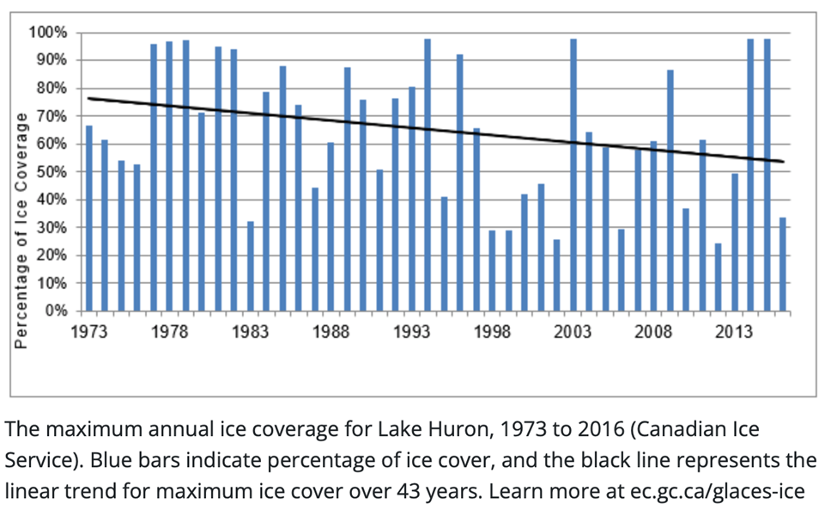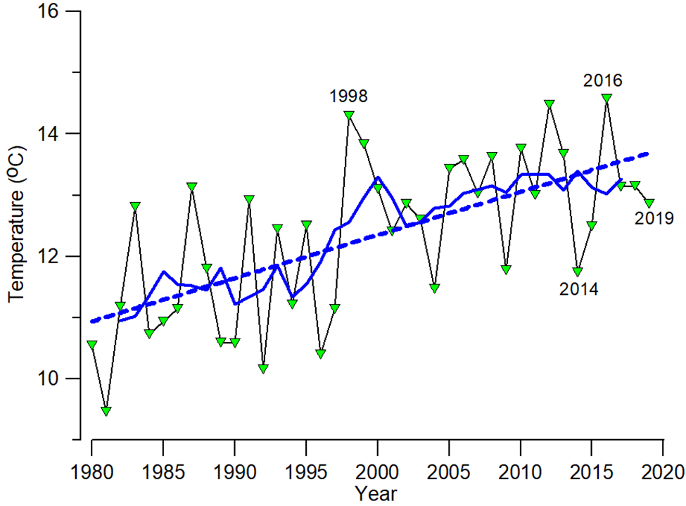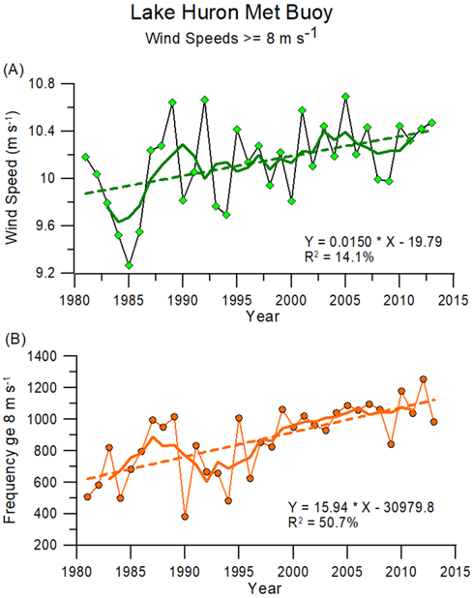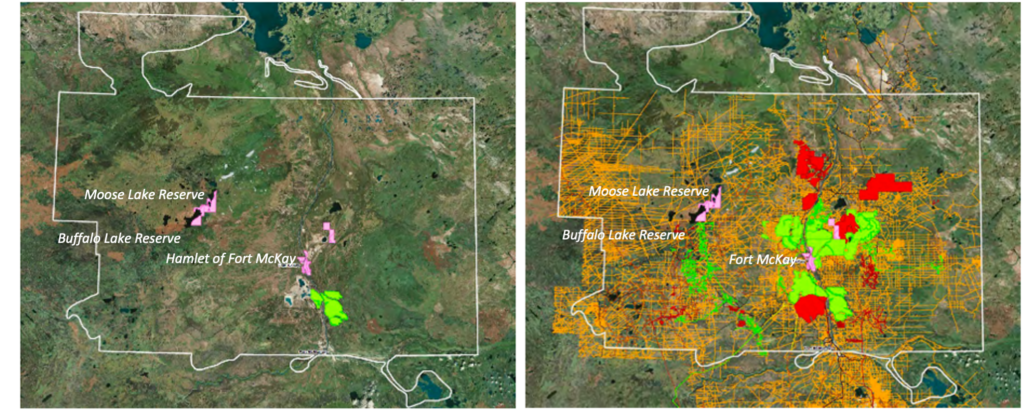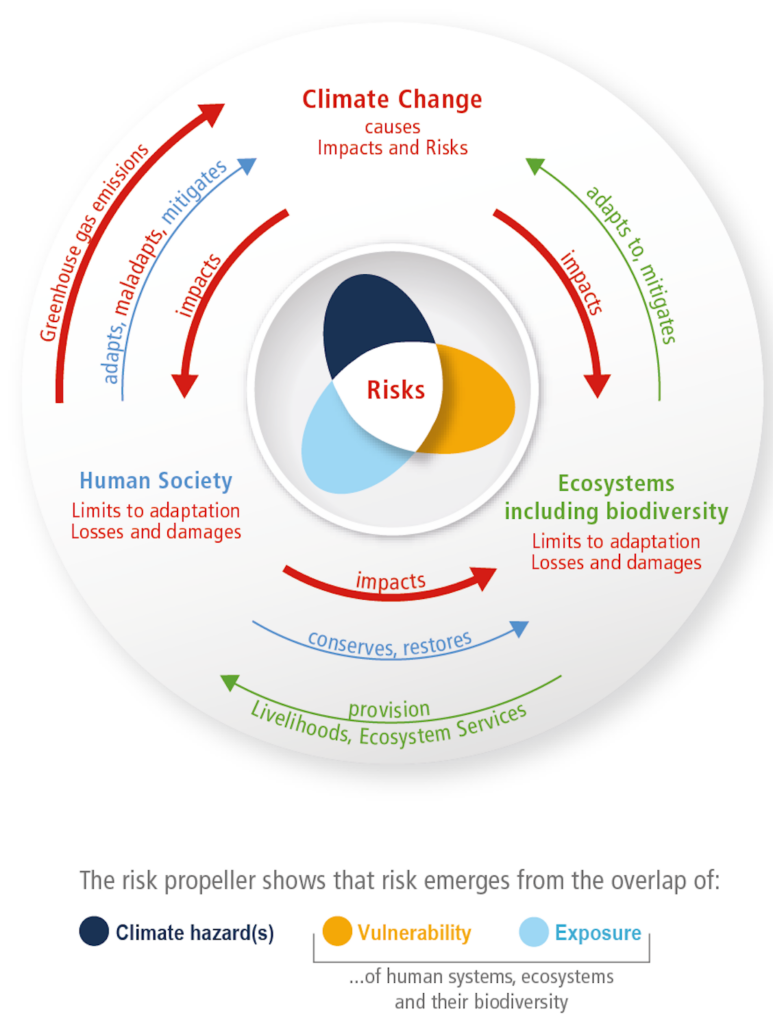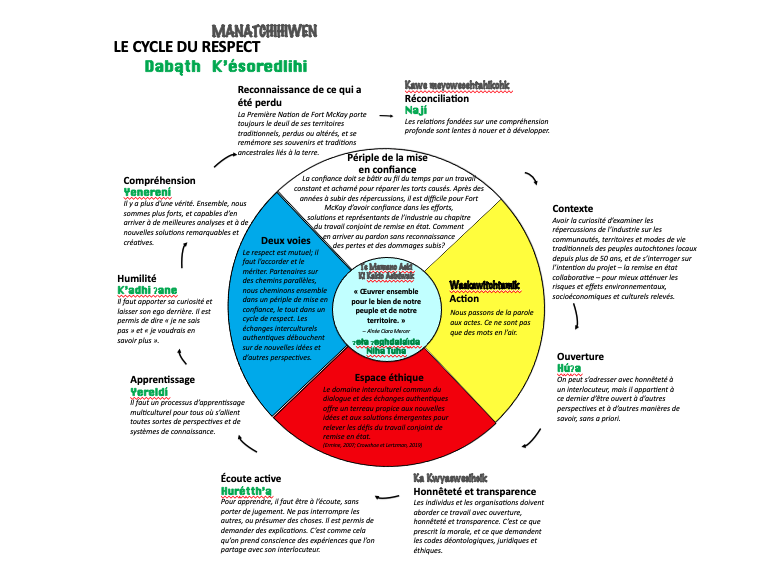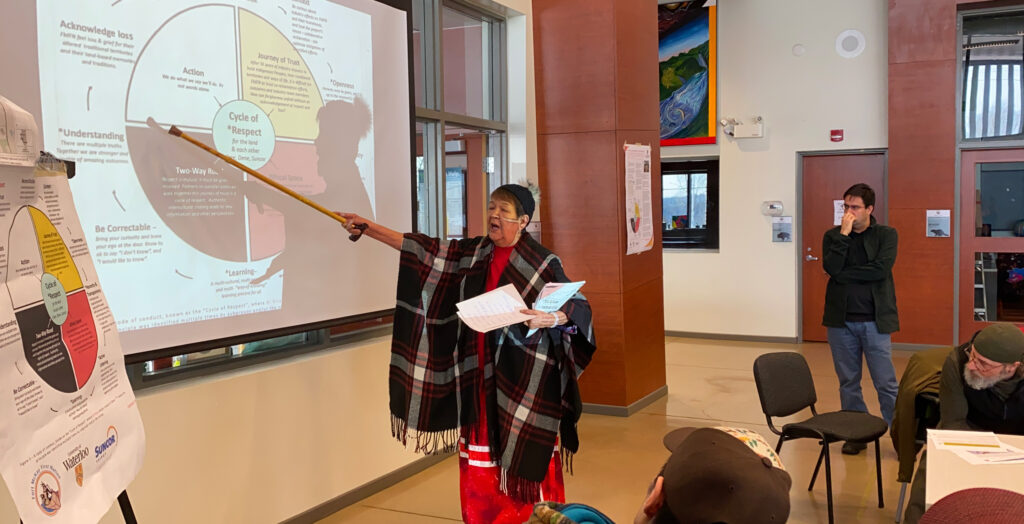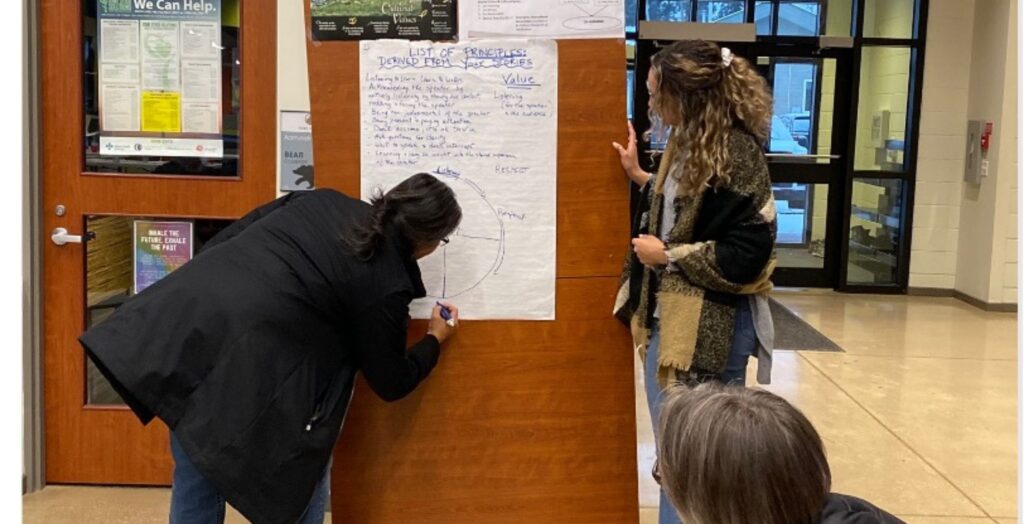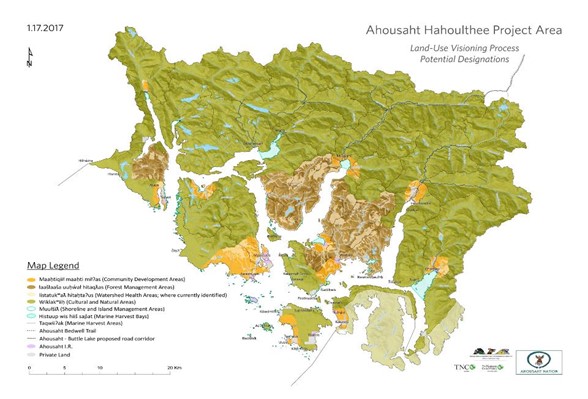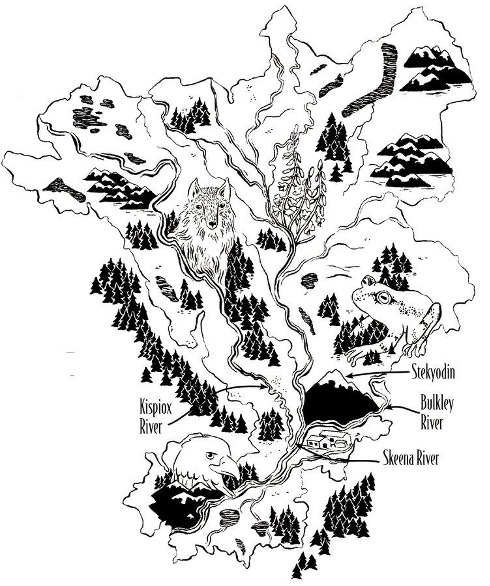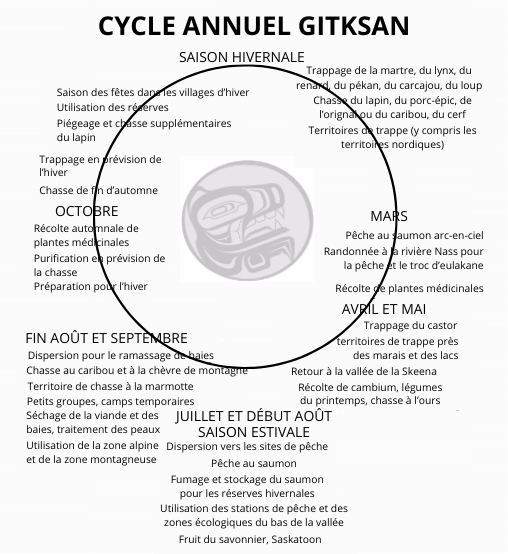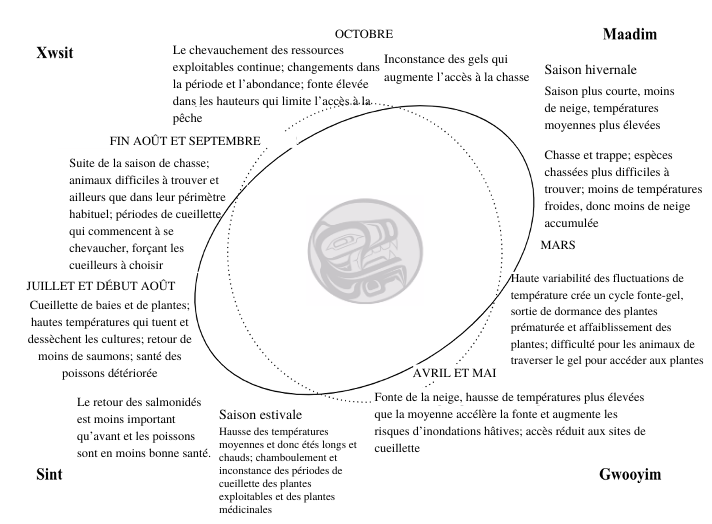L’Écosse est dotée d’une importante filière pétrolière et gazière dans la mer du Nord. Le secteur est un employeur majeur, contribuant à environ 5 % du PIB de l’Écosse (2019) et comptant pour environ 90 % de toute l’énergie primaire de l’État (2015) (gouvernement de l’Écosse, 2022c). Les objectifs écossais de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) sont parmi les plus ambitieux de toutes les économies avancées. En 2019, le gouvernement de l’Écosse a amorcé la planification d’une transition juste, et travaille maintenant à mettre en œuvre sa stratégie nationale de transformation économique, comprenant des plans particuliers pour les secteurs à fortes émissions. On s’attaque d’abord au secteur de l’énergie. L’Écosse devra réaliser des progrès rapides pour atteindre ses objectifs climatiques élevés et mener à bien une transition juste.
Contexte
En 2019, le Royaume-Uni est devenu la première économie majeure à se fixer un objectif contraignant de carboneutralité d’ici 2050. L’Écosse – dont le gouvernement régional est issu de la décentralisation des pouvoirs (dévolution) de Westminster, le siège du Parlement du Royaume-Uni – poursuit un objectif encore plus ambitieux : réduire ses émissions de GES de 75 % d’ici 2030 (par rapport au niveau de 1990) et atteindre la carboneutralité d’ici 2045. Ces cibles tiennent compte des principes de la transition juste. Le plan climatique écossais prévoit une transformation rapide dans toutes les sphères de l’économie et de la société, tout en « assurant un cheminement équitable et un avenir meilleur pour tous – peu importe où l’on vit, ce qu’on fait et qui l’on est » (gouvernement de l’Écosse, 2022b). Toutefois, une sortie du pétrole et du gaz n’est pas envisagée; l’Écosse est plutôt résolue à poursuivre l’exploration et la production en espérant que les investissements dans les énergies renouvelables et dans les technologies de captation, d’utilisation et de stockage du carbone (CUSC) entraînent une réduction des émissions du secteur.
L’Écosse n’est pas à sa première transition économique majeure. Dans les années 1980, la transition mal orchestrée du secteur du charbon a mené à de profondes inégalités qui ont perduré durant des décennies dans les régions touchées. Par ailleurs, depuis les années 1990, le secteur pétrolier de la mer du Nord connaît des déclins intermittents et le nombre d’emplois du pétrole et du gaz a chuté de presque 40 % au cours des cinq dernières années seulement (Oil and Gas UK, 2021), creusant encore davantage les inégalités. En 2017, un Partenariat de transition juste – une coalition de syndicats et d’ONG environnementales – s’est formé pour revendiquer une commission indépendante ayant le pouvoir légal, à longue échéance, de suivre l’application de la loi sur le climat du gouvernement et de veiller au respect des principes de la transition juste. En 2019, le gouvernement de l’Écosse a répondu à la demande en mettant sur pied une Commission de transition juste qui disposerait de deux ans pour émettre des recommandations « pratiques, accessibles et réalisables » aux ministres écossais sur l’application de ces principes. La Commission avait aussi comme mandat de voir à l’adéquation entre les objectifs climatiques et les principes de transition juste.
Au cours des deux années de son mandat, la Commission de transition juste a mobilisé le public et les intervenants importants lors de réunions, d’assemblées locales et de visites des lieux un peu partout en Écosse. Les discussions auxquelles ces événements ont donné lieu portaient sur l’ensemble de l’économie et de la société. En 2021, la Commission a soumis au gouvernement son rapport final, dans lequel elle formulait quatre recommandations principales :
- Conduire une transition vers la carboneutralité ordonnée et structurée qui génère des retombées et des occasions pour tous les habitants de l’Écosse.
- Faciliter la formation et l’acquisition des compétences dont les travailleurs auront besoin pour tirer parti de la transition vers la carboneutralité.
- Outiller et revigorer les collectivités et renforcer les économies locales.
- Promouvoir massivement les bienfaits de la lutte contre les changements climatiques; répartir la facture climatique selon la capacité financière de chacun (Commission de transition juste, 2021).
Le gouvernement a accepté en bloc les recommandations de la Commission et établira un Cadre national de planification de la transition juste pour organiser le passage à une économie carboneutre. Le Cadre de planification comprendra des plans détaillés pour certains secteurs. De plus, un poste de ministre subalterne – ministre de la Transition juste, de l’Emploi et du Travail équitable – a été créé afin de coordonner ces actions. Une nouvelle Commission de transition juste officielle permanente jouera un rôle de conseil et sera chargée de suivre et d’évaluer l’avancement des objectifs clés1.
Réponse politique et gestion des transitions
La priorité était de développer un plan de transition pour le secteur de l’énergie. Comme c’est également le cas pour de nombreux territoires, y compris le Canada, l’objectif de carboneutralité d’ici 2045 de l’Écosse s’accompagne d’une « optimisation de la récupération du pétrole et du gaz » dans l’avenir prévisible. Le soutien financier du gouvernement à l’exploration et à la production de pétrole et de gaz est conditionnel aux investissements dans la transition vers les énergies renouvelables. Il appuie les technologies de CUSC, les énergies de substitution (hydrogène et pile à combustible à hydrogène), la mise hors service des installations de production pétrolière et gazière, et la transition des travailleurs vers de nouveaux emplois.
À l’échelle du Royaume-Uni, un groupe de décideurs du secteur pétrolier et gazier invite les dirigeants des secteurs privé et public à se concerter sur ces questions. Le regroupement a conçu sa propre feuille de route pour la réduction des émissions de GES d’ici 2035, comprenant des mesures clés en matière de perfectionnement professionnel, de technologie, d’innovation et de réductions des émissions (Oil and Gas UK, 2022). La Commission de transition juste reconnaît de la valeur à ces efforts, mais souligne l’importance de leur cohérence avec les objectifs de réductions des émissions prévus par la loi (Commission de transition juste, 2020). La décentralisation et l’exclusivité des compétences compliquent aussi la reddition de comptes. Par exemple, l’octroi de licences d’exploitation de pétrole et de gaz en mer relève exclusivement du gouvernement du Royaume-Uni, alors que l’octroi de licences d’exploitation à terre a été transféré à l’Écosse en 20162. On craint également que le plan dirigé par le secteur privé ne traite pas adéquatement de la situation des travailleurs.
Alors que les initiatives se poursuivent, le secteur a déjà amorcé sa transition. De 2015 à 2020, le prix du pétrole brut a connu plusieurs baisses entraînant des pertes d’emploi; la situation s’est ensuite aggravée durant la période de repli économique causée par la pandémie de COVID-19. Même lorsque le prix de l’essence a remonté en 2022, les emplois n’ont jamais retrouvé les niveaux antérieurs. Des initiatives sont en cours pour tenter de surmonter ces difficultés. Le Plan pour la main-d’œuvre du secteur pétrolier et gazier du gouvernement du Royaume-Uni (2016) vise à aider les travailleurs licenciés à se trouver un emploi dans un autre secteur qui nécessite des compétences semblables, grâce à des plateformes en ligne3. Les récents objectifs climatiques de l’Écosse (2020) prévoient un fonds d’emplois verts de 100 millions de livres sterling (165 millions de dollars canadiens) ayant pour but de soutenir les investissements dans les entreprises sobres en carbone, et la Green Jobs Workforce Academy – un service destiné aux travailleurs à la recherche d’un emploi dans une entreprise verte.

Par ailleurs, on espère fermement que les investissements dans les énergies renouvelables faciliteront la transition de la main-d’œuvre. Un rapport récent de l’Université Robert Gordon estimait qu’en 2030, environ 200 000 travailleurs seraient nécessaires pour développer l’énergie éolienne en mer, l’hydrogène et les entreprises de CUSC, parallèlement aux activités pétrolières et gazières existantes. Cependant, les investissements dans le perfectionnement et le recyclage professionnel demeurent jusqu’à maintenant modestes et l’accent mis sur les services en ligne pourrait en limiter la portée, étant donné que les travailleurs ne sont pas tous habiles en informatique.
Le développement régional fait également partie intégrante de la transition juste de l’Écosse. Des reculs de l’emploi ont touché de manière disproportionnée certaines régions, comme l’Aberdeenshire dans le Nord-Est, où les emplois sont fortement concentrés dans le pétrole et le gaz en mer. À la suite du Brexit, le Royaume-Uni et l’Écosse ont dû repenser leurs approches du développement régional. L’Écosse a déjà mis sur pied un fonds de développement régional de 500 millions de livres sterling (827 millions de dollars canadiens), afin de soutenir la transition énergétique dans les régions du Nord-Est et du Moray. Le fonds comprend aussi des investissements garantis et des prêts aux petites et moyennes entreprises.
Toutes les régions et communautés urbaines écossaises ont adopté des ententes de développement régional – accords entre les gouvernements de l’Écosse et du Royaume-Uni et les collectivités locales visant à favoriser le développement économique à long terme. Certaines de ces ententes comportent aussi des objectifs de transition juste. Par exemple, sous l’entente d’Aberdeen (qui en est à sa cinquième année), le centre des technologies du pétrole et du gaz est devenu le centre des technologies carboneutres, et son mandat est désormais de concevoir des outils permettant d’accélérer la transition du secteur pétrolier de la mer du Nord vers la carboneutralité (Invest Aberdeen, 2022). Cependant, comme elles ont été pensées indépendamment du processus de création du Cadre de planification de transition juste, les ententes de stratégie économique locale ne s’alignent pas nécessairement sur les objectifs de transition juste.
Parmi les autres initiatives pouvant contribuer à l’atteinte des objectifs de transition juste, on retrouve le programme de relance de l’Écosse dirigé par le Royaume-Uni, qui a pour but de stimuler les investissements dans les régions qui accusent un certain retard économique et de réduire les inégalités territoriales. Enfin, le gouvernement de l’Écosse prévoit de développer des ports francs verts, c’est-à-dire de grandes zones reliées au réseau ferroviaire et dotées d’infrastructures portuaires et aéroportuaires où les exploitants et les entreprises pourront tirer parti d’incitatifs fiscaux et d’autres avantages. Pour y être admissibles, ils doivent soutenir « une transition juste vers la carboneutralité d’ici 2045 et la création d’emplois de qualité offrant un bon salaire et de bonnes conditions » (gouvernement de l’Écosse, 2022a). Il s’agit d’une tentative d’introduire des concepts de transition juste dans les zones d’investissements commerciaux et de créer un environnement concurrentiel propice à l’excellence en fabrication de technologies vertes.
Progrès réalisés à ce jour
L’Écosse commence tout juste à mettre en œuvre son Cadre de planification de transition juste, et il est donc encore trop tôt pour en évaluer l’incidence. La nouvelle approche du cadre national, qui fait appel à la responsabilisation des ministères et comprend une commission indépendante fournissant un service-conseil et le suivi des progrès, semble assez robuste devant la complexité et l’ampleur du défi. On projette déjà à l’échelle nationale d’organiser un dialogue auquel participeront les intervenants et détenteurs de droits définis par la première Commission de transition juste. Le gouvernement de l’Écosse s’est aussi associé à la démarche et conçoit la transition juste comme une fin – un avenir plus équitable et plus vert pour tous – et un processus qui doit passer par la coopération (gouvernement de l’Écosse, 2021). Il sera important que le nouveau cadre permette d’élargir et de renforcer l’apport de la première Commission de transition juste dans l’élaboration de nouveaux plans de transition sectoriels.
Le Royaume-Uni a réalisé d’importants progrès dans la réduction de ses GES. Le Climate Action Tracker qualifie les efforts climatiques du pays de « presque suffisants »; ils correspondraient à un réchauffement planétaire moyen de moins de 2 °C (Climate Action Tracker, 2021). L’Écosse a réduit ses émissions plus vite que la moyenne du Royaume-Uni, grâce à la rapidité et à l’ampleur de la décarbonisation de son électricité (Comité des changements climatiques du Royaume-Uni, 2021). La loi de 2009 sur les changements climatiques et la loi de 2019 sur les cibles de réduction des émissions de gaz à effet de serre (deux lois écossaises) prévoient des objectifs annuels de réduction permettant à l’Écosse de rester sur la voie de la carboneutralité. Le Comité des changements climatiques publie annuellement un rapport indépendant afin d’en suivre l’avancement. Or, bien que l’Écosse réalise des progrès, selon la dernière évaluation du Comité (2021), elle n’en fait pas assez sur le plan de l’adaptation, laquelle joue un rôle important dans les processus de transition juste (Comité des changements climatiques du Royaume-Uni, 2022).
On observe également des contradictions dans l’approche empruntée par l’Écosse dans la transition de sa filière pétrolière et gazière, même si elle est indispensable à l’atteinte de la carboneutralité. Comme mentionné précédemment, il n’y a pas d’échéance clairement établie pour mettre fin à l’exploration et à la production de pétrole et de gaz, ce qui laisse planer une incertitude considérable sur le calendrier d’abandon progressif du secteur contraire à l’approche de la transition juste. Des facteurs externes, comme l’invasion russe en Ukraine et l’annulation du gazoduc Nord Stream 2, pourraient continuer de faire grimper le prix du pétrole et du gaz à l’échelle mondiale, rendant plus attrayants les investissements dans le secteur.
Un flou demeure aussi sur l’élaboration de plans à l’échelle locale et leur cohérence avec les vastes réformes sectorielles. Aucun plan de transition juste définissant les atouts et les occasions des régions et créant des coalitions de mise en œuvre n’a encore été élaboré par les collectivités. Cependant, il existe un modèle de collaboration que l’Écosse pourrait utiliser pour amorcer ce processus. Les partenariats économiques régionaux sont des collaborations entre les collectivités locales, le secteur privé, les établissements d’enseignement et de formation, les agences d’entreprises et de développement des compétences, les ONG et la société civile. Le gouvernement a déjà appuyé plusieurs de ces partenariats et ces regroupements pourraient servir à planifier les transitions justes à l’échelle régionale. La nouvelle commission permanente vouée à la transition aura assurément un rôle à jouer dans la surveillance des aspects de distribution de la justice – en mesurant les bienfaits et les conséquences de la transition sur différents groupes – afin que soit tenu responsable le gouvernement.
Bien que des initiatives soient déjà en marche, le Partenariat de transition juste qui a mené à la création de la première Commission de transition juste de l’Écosse doute que l’approche du gouvernement suffise. Il a même qualifié le manque d’investissements régionaux et d’emplois locaux dans le secteur des énergies renouvelables « d’injuste » (Mercier, 2020 : 125). Son manifeste de 2021 appelait le gouvernement à fournir un soutien immédiat aux travailleurs licenciés, au moyen d’un programme de travaux publics verts. Le programme permettrait d’accompagner toute mesure d’aide du gouvernement dans le secteur privé d’exigences en matière de réduction des émissions et de création d’emplois et d’objectifs clairs de décarbonisation, d’investissement et de création d’emplois. Reste à savoir dans quelle mesure ces demandes seront accueillies favorablement (Partenariat de transition juste, 2020).
Les centrales syndicales et le Partenariat de transition juste ont réclamé une plus grande intervention de l’État. Le Partenariat aimerait voir « une planification économique menée par l’État, et la nationalisation de l’énergie et des investissements publics dans la politique industrielle comme dans le secteur manufacturier » (Mercier, 2020 : 125). Les champs de pétrole de la mer du Nord sont répartis géographiquement de manière égale entre le Royaume-Uni et la Norvège, offrant un point de comparaison sur la gestion des ressources pétrolières dans une transition juste4. Du côté du Royaume-Uni, les recettes publiques issues de la mer du Nord écossaise étaient de 22 millions de livres sterling (33,74 millions de dollars canadiens) en 2021, tandis que les revenus de la Norvège étaient de 9 milliards de livres sterling (14,74 milliards de dollars canadiens) pour sensiblement la même production (McKay, 2021). En Norvège, le pétrole est un secteur nationalisé; au Royaume-Uni, il relève du privé. Les célèbres fonds souverains de la Norvège s’élèvent à environ 1,69 billion de dollars canadiens. Le Royaume-Uni ne s’est pas doté de tels fonds, lesquels auraient pu servir à soutenir la transition juste5. Les membres des syndicats et du Partenariat perçoivent cela comme une occasion manquée et un revers pour la gestion de la transition. Ils revendiquent une intervention beaucoup plus grande du secteur public et même la nationalisation des énergies renouvelables, qui permettrait d’accélérer la transition juste et de créer des emplois de qualité (Partenariat de transition juste, 2020; Prospect, 2022). Par exemple, le Congrès des syndicats écossais a soutenu que le récent développement par le secteur privé de l’énergie éolienne en mer (ScotWind et ses 17 projets) aurait généré des milliers d’emplois supplémentaires s’il avait été constitué en société énergétique nationale (Williams, 2022).
Leçons pour le Canada
Les démarches de l’Écosse visant la transformation rapide de tous les secteurs de son économie et de sa société sont ambitieuses. Bien que les résultats demeurent largement inconnus, le Cadre de planification de transition juste écossais comporte trois leçons qui peuvent être utiles aux gouvernements canadiens :
- Définir la portée et les paramètres de la transition juste. Le concept de transition juste fait l’objet de discussions. L’expression réfère à différentes notions selon qu’elle est employée par les communautés, les parties prenantes ou les détenteurs de droits. Dans le cadre de ses premiers efforts nationaux, la Commission de transition juste en a analysé le sens selon différents groupes afin de transmettre au gouvernement de l’Écosse des points de vue diversifiés sur les actions à privilégier. Un tel processus permet de clarifier un concept aux contours flous et de définir les priorités communes.
- Prendre des mesures concrètes concernant le maintien en poste, et la qualité et la rémunération des emplois afin de réduire les risques pour les travailleurs. Les intervenants importants demandent des intentions fermes de la part des secteurs public et privé, qui permettraient d’atténuer les risques et les dommages potentiels associés à la transition. Par exemple, le gouvernement de l’Écosse a établi que le financement public de l’action climatique sera conditionnel à des modalités de travail raisonnables, et pourrait fixer des critères de salaire réellement décent aux organismes publics non ministériels, parallèlement à des normes de travail équitables, comme condition aux contrats publics d’efficacité énergétique et de rendement thermique (gouvernement de l’Écosse, 2021). Une des principales inquiétudes des travailleurs de l’énergie est que leur nouvel emploi soit de moindre qualité et de moindre rémunération. Établir des normes de travail et de salaire adéquates est une manière de remédier à la situation.Frameworks and accountability are necessary.
- Prévoir des structures d’encadrement et de responsabilisation. L’Écosse a mis sur pied un processus d’application de ses objectifs de transition juste. Le Cadre de planification de transition juste national fixera les objectifs; les plans sectoriels en fourniront les détails; le ministre de la Transition juste verra à la responsabilisation; et la Commission de transition juste jouera un rôle de conseil, de surveillance et d’évaluation. L’interprétation et l’application de la justice dans ces contextes seront importantes, tout comme l’arrimage entre les plans sectoriels et le développement régional. Les modalités de la collaboration des groupes en question ne sont pas encore définies, mais la coordination sera essentielle à leur réussite.
Conclusion
En tant que gouvernement relevant du Royaume-Uni, l’Écosse doit coordonner ses initiatives de transition juste avec les différents ordres de gouvernements. Les plans sectoriels écossais envoient un message fort au gouvernement du Royaume-Uni sur les priorités de ses investissements. Alors qu’on met en œuvre ces plans, la solidité et l’inclusivité du Cadre de planification du gouvernement seront mises à l’épreuve. Il sera pertinent de continuer à suivre le cheminement de l’Écosse.
Toute opinion, erreur ou omission relève uniquement de l’auteur.
Références
Climate Action Tracker. 2021. « United Kingdom | Climate Action Tracker. » 16 novembre. https://climateactiontracker.org/countries/uk/
Comité des changements climatiques du Royaume-Uni. 2021. « Progress Reducing Emissions in Scotland – 2021 Report to Parliament. » 7 décembre. https://www.theccc.org.uk/publication/progress-reducing-emissions-in-scotland-2021-report-to-parliament/
———. 2022. « Is Scotland Climate Ready? – 2022 Report to Scottish Parliament » 15 mars. https://www.theccc.org.uk/publication/is-scotland-climate-ready-2022-report-to-scottish-parliament/
Commission de transition juste. 2020. « Just Transition Commission Interim Report. » 27 février. https://www.gov.scot/publications/transition-commission-interim-report/
———. 2021. « Just Transition Commission: A National Mission for a Fairer, Greener Scotland. » 23 mars. https://www.gov.scot/publications/transition-commission-national-mission-fairer-greener-scotland/documents/
Gouvernement de l’Écosse. 2021. « Just Transition – A Fairer, Greener Scotland: Scottish Government Response. » 7 septembre. https://www.gov.scot/publications/transition-fairer-greener-scotland/
———. 2022a. « Cities and Regions: Green Freeports. » https://www.gov.scot/policies/cities-regions/green-ports/
———. 2022b. « Climate Change. » https://www.gov.scot/policies/climate-change/
———. 2022c. « Oil and Gas. » https://www.gov.scot/policies/oil-and-gas/
Invest Aberdeen. 2022. « Aberdeen City Regional Deal. » https://investaberdeen.co.uk/abz-deal
McKay, Ron. 2021. « What Actually Happened to Scotland’s Trillions in North Sea Oil Boom? » The Herald Scotland. 14 novembre. https://www.heraldscotland.com/politics/19716393.actually-happened-scotlands-trillions-north-sea-oil-boom/
Mercier, Sinéad. 2020. « Four Case Studies on Just Transition: Lessons for Ireland. » National Economic and Social Council, Research Series Paper. 15 : 1-165. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3694643
Oil and Gas UK. 2021. « Workforce & Employment Insight 2021. » https://oeuk.org.uk/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2021/08/OGUK_Workforce-Employment-Insight-2021-z07os0.pdf
———. 2022. « Roadmap 2035: A blueprint for net-zero. » https://roadmap2035.co.uk/roadmap-2035/
Partenariat de transition juste. 2020. « Just Transition Partnership 2021 Manifesto. » Friends of the Earth Scotland. 25 septembre. https://foe.scot/resource/just-transition-partnership-manifesto/
Prospect. 2022. « Scottish Govt Response to Just Transition Commission Lacks a Clear Strategy for Job Creation. » 7 septembre. https://prospect.org.uk/news/scottish-govt-response-to-just-transition-commission-lacks-a-clear-strategy-for-job-creation/ Williams, Martin. 2022. « Unions Call for Nicola Sturgeon Intervention to Ensure Scotland Properly Profits from ScotWind. » The Herald Scotland. 25 janvier. https://www.heraldscotland.com/news/homenews/19873646.unions-call-nicola-sturgeon-intervention-ensure-scotland-properly-profits-scotwind/
1 En 2021, le gouvernement du pays de Galles, qui relève aussi de Westminster, a également créé un nouveau poste au sein de son Cabinet (ministre des Changements climatiques), qui est responsable de la décarbonisation des transports, du logement et de la production d’énergie.
2 L’octroi des licences d’extraction de pétrole et de gaz en mer relève du gouvernement du Royaume-Uni tout comme la compétence législative en santé et sécurité. La loi de 2016 sur l’Écosse transfère le régime des licences d’exploration et d’extraction du pétrole et du gaz à terre à l’Écosse.
3 La plateforme en ligne britannique Talent Retention Solutions met en communication directe les travailleurs qualifiés cherchant un emploi et les entreprises à la recherche d’employés. L’outil en ligne Skills Connect soutient les employeurs du pétrole et du gaz aux prises avec la pénurie de travailleurs qualifiés.
4 La Norvège compte réduire ses émissions nettes de 55 % d’ici 2030, mais le gouvernement actuel souhaite poursuivre le développement du secteur pétrolier et gazier.
5 Ce n’est vraisemblablement pas ce qui est fait en Norvège, dont le gouvernement actuel traite ces fonds comme tout autre revenu. De plus, le pays compte poursuivre le développement de sa filière pétrolière et gazière.