Protéger les terres et les eaux dans la région du Traité nº9
[Cliquez pour voir en français] ᐦᐊᑕᓯᓐ-ᒉᐃᒥᔅ ᐯᔨ ᓃᑖᓂᒡ ᐊᓂᑌᐦ ᐙᐸᓅᑖᑦ ᐊᣆᑌᐦᐁᕆᔦᐤ ᑳ ᐄᐦᑕᑣᐤ ᒌ ᐊᒋᔥᑖᐊᐸᔥᑖᐆᒡ ᐯᔭᒄ ᐊᓂᔫ ] ᒫᐆᒡ ᐁᐦ ᒦᔫ ᐋᐸᑕᓃᒡ ᐆᑕᐦ ᐊᔅᒌᒡ ᐁᐐ ᒥᔫᓈᑲᑕᑲᓅᒡ ᐊᔅᒌ ᓀᔥᑕ ᐁᐦ ᒥᔻᑲᒥᑕᑲᓅᒡ ᓂᐲ ᑲᔦᐦ ᒪᓯᐌᐦ ᒉᐦᒀᓐ ᐁᐦ ᐊᔫᔨᒪᑯᒡ ᐊᓐᑌᐦ ᐊᔅᒌᒡ ᒉᒌ ᒥᔫᐸᐐᒡ ᐁᐦᐐ ᐊᑕᔥᑌᔨᑕᒥᒄ ᐃᔨᔫ ᐄᐦᑐᐎᓐ᙮ ᐆ ᓈᔥᒋ ᐁᐦ ᐊᒋᐦᐊᐸᐐᒡ ᐁᐦ ᐋᐦᒋᐸᐐᒡ ᐊᔅᒌ ᐊᓐᑌᐦ ᐄᔨᔫᒡ ᐁᐄᔥ ᐐᑕᒀᒡ ‘ᒪᔅᒉᒄ’ ᑲᔦᐦ ᐊᓂᑌᐦ ᐄᔥ ᓅᒋᒦᐦᒡ ᐁᐦ ᐐᒋᑣᐤ ᐆᒥᔥᑫᐦᒀᐤ ᐄᔨᔫᒡ ᓂᐲᐆᐄᔨᔫᒡ ᐁᐄᔥ ᐊᒋᔅᒉᔨᒫᑲᓅᑣᐤ ᑲᔦᐦ᙮ ᐆᔅᑌᐦ ᓂᔥᑕᒪᑎᓅ ᒦᓐ ᓂᔮᔪ ᒋᐦᐁ ᐱᓪᓕᔭᓐ ᐁᐦ ᐸᐸᒥᐾᑖᓄᒡ ᑳᐦ ᒥᔖᒡ ᒌᒫᓐ ᐁᐦ ᐋᐸᑕᓯᒡ ᑲᔦᐦ ᐁᐦ ᐸᐦᑳᓂᔥᑖᑲᓅᒀᐤ ᒦᓐ ᐊᑕᑑ ᒥᓕᔭᓂᔅ ᒉᒌ ᔭᐆᒐᐸᐐᑖᑦ ᑳ ᒥᔖᒡ ᒌᒫᓐ ᒣᔑᑲᒻ ᐊᐦᐴᓂᐦ ᑲᔦᐦ ᐆ ᐁᐃᔨᔅᐱᓇᑳᑦ ᐎ
Les basses terres de la baie d’Hudson et de la baie James dans le nord de l’Ontario forment l’un des puits de carbone et l’une des régions indispensables à la vie les plus importants du monde ainsi qu’un écosystème d’une grande importance culturelle. Ce vaste paysage de tourbières, appelé « muskeg » en langue crie, est le lieu de vie des Cris et Cries d’Omushkego, connus sous le nom de « peuple de l’eau ». Stockant plus de 35 milliards de tonnes de carbone et capturant des millions de tonnes supplémentaires chaque année, cette région contribue à stabiliser le climat mondial.
Sur ces basses terres se trouvent les communautés autochtones qui ont signé le Traité no 9. Le peuple Omushkego gère la terre depuis des générations et entretient un lien spirituel et culturel profond avec ses rivières, sa faune et ses muskegs. La richesse écologique de la région est à la base des modes de vie traditionnels. C’est une pouponnière pour la biodiversité, abritant des espèces menacées, comme le caribou des bois, le carcajou et l’esturgeon, en plus d’être un sanctuaire pour des centaines d’oiseaux migrateurs. Il est crucial de protéger les basses terres de la baie d’Hudson et de la baie James non seulement pour atteindre les objectifs climatiques et conserver la biodiversité, mais aussi pour respecter les droits et le patrimoine des peuples autochtones.

Malgré son importance mondiale, cette région fragile fait face à une menace sans précédent en raison des projets d’exploitation minière dans la région connue sous le nom de « Cercle de feu ». Le Cercle de feu est le nom que les sociétés minières ont donné à un important gisement de minéraux situé dans la région du Traité n° 9. Avec une durée de vie de plus de 100 ans, le projet d’exploitation minière aura des répercussions négatives sur la santé de la nature et sur la capacité des générations actuelles et futures à exercer leurs droits inhérents et les droits issus de traités, dont les droits de conserver et de gérer les terres, de chasser, de pêcher et de réaliser des activités de piégeage.
Dans ce contexte, des membres de la communauté autochtone ont commencé à se mobiliser pour protéger leurs terres, en faisant valoir leurs droits environnementaux, leurs droits inhérents et leurs droits issus des traités. Parmi ces groupes communautaires, il y a le groupe Friends of the Attawapiskat River (« Friends »), une coalition formée de membres de la communauté locale qui se consacrent à la protection du bassin hydrographique de la rivière Attawapiskat contre l’exploitation minière dans le Cercle de feu. Les efforts qu’ils déploient soulignent la nécessité pressante d’amplifier les perspectives des groupes communautaires autochtones et d’expliquer pourquoi il est impossible de séparer le fait de respecter les promesses des traités de l’atteinte des objectifs en matière de climat et de conservation.
Actuellement, le fait d’autoriser des pratiques minières nuisibles discrédite la capacité du gouvernement de l’Ontario de gérer et de réglementer les activités liées à l’exploitation minière. Cela a conduit à des appels pour que les décisions soient prises par les Autochtones et respectent la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA) et le consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause (CPLCC), ainsi qu’à de nombreuses contestations et décisions judiciaires exigeant des organismes de réglementation de l’exploitation minière et des gouvernements qu’ils améliorent radicalement les pratiques actuelles. On trouve des minéraux critiques pour réduire la consommation de combustibles fossiles également dans d’autres régions, pas uniquement dans les « terres qui respirent » vierges.
La voix des groupes communautaires continue de se faire entendre en réaction aux plans élaborés par le gouvernement et l’industrie sans le consentement approprié des Autochtones. Friends est depuis devenu l’un des principaux groupes communautaires qui s’expriment au sujet des droits et des mesures climatiques dans la région. La présente étude de cas ainsi que les citations et les réflexions qu’elle renferme proviennent de Friends. Au moyen d’actions de sensibilisation, de cérémonies et de plaidoyers, la présente étude de cas fait partie des efforts déployés par Friends pour collaborer avec des alliés afin de protéger ces tourbières et les droits de ceux et celles qui vivent en aval du projet d’exploitation du Cercle de feu.
La présente étude de cas examine les mesures climatiques prises par les Autochtones dans la région du Traité n° 9, mettant l’accent sur les actions visant à protéger les basses terres de la baie d’Hudson et de la baie James contre l’exploitation minière dans le Cercle de feu. Elle commence par décrire de manière détaillée la toile de fond et le contexte, comme les propositions d’exploitation minière, l’importance écologique de la région et l’environnement juridique, avant d’analyser la façon dont les communautés autochtones se mobilisent sur le terrain et dans les arènes stratégiques. Elle présente ensuite des recommandations de politiques inspirées de cette lutte, comme la reconnaissance des aires protégées autochtones et l’application du CPLCC, et se termine par des réflexions sur la plus grande importance que revêtent les mouvements communautaires.
[Cliquez pour voir en français] ᐆ ᑲᐐᔅᒃ ᐁ ᒥᓯᐌ ᐁᐦ ‘ᓈᓂᑑᐊᑰᑕᔥᑖᓄᒡ ᑲᔦᐦ ᐁᐐ ᒦᔫᑲᓇᐙᐸᑕᑲᓅᒡ ᐊᓐ ᐐᔓᐌᐎᓐ ᐯᔨᑯᔥᑌᐤ ᐋᔅᒌᐦ ᑲᔦᐦ ᓂᐲᐦ’ ᐗᐦᑏᐌᐅ ᑖᓐ ᐁᐄᔥ ᐊᑯᔅᑖᑕᑲᓃᒡ ᐋᓂᑦ ᐁᐄᔥ ᓃᐴᑣᐤ ᐄᔨᔫᒡ ᐁᐦ ᓃᑳᓂᔥᒀᑲᓅᑖᐤ ᐊᑕᔅᒉᔨᑕᒨᐦᐄᐌᐅᓐ ᑲᔦᐦ ᐯᔭᑯᔥᑌᐆᔖᑉ ᐊᔅᒌᔫᐦ ᐁᐦ ᐄᔅᐸᐐᒡ ᒌᔑᒄ ᑲᔦᐦ ᐊᔅᒌ ᐁᐦ ᒫᔥᑖᓅᒡ ᑲᔦᐦ ᓈᔥᒋ ᐁ ᓂᑑᐌᔨᑕᒧᒃ ᒉ ᐋᐦᒋᐸᐐᒡ ᒉᒀᓐ ᐁᐄᔥ ᓂᓈᑲᑕᔥᑖᑲᓅᒡ ᐁᐦ ᓅᑲᑕᑲᓅᑦ ᐁ ᐊᒋᔥᑌᐃᑕᑲᓅᑦ ᐄᔨᔫᒡ ᐆ᙮
Grâce à cette évaluation approfondie, la présente étude de cas illustre le rôle essentiel des têtes dirigeantes autochtones quand vient le temps de lutter contre les changements climatiques et de défendre la justice environnementale, ainsi que le besoin urgent d’apporter des changements systémiques pour assurer le respect des droits autochtones en tant que pierre angulaire de l’action collective en faveur du climat, de la conservation et de la justice.
Toile de fond et contexte
Généralités sur le Cercle de feu
Plus de 33 000 concessions minières ont été jalonnées dans une région surnommée le « Cercle de feu », qui couvre quelque 5 000 km² sur le territoire du Traité n° 9. Les permis d’exploration accordés par la province de l’Ontario, qui autorisent la coupe de lignes, le forage et les activités de construction, ouvrent l’accès à cette tourbière intacte et unique au monde, située dans les basses terres de la baie James. Aucune de ces concessions et aucun de ces permis n’ont été délivrés avec le consentement des communautés autochtones touchées et situées en aval, que Friends considère comme son chez-soi.
S’étendant sur la côte de la baie de James, la tourbière (muskeg) de cette région constitue un écosystème d’importance mondiale. Ses sols tourbeux, dont certains s’étendent sur plusieurs mètres de profondeur, se sont accumulés pendant des milliers d’années, stockant des milliards de tonnes de carbone. Selon une estimation, les tourbières des basses terres de la baie d’Hudson et de la baie James renferment jusqu’à cinq fois plus de carbone par mètre carré que la forêt pluviale d’Amazonie. En tout, plus de 35 milliards de tonnes de carbone sont stockées dans ces terres.
Aussi longtemps que l’écosystème des tourbières demeure intact (humide et frais), ce carbone n’est pas libéré dans l’atmosphère, faisant donc de la région un puits de carbone naturel, capturant des gaz à effet de serre, ce qui est essentiel pour réduire les émissions dommageables pour le climat.
[Cliquez pour voir en français] ᓇᒧᐎ ᒨᔥ ᒋᑲ ᒌ ᒨᔅᑳᑲᓀᐦᐁᓐ ᐆᑲᐐᒪᐆ ᐊᔅᒌ ᔔᔮᓐ ᐆᐦᒋ ᑖᐹ ᒦᓐ ᑳᐤ ᒋᑲᒌ ᐄᑕᑲᓐ ᐊᓐ ᒉᒀᓐ᙮’ – ᐯᔭᒃ ᐊᓐ ᑳ ᐊᐹᒡ ᐊᓐᑕ ᐐᒉᐙᑲᓐᐦ ᒌᐃᔥ ᐐᑕᒻ
” On ne peut pas continuer à exploiter la terre nourricière pour un dollar, car on exploite quelque chose qui ne peut pas être remplacé. “
– Membre de Friends
En perturbant ce paysage, par exemple en asséchant les zones humides, en les creusant ou en les soumettant à des activités d’extraction, on risque de libérer ce carbone, transformant ainsi un puits de carbone d’importance mondiale en source d’émissions. Face aux changements climatiques, les scientifiques et les utilisateurs et utilisatrices des terres autochtones soulignent qu’il est essentiel de protéger ces tourbières pour empêcher la libération de niveaux de carbone pouvant altérer le climat. Autrement dit, le sort réservé à ces tourbières nordiques a d’énormes répercussions sur la capacité du Canada à atteindre ses cibles climatiques et à réduire les émissions de 40 pour cent d’ici 2030.
En plus de réguler le climat et de le stabiliser, les basses terres de la baie d’Hudson et de la baie James représentent un habitat riche pour la faune et exercent des fonctions écologiques irremplaçables. Les tourbières filtrent l’eau et préservent la santé des rivières Attawapiskat, Albany et Winisk et d’autres grandes rivières qui traversent cette région et descendent jusqu’à la baie James. Cette région est l’un des derniers bastions du caribou des bois en Ontario et abrite d’autres espèces sensibles, comme le carcajou et l’ours polaire à ses limites septentrionales. Un nombre incalculable d’oiseaux migrateurs nichent ou font une pause dans les tourbières et marais littoraux. D’ailleurs, les côtes de la baie d’Hudson et de la baie James sont des sites de reproduction revêtant une importance mondiale pour la sauvagine et les oiseaux de rivage.

Généralités sur le contexte juridique
L’inaction de l’industrie et des gouvernements quand vient le temps de mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA) et de respecter les promesses des traités alimente les violations des droits des peuples autochtones, qu’il s’agisse du droit à l’eau potable, du consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause ou de la conservation de la nature. Comme les titulaires de droits autochtones ont constamment de la difficulté à accéder aux services juridiques pour consigner les changements aux politiques, assurer une sensibilisation à l’égard de ceux-ci et en appeler à des changements de politiques en réaction aux menaces visant leurs droits et intérêts, il est devenu essentiel d’accroître l’accès à la justice pour les actions déployées par Friends visant à amplifier les messages des groupes communautaires.
Dans le contexte du chevauchement des lois et des compétences ayant des répercussions sur les droits des membres de Friends, en tant que peuples autochtones et visés par des traités, cette section cherche à analyser une série de réformes à laquelle Friends a participé directement et qu’il a défendues afin de proposer une voie à suivre.
Droit international et obtention du “consentement”
En 2016, le Canada a annoncé qu’il appuyait la DNUDPA « sans réserve » et qu’il allait la mettre en œuvre. La DNUDPA reconnaît en particulier les droits des peuples autochtones en ce qui concerne les projets d’exploitation les touchant et touchant leurs terres, leur droit de conserver et de protéger l’environnement et la capacité de production de leurs terres et de leurs ressources.
En 2021, le Parlement canadien a édicté la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (LDNUDPA), qui confirme que la DNUDPA est « un instrument international universel en matière de droits de la personne qui trouve application en droit canadien1 ». La Cour suprême du Canada a récemment conclu que, par l’intermédiaire de la LDNUDPA, la DNUDPA est « intégrée dans le droit positif interne du Canada », et la Cour fédérale a jugé que la DNUDPA, en tant que « cadre pour la réconciliation », souligne l’importance de « veiller au consentement libre et éclairé des Autochtones avant tout processus décisionnel qui les touche ».
Parmi les obligations qu’impose la LDNUDPA au Canada, mentionnons les suivantes :
- Confirmer que la Déclaration constitue un instrument en matière de droits de la personne qui trouve application en droit canadien;
- Exiger la mise en œuvre d’un plan d’action pour atteindre les objectifs de la DNUDPA.
En dépit de ces reconnaissances et de l’élan juridique, il reste encore beaucoup de travail à faire. Pedro Arrojo-Agudo, rapporteur spécial de l’ONU sur les droits de l’homme à l’eau potable et à l’assainissement, a récemment constaté que les activités d’extraction, y compris l’exploitation minière, continuent de violer les droits de la personne, en particulier le droit à l’eau des populations autochtones. Au printemps 2024, M. Arrojo-Agudo a rencontré des représentants et représentantes autochtones, recueillant des témoignages convaincants sur les conditions de vie difficiles dans les réserves, où, dans de nombreux cas, même le droit à l’eau potable n’était pas garanti. Les membres de Friends ont rencontré M. Arrojo-Agudo, à Ottawa, durant sa tournée au Canada. Ils ont indiqué que « les gens hors de la communauté ne comprennent pas les difficultés auxquelles les Premières Nations font face. Le Canada est un pays prospère, mais on a l’impression de vivre encore dans des conditions observées dans les pays du tiers monde. »
Comme les membres de Friends l’ont expliqué au rapporteur de l’ONU, sans accès à l’eau potable, les membres de la communauté ont des éruptions cutanées et d’autres problèmes dermatologiques. Les menaces de contamination de leurs rivières et de leurs muskegs (tourbières) par les activités minières ont des répercussions supplémentaires sur les membres de la communauté, suscitant peur et anxiété. Reconnaissant ces préoccupations, le rapporteur de l’ONU a déclaré que « les peuples autochtones font face, de manière disproportionnée, aux risques les plus élevés de contamination par l’eau toxique ayant de graves répercussions sur la santé. Il est regrettable que les personnes qui causent des dommages aux sources d’eau ou les polluent ne soient pas tenues responsables ni tenues de fournir un dédommagement pour les torts causés. »
Parmi les « réformes approfondies » que le rapporteur a recommandées, mentionnons les lois qui font la promotion d’une approche écosystémique fondée sur les droits de la personne, avec une participation égale des Autochtones et des gouvernements, ce qui garantit le respect du principe de consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause.
Bien que ces constatations s’appliquent directement à l’Ontario et à l’octroi continu de concessions et de permis d’exploitation minière sans le consentement des peuples autochtones, aucune loi provinciale touchant la DNUDPA n’a encore été adoptée. Le rôle de cette dernière et de la LDNUDPA est donc limité. Si la DNUDPA peut être invoquée pour interpréter les lois existantes ou aider à résoudre les ambiguïtés des textes législatifs, en tant que principe général du droit constitutionnel, le gouvernement fédéral ne peut pas faire en sorte que des lois internationales ou fédérales s’appliquent dans un domaine relevant de la compétence provinciale. Il appartient plutôt à chaque province, agissant en son nom propre, de mettre en œuvre une loi provinciale qui mettrait en application un traité international, comme la DNUDPA. Par conséquent, si la LDNUDPA et son plan d’action peuvent fournir un langage et une orientation stratégique utiles, il faut tout de même plaider en faveur d’une loi provinciale qui mette en œuvre la DNUDPA afin qu’elle soit pleinement contraignante.
Loi sur l’évaluation d’impact et son application aux projets miniers
Les peuples autochtones, y compris Friends, continuent de mettre l’accent sur l’absence de consultation véritable au sujet des projets d’extraction. Le respect des perspectives et des communautés autochtones, qui risquent d’être les plus directement touchées par les projets miniers, existants et nouveaux, de l’industrie extractive, passe par la mise en place des processus d’évaluation les plus solides, qui vont de pair avec les lois autochtones.
Il existe également un espace pour cela, étant donné que la Loi sur l’évaluation d’impact (LEI) a été rédigée en tenant compte de la DNUDPA et que sa mise en œuvre est intégrée aux processus et à la prise de décision. Par exemple, la LEI exige la prise en compte des droits et des connaissances autochtones et confirme l’engagement du Canada à obtenir le consentement libre, préalable et éclairé des peuples autochtones en ce qui concerne les décisions prises dans le cadre de la LEI.
Malheureusement, en raison d’une approche « par seuil », seuls les projets miniers de la plus grande envergure font l’objet d’une évaluation d’impact (EI). Cela signifie que la majorité des projets miniers et leurs infrastructures, comme les fonderies, ne font pas l’objet d’EI2. Cette lacune dans l’application de la loi supprime alors la possibilité de faire avancer les EI menées par des Autochtones, la prise de décision conjointe et un mécanisme qui pourrait faciliter l’obtention du consentement.
Friends a également fait part de ses préoccupations concernant l’Agence d’évaluation d’impact du Canada, une autorité fédérale, et a insisté sur la primordialité de mettre en place des processus dirigés par les Autochtones. Invoquant la nécessité de susciter la confiance et de disposer de l’expertise et de l’accréditation requises pour lancer un processus qui respecte le droit naturel et les traités, Friends continue de plaider en faveur d’une plus grande inclusion des membres de la communauté autochtone lors des processus d’EI.
Lois provinciales en matière d’exploitation minière et modifications régressives
Les modifications récemment apportées à la loi provinciale sur l’exploitation minière, la Loi sur les mines, par le projet de loi no 71, la Loi de 2023 visant l’aménagement de davantage de mines, ont bouleversé les protections déjà minimales en place pour les droits des Autochtones, l’environnement et les communautés. En raison des modifications, les exigences imposées aux sociétés minières pour couvrir les coûts de nettoyage après la fin des activités minières ont été réduites, en plus de supprimer la nécessité d’élaborer des plans de fermeture détaillés avant le début des activités. De plus, elles permettent aux exploitants miniers, plutôt qu’au gouvernement, d’examiner le caractère adéquat des plans techniques.
Il existe de bonnes raisons pour justifier l’obligation de présenter des plans financiers et de fermeture détaillés dès le départ. L’Ontario est le plus grand producteur de minéraux du Canada, mais c’est aussi la province qui compte le plus grand nombre de mines orphelines et abandonnées, alors que 5 000 des 10 000 mines et plus que compte le Canada se trouvent dans la province. Le projet de loi n°71 a affaibli la norme existante selon laquelle une entreprise devait préparer un plan de fermeture de la mine avant de pouvoir entreprendre sa construction.
Comme Friends l’a fait valoir auprès de l’Assemblée législative de l’Ontario lors de la présentation du projet de loi n°71, ces changements ramènent l’Ontario à une époque où la planification de la fermeture des mines et les ressources financières étaient insuffisantes, ce qui a entraîné le maintien de centaines de milliers de tonnes de produits chimiques hautement toxiques dans le paysage. Les communautés autochtones seront probablement les plus touchées par les répercussions de ces réformes et de la pollution qui en découle. Comme l’a fait remarquer le rapporteur de l’ONU sur les substances toxiques, à l’issue d’une visite au Canada en 2020, « les peuples autochtones en particulier se trouvent du mauvais côté d’un fossé toxique ». C’est dans ce contexte que Friends a demandé le retrait du projet de loi n°71 dans son entièreté.
Il est essentiel de comprendre ce contexte provincial à la lumière de l’intérêt que suscite l’exploitation minière dans la région du Cercle de feu. La société Juno Corp, dont le siège social se trouve à Toronto, est devenue la plus grande détentrice de concessions minières dans la région, contrôlant plus de 17 000 concessions minières (couvrant environ 333 000 hectares), soit plus de la moitié de toutes les concessions dans le Cercle de feu. Au deuxième rang se classe Ring of Fire Metals (une filiale de Wyloo), avec plus de 10 600 concessions minières.
Malheureusement, l’Ontario a délibérément supprimé les possibilités de garantir que les peuples autochtones ont le droit de posséder, d’utiliser et de contrôler leurs terres et territoires, comme l’exige l’article 26(2) de la DNUDPA, et que le consentement préalable, libre et éclairé pour tout projet ayant une incidence sur les terres et les ressources autochtones soit obtenu, conformément à l’article 32(2) de la DNUDPA. Les lois de l’Ontario stagnent quand vient le temps de reconnaître le droit naturel autochtone et de le respecter.
Analyse de l’étude de cas
Actions de sensibilisation, cérémonies et plaidoyer en faveur de la terre
Face aux décisions imposées par les échelons supérieurs et à la quasi-exclusion des décisions ayant des répercussions sur les droits et les terres autochtones, les groupes communautaires sont de plus en plus nombreux à s’exprimer au sujet de l’exploitation proposée du Cercle de feu. Cette hausse est également profondément enracinée dans la terre elle-même.
Un exemple frappant de cette situation s’est produit à l’automne 2023. Friends of the Attawapiskat River a organisé une expédition en canot de plusieurs semaines sur la rivière Attawapiskat, réunissant des jeunes, des Aînées et Aînés de toute la région pour faire valoir leur présence sur la terre et leur responsabilité envers elle. Des jeunes de différentes communautés, dont Attawapiskat et Neskantaga, ont fait un parcours de 386 km sur des cours d’eau ancestraux. Pendant leur parcours, ils tenaient des cérémonies à des emplacements clés. C’était bien plus qu’un voyage en canot. C’était une forme d’organisation cérémoniale.
[Cliquez pour voir en français] ‘ᐆ ᐊᐳᐎ ᔕᓇᐙᑕᔥᑣᐤ ᓂᑕᔭᒨᓇᓂᔫ ᑭᔦᐦ ᑖᓐ ᐁᐦᐃᔥ ᒋᔅᒡᔩᑖᑰᐦᐆᔮᒡ ᑲᔦᐦ ᐁᐦ ᐄᔨᔫ ᑖᐸᐌᐦᑕᒨᓂᐦ ᑲᔦᐦ ᐁᐦ ᐐ ᑲᓇᐌᔩᑕᒫᒡ ᒉ ᒫᒨ ᐊᐸᑕᔥᑖᔮᒡ ᐊᔅᒌ ᑲᔦᐦ ᒉ ᒦᔫ ᐐᒉᐆᑑᔮᒡ᙮’ -ᐯᔭᒃ ᐊᓐ ᑳ ᐊᐹᒡ ᐊᓐᑕ ᐐᒉᐙᑲᓐᐦ ᒌᐃᔥ ᐐᑕᒻ
” Cette pagaie est notre déclaration, en reconnaissance de ce que nous sommes, en tant que peuples des traités, en honorant les promesses de gentillesse, de partage et d’honnêteté, qui est notre force. “
– Membre de Friends
En naviguant sur la rivière et en prenant soin de l’eau en tenant des cérémonies, les participants et participantes ont renforcé leur lien spirituel avec le territoire et ont attiré l’attention sur les enjeux liés à la pollution de la rivière ou aux dommages causés par l’exploitation. Ces mesures terrestres incarnent le principe selon lequel les mesures de lutte contre les changements climatiques ne sont pas seulement une question de politique, mais aussi de relation avec le lieu, faisant état d’une approche autochtone en matière de protection de l’environnement qui mêle activisme et pratique culturelle.
Perspectives et défis de la mobilisation communautaire
Les mesures climatiques prises par les Autochtones autour de la région du Cercle de feu offrent plusieurs perspectives clés.
Tout d’abord, elles démontrent que les lois et les connaissances autochtones sont essentielles pour trouver des solutions viables au problème du climat. Que ce soit par la renaissance des traités en tant qu’ententes vivantes ou par la formation de coalitions, comme celle de Friends of the Attawapiskat River, qui fonctionnent selon les valeurs autochtones, ces actions montrent d’autres modèles de gérance. En raison de la réticence des gouvernements à mettre en œuvre la DNUDPA au moyen de lois provinciales et du manque de respect de l’industrie relativement au principe qu’il faut obtenir le consentement avant de procéder à toute activité d’extraction sur les terres autochtones, un objectif essentiel du travail et des activités de défense des droits de Friends reste de parvenir à un moment et à un endroit où le droit naturel autochtone est respecté.
Ensuite, le mouvement des groupes communautaires autochtones souligne l’importance que revêtent les cérémonies et la guérison fondée sur la terre dans le cadre de l’activisme. En tenant des cérémonies sur des sites endommagés par l’extraction, les protecteurs et protectrices des terres autochtones reconnaissent le traumatisme subi par la terre et confirment leur obligation de prendre soin de ces lieux. Ce processus peut renforcer la détermination de la communauté et présenter un récit moral qui va de pair avec les visions du monde et le droit autochtones. Il rappelle à tout le monde qu’au-delà des graphiques des gisements de minerai et des émissions de carbone, il existe des relations sacrées et des liens spirituels impossibles à quantifier. Si l’évaluation d’impact, en tant que processus, représente un mécanisme qui pourrait permettre de prendre en compte les valeurs sociales et culturelles (et permet également de remplacer les processus de l’État par des processus menés par des Autochtones), elle reste un forum sous-développé pour la prise de décision par des Autochtones en raison de son manque d’application à la plupart des projets miniers.
Après s’être sentis trompés ou exclus pendant des années, les membres de Friends font partie des voix autochtones qui soulignent la profonde érosion de la confiance à l’égard du gouvernement et de l’industrie. Les groupes communautaires, c’est-à-dire les peuples visés par le Traité n° 9, ont une obligation fiduciaire. Au lieu de cela, l’Ontario s’appuie sur des tactiques de division et de conquête pour faire avancer un projet sans le consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause de toutes les communautés.
[Cliquez pour voir en français] ‘ᐊᓂᒌ ᒥᔑᑲᔔᐊᓂᒡ ᐊᔭᐆᒡ ᐁᐄᔥ ᐯᐦᑖᑲᓯᑣᐤ᙮ ᓇᒪᐐ ᐆᔦᔑᓐ ᐐᒌᓀ ᓀᔥᑕ ᐋᑳ ᐐᒌᓀ ᐊᓐᑕ ᐄᔨᔫ ᐄᑕᐎᓂᒡ᙮ ᐐᑖᑲᓐ ᐊᓐᒌ ᑳ ᓂᑑᐦᐆᑣᐤ ᐊᒃᔦᐦ ᑳ ᓅᑕᒣᓭᑣᐤ ᐊᓐᑕ ᐊᔅᒌᒡ᙮’ -ᐯᔭᒃ ᐊᓐ ᑳ ᐊᐹᒡ ᐊᓐᑕ ᐐᒉᐙᑲᓐᐦ ᒌᐃᔥ ᐐᑕᒻ
” Les groupes communautaires ont une voix. Peu importe s’ils vivent dans une réserve ou non. Cela comprend quiconque a réalisé des activités de chasse, de piégeage ou de pêche sur le territoire. “
– Membre de Friends
Recommandations au chapitre des politiques
Recommandation 1 : reconnaître et soutenir les déclarations des Autochtones en ce qui concerne la protection des terres
Parmi les solutions puissantes à long terme pour protéger les basses terres de la baie d’Hudson et de la baie James, il y a la création de régions autochtones protégées et conservées (RAPC) dirigées par les peuples autochtones. Bien que la définition des RAPC varie d’une communauté à l’autre, elle repose souvent sur trois principes clés : (1) elles sont dirigées par des Autochtones; (2) elles représentent un engagement à long terme en matière de conservation; (3) elles font valoir les droits et responsabilités autochtones.
La création de RAPC accorde aux communautés autochtones l’espace nécessaire pour assurer la protection des terres et des eaux. Une RAPC désignerait officiellement de vastes étendues de tourbières et de bassins hydrographiques comme étant protégées du développement industriel, dans le cadre de modèles de gouvernance qui mettent l’accent sur le droit et la gérance autochtones. À la base, ces RAPC reconnaîtraient la nécessité de respecter les droits issus de traités.
[Cliquez pour voir en français] ‘ᐐ ᔮᔫᑕᐆᒡ ᐊᔅᒌᔫ ᐁᐆᒃ ᐙ ᐄᑑᑕᒀᐤ᙮ ᐋᐹᐦᑑ ᒉᐄᒥᔅ ᐯᐄ ᐁᐦᐄᔥᐸᔖᒡ ᒋᑲᐄᔥ ᐲᑲᐸᑕᒨᒡ᙮ ᒋᒃ ᓅᑲᓐ ᑲᔦᐦ ᐊᓐᑌᐦ ᐆᒡ ᒌᔑᑯᕝᐦ ᑲᔩᔥ ᒪᔑᓈᔥᑌᐦᐾᒡ᙮ ᐁᐦᑲ ᒫᒃ ᐄᑑᑕᒥᒣᐦ ᐊᓐ ᑲᔩᔥ ᐐ ᐄᑐᑕᒥᓐ ᑭᔭᐦ ᔖᔥ ᐆᓈᑕᔥᑕᔩᓐ᙮ ᔖᐧᐦ ᑕᔅᑖᑯᐗᐦᐋᐤ ᐆᑳᐐᒫᐤ ᐊᔅᒌ᙮’ -ᐯᔭᒃ ᐊᓐ ᑳ ᐊᐹᒡ ᐊᓐᑕ ᐐᒉᐙᑲᓐᐦ ᒌᐃᔥ ᐐᑕᒻ
« Ils vont tout simplement violer la terre. Il s’agit d’une région dont la taille équivaut peut-être à la moitié de celle de la baie James et qu’ils vont détruire. Cela va être visible sur l’imagerie satellitaire. Une fois qu’on l’a fait, on l’a déjà endommagé. La Terre mère a déjà été blessée. »
– Membre de Friends
En exigeant la protection de la région où le Cercle de feu est proposé, Friends a publié une déclaration qui stipule ce qui suit :
[Cliquez pour voir en français] ᒌᔭᓅ ᑲᔦᐦ ᐅ ᐁᔨᐅᓯᓇᑳᓱᐐᒃ ᒥᔑᑲᔔᐊᓂᒡ ᐊᓐᑌᐦ ᐆᒡ ᐄᔫᐊᑕᔥᑌᔨᑕᒨᐎᓐ 9 ᑲᔦᐦ ᐋᐌᓂᒡ ᐄᔨᔫ ᑳ ᓇᓃᐴᔥᑕᒧᐙᑣᐤ ᑲᔦᐦ ᐊᓐᑐᐌᐄᑖᑯᒡ ᒉᒌ ᐊᓂᔥᑲᒨᔮᒡ ᑲᔦᐦ ᐁᐦ ᐸᑕᔅᒋᓂᒫᒡ ᐁᔥᒃ ᐋᑳ ᐆᔥᑕᑲᓅᒡ ᐊᑕᐦᑑ ᒉᒌ ᐊᑎᔅᒀᑏᐸᐧᐎᒡ ᒉᒀᓐ ᐊᓐᑌᐦ ᒋᑕᔅᒌᓅᒡ᙮
ᐆᔥᑖᐦ ᐆ ᐊᔑᒪᐙᑎᔒᐌᐎᓐ ᐁ ᒦᔫ ᑲᓇᐗᑉᑕᑲᓅᒀᐤ ᐊᒌᐦ ᑲᔦᐦ ᓂᐲᐦ ᐁᐦ ᐄᔅᐸᓂᑳᒡ ᐊᓐᑌᐦ ᐆᕝᐦ ᐊᔥᒌᐃ ᐁᐦ ᓇᓈᑲᑕᔥᑖᑲᓅᒀᐤ ᐊᑕᐯᔨᒋᒉᓲ ᐄᑕᔅᒡ ᑲᔦᐦ ᐊᓐ ᒋᔨᔥ ᐋᐸᑕᓰᑲᑕᒨᒃ ᐊᓐᑌᐦ ᐄᔥ ᓃᔣᔥᒡ ᐋᐴᓂᐦ ᑲᔦᐦ ᒉᒌ ᒌᑲᐙᐸᑕᑲᓅᒡ ᒪᒨ ᐁᐄᔥ ᑲᓇᐗᐸᑕᒃᓅᒡ ᒉ ᒋᐤ ᒦᔫ ᓃᐴᒪᑯᒡ ᐊᒻᑦ ᐄᔨᔫ ᐊᑕᔥᑌᔨᑕᒨᐙᑲᓐ ᒉ ᒦᔫᑲᑑᑕᒫᑐᐐᒃ ᑲᔦᐦ ᒉ ᒦᔫᐊᑎᔥᒉᐃᑕᒨᐦᐄᑕᐐᒃ ᑲᔦᐦ ᒉ ᒪᒨ ᐋᐸᑕᔥᑕᔨᒃ ᐊᔅᒌ
NOUS, EN TANT QUE GROUPE COMMUNAUTAIRE du TRAITÉ NO 9, qui sommes titulaires de droits autochtones et dont la consultation et le consentement sont nécessaires avant toute activité d’exploitation sur nos territoires
FAISONS CETTE DÉCLARATION DE PROTECTION DES TERRES ET DES EAUX en vertu de nos lois naturelles et en tant qu’engagement envers les sept prochaines générations, et en reconnaissance de notre responsabilité partagée de respecter les droits issus des traités, soit être gentils, être honnêtes et partager la terre
Cette déclaration, qui peut encore être signée par le public et adoptée par les alliés, s’apparente à une RAPC, reconnaissant qu’il est impossible de respecter l’engagement du Canada à protéger 30 pour cent de ses terres et de ses eaux d’ici 2030 sans protéger certains lieux, comme les basses terres de la baie James, et que le fait de le faire en partenariat avec les peuples autochtones offre une voie allant de pair avec la réconciliation.
La déclaration favorise également l’atteinte des cibles mondiales en matière de protection de la biodiversité établies dans le récent Cadre mondial de la biodiversité de Kunming à Montréal conclu lors de la COP15. La cible 22 fait partie des cibles qui promettent la promotion du leadership autochtone dans le domaine de la conservation. Elle est essentielle quand vient le temps de fournir de nouveaux points de départ pour la protection des défenseurs et défenseuses des droits de l’homme dans le domaine de l’environnement, en exigeant que les décisions en matière de conservation respectent pleinement et équitablement les cultures et les droits sur les terres, les territoires, les ressources et les connaissances traditionnelles des peuples autochtones. Comme le texte le mentionne :
CIBLE 22
Assurer la représentation et la participation pleines et entières, équitables, inclusives, efficaces et tenant compte du genre des peuples autochtones et des communautés locales aux processus décisionnels, ainsi que l’accès à la justice et aux informations relatives à la biodiversité, dans le respect de leurs cultures et de leurs droits sur leurs terres, territoires, ressources et connaissances traditionnelles, tout en veillant à inclure les femmes et les filles, les enfants et les jeunes, ainsi que les personnes handicapées, et garantir la pleine protection des défenseurs et défenseuses des droits de l’homme en matière d’environnement.
Pour que le gouvernement fédéral atteigne la cible 22, les RAPC (comme la déclaration de protection faite par Friends) représentent un moyen essentiel d’aller de l’avant. La valeur intrinsèque des RAPC pour protéger la biodiversité fait écho à la reconnaissance croissante du fait que les lois naturelles autochtones, qui enseignent le respect et la responsabilité à l’égard des terres, ont été plus efficaces pour protéger la santé des écosystèmes et des espèces que les pratiques de conservation traditionnelles établies par les gouvernements au Canada.
ᒋᒌ ᐄᑐᑕᒃᓅᒡ 2: ᐁᐦᓇᑐᐌᔨᑕᑯᒡ ᐁᐦ ᐐᑖᑲᒡ ᒥᔐᐁ ᑲᔦᐦ ᐆᑖᒡ ᑲᔦᐦᓄᐦ ᒋᔅᒉᔨᑲᒪᐦᐊᑲᓅᑦ ᒉ ᓇᐦᐁᔨᑕᒃ (FPIC) ᑆᐅᒥᔥ ᐊᑕᐦᑑ ᐗᔨᐦᐆ | Recommandation 2 : obtenir le consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause réfléchi avant d’accorder une approbation
Friends a demandé d’urgence un moratoire concernant la prise de décision quant au projet de Cercle de feu, exhortant les gouvernements à mettre fin à la pratique consistant à accorder des concessions minières et des permis d’exploration minière sans le consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause (CPLCC) des titulaires de droits autochtones. Le CPLCC signifie que les communautés autochtones ont la liberté de prendre des décisions (sans contrainte), qu’elles participent à un stade précoce (avant toute décision définitive ou perturbation du sol) et qu’elles sont pleinement informées de toutes les répercussions, avec la possibilité d’accepter ou non selon leurs propres termes.
Pour y parvenir, Friends a déclaré que l’Ontario et le Canada devraient au moins suspendre l’approbation de tout nouveau permis d’exploration minière, de construction de route ou de tout autre projet jusqu’à l’obtention du consentement de toutes les Premières Nations touchées. Les perspectives des groupes communautaires, pas seulement celles des têtes dirigeantes des conseils de bande, doivent être entendues et prises en compte; il faudrait déployer des efforts particuliers pour inclure les Aînées et Aînés, les femmes et les jeunes, dont les perspectives sont parfois négligées dans les cadres de consultation de la Couronne.
ᒋᒌ ᐄᑐᑕᒃᓅᒡ 3: ᐁᐦ ᐃᑕᔥᑌᔪᑕᒃᓅᒡ ᐄᔨᔫᒡ ᐆᐐᔗᐎᓂᐅᐗᐅ ᐊᓐᑌᐦ ᐄᔥᐸᒥᒡ ᐁᐅᒡ ᓇᓈᑲᑎᔥᑕᑲᓄᐐᒡ᙮ | Recommandation 3 : respecter les revendications de souveraineté des Autochtones
Comme corollaire aux recommandations ci-dessus, les responsables des politiques devraient prendre sérieusement en considération l’appel lancé par plusieurs Premières Nations et groupes environnementaux pour l’adoption d’un moratoire concernant l’exploitation du Cercle de feu jusqu’à ce que certaines conditions soient remplies. Parmi ces conditions, comme l’explique Friends, il y a les suivantes : (a) des plans de protection robustes en place pour les tourbières et les cours d’eau sensibles; (b) les besoins fondamentaux des communautés locales (comme l’eau potable, le logement et les services de santé) doivent être pris en compte avant toute « possibilité » minière.
[Cliquez pour voir en français] ᒋᑲ ᑲᓄᐌᔨᑌᓅ ᐊᓐ ᑲ ᓂᔅᑯᒥᓇᓅᒡ ᐊᓐᒌᔥ ᑲᔦᐦ ᓇᐐ ᐊᑐᔥᑐᑦᔐᓈᓐ ᐊᔭᒨᐎᓐ ᐁᐦᐐ ᑲᓄᐌᔨᑕᒧᒃ ᐊᓐ ᑲᔨᔥ ᓇᔅᑯᒧᓈᓅᒡ ᒋᔩᔥ ᐐᑕᒨᒡ ᐊᓐᒌ ᐄᔫᒡ ᑲ ᐄᑕᑕᐗᒡ ᐊᓐᑕ ᐐᒉᐙᑲᓂᒡ᙮
” Nous devons préserver cette harmonie aujourd’hui… Nous essayons de faire passer le message qu’il faut préserver l’harmonie. “
– Membre de Friends
Aucune activité d’exploitation ne devrait avoir lieu dans une région où il n’y a pas de protection environnementale et sociale fondamentale. En adoptant un moratoire temporaire, les gouvernements créeraient un espace pour donner libre cours aux évaluations appropriées, aux processus de CPLCC et à la planification de la conservation. Selon le principe de précaution en matière de politique environnementale, l’absence de certitude scientifique totale (par exemple, concernant l’hydrogéologie des tourbières ou les répercussions cumulatives des mines sur le climat) n’est pas une raison pour reporter les mesures visant à prévenir la dégradation. Dans le même ordre d’idées, le fait de suspendre les activités dans le Cercle de feu permettrait d’éviter que des décisions irréversibles soient prises à la hâte.
Conclusion
L’action de Friends en faveur de la protection des terres et des eaux dans la région du Traité no 9 face au projet d’exploitation du Cercle de feu nous rappelle que les traités sont des promesses vivantes qui doivent orienter les agissements actuels et futurs « tant que le soleil brillera, tant que la rivière coulera, tant que l’herbe sera verte et que les Anichinabés seront là ». Les actions déployées par le groupe communautaire Friends montrent la voie à suivre. Qu’il s’agisse d’un ou une responsable des politiques, d’un représentant ou une représentante de l’industrie ou d’un ou une membre du public, chacun, chacune partage la responsabilité de faire respecter les droits et les engagements issus d’un traité, à savoir être aimable, être honnête et partager.
[Click to see in English] ᐊᓐ ᐐᒉᐙᑲᓂᐦ ᐊᑎᐸᒋᒨᓐ ᐊᐌᐃᔐᑌᐤ ᒉ ᐊᑌᐦᐳᐗᑕᑲᓅᒡ ᐋᒌᔫᓐ: ᒉ ᐐᒋᐦᐊᑲᓅᒡ ᐃᔨᔫ ᐁᐦ ᓈᑭᑌᔨᑖᒃ ᐊᔅᒋᔫ ᑲᔦᐦ ᐊᓐ ᒉ ᐊᑕᒋᔐᔨᑕᒨᐦᐄᐌᑦ ᐊᓂᔫ ᐐᔑᐌᐎᓂᐦ ᐊᔅᒌ ᐆᒡ ᑲᔦᐦ ᒉᒌ ᐊᑦᔥᑌᔨᑕᑲᓄᐐᒡ ᑲᔦᐦ ᒉᒌ ᓅᑲᑕᐦᑲᓄᐎᒡ ᐁᐦ ᓇᓈᑲᒋᔥᑕᑲᓄᐐᒡ ᒋᔅᑕᔅᒋᔫᓂᔫ ᑲᔦᐦ ᓃᐲᔫᐦ ᑲᔦᐦ ᒋᔅᑖᐎᓂᔫ ᐄᔥᒌᔗᐆᒡ ᒉ ᒥᔫ ᑲᓇᐙᐸᑕᒀᒡ ᐊᓐᑌᐦ ᓃᔥᑕᒥᒡ᙮
L’histoire de l’organisation Friends of the Attawapiskat River sert d’appel à l’action : soutenir les protecteurs et protectrices des terres autochtones, défendre les lois naturelles et leur respect, et reconnaître que la protection des terres, de l’eau et des communautés est étroitement liée à la protection de notre avenir collectif.
1 Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, L.C. 2021, ch. 14, art. 4(a)
2 Voir les articles 18 à 25 du règlement désigné fréquemment par le terme « Liste des projets », Règlement sur les activités concrètes, DORS/2019-285.
Politique climatique se fondant sur la protection de l’orignal et la gouvernance anichinabée | Moz Kipiwa-n Acitcj Anishnabe Onakinagewin Oja Aki
The Anishnabe Moose Committee (AMC) is a grassroots collective of people from several Anishnabe (Algonquin) communities working directly with our communities to protect the moose, land, and culture. The authors of this case study are Shannon, the coordinator of the AMC, and Jaimie, the Land Studies coordinator for the AMC. We are writing this case study as individuals representing perspectives from the AMC and Anishnabe knowledge.
Rooted in traditional governance, AMC prioritizes community-led decision-making, knowledge-sharing, and land-based education. AMC’s work began in response to the alarming decline of moose populations in La Vérendrye Wildlife Reserve. However, Elders emphasized that moose decline is an issue that must be addressed as a nation. These efforts quickly expanded to all Anishnabe communities across the Ottawa River watershed—our traditional territory.
Throughout 2022, we held community workshops in nine Anishnabe communities, gathering insights from Elders, hunters, and land users. This work culminated in a preliminary report released in 2022 (available here). Climate change, forestry, and over-hunting were identified as the main drivers of moose decline in and around La Vérendrye Wildlife Reserve. Community-driven solutions were also proposed to revitalize the moose population. Since then, the AMC has continued working with communities and Elders to follow through on the recommendations that come directly from communities.
[Click to see in English] Wedi ojabigin Moz Anike-Niganiziwog kagi-ojibegawatcj eja nisistimatcj Aki Inakonigewin kija kipwa-nag kina moazag.
This case study provides an overview of policy lessons learned from the AMC’s work and recommendations for advancing climate policy that protects the moose both within and beyond the Ottawa River watershed.
Mozag kijenenimanan, tedago nogom tija nanegadjitog | Moose are our relatives, and they are in trouble
Moose have taken care of Anishnabeg since time immemorial. They have kept us alive, providing healthy food, shelter, mukluks, baby clothes, moccasins, and drums made from the hides. Moose have given us ceremonies, education, stories, and economies. Moose are part of our way of life; they protect and provide for us. They are essential to Anishnabe food sovereignty, sustaining our culture and families for generations. Many of our people still rely on moose as a traditional food source, especially where access to grocery stores is limited.
Aja anawadj te mozag, mi kina awesh ejasewag aki kag. Moose tabendagozi nokamig. Apinamo mitikgon keja nitawgeyasitcj, keja wesinitcj, acitcj onadindan keja mishanig eja mitogog kija tikanaweg. Kina ka-mitikenaniwag, eja anikej matikogoje acitcj aki ana kwetamigog odanimegon kina mozag.
However, moose are declining in Anishnabe territory, as they are elsewhere in Canada1. Moose are a part of the forest ecosystem; they rely on young forests and aquatic plants for quality food and on mature forests for shelter. They live in colder climates and need large areas to thrive. Industrial forestry pressures, sport hunting, and climate change have placed immense strain on moose populations.
This impacts Anishnabe culture and food sovereignty. Furthermore, Anishnabeg continue to face racism, discrimination, and harassment on our territory from sport hunters and wildlife agents, which restricts our cultural safety with our families.
This is the context in which our work began. Elders and Land users are concerned about the health of the moose population across the territory in La Vérendrye Wildlife Reserve in western Quebec2. The moose population in La Vérendrye has never been comprehensively studied, and from our perspective, has not been subject to effective moose management since its inception. Land users and Elders have already noticed the alarming decline in moose population, and even the provincial government’s surveys estimated a sharp decline in the past decade3. Following a second year of grassroots, community-led organizing, a temporary two-year moratorium on sport hunting was obtained in La Vérendrye at the beginning of 2021, with subsequent years being dependent on the result of studies. When it became apparent that no studies were being undertaken by the province in a comprehensive or inclusive way, the AMC was formed to take up this important work for ourselves.
Moz eja kikindagozag ena pagidjishewog | The cause of moose decline
Moose are suffering due to colonialism. Multiple pressures—including sport hunting, industrial logging, unsustainable management practices, and climate change—negatively impact moose in our territory. However, the underlying issue and throughline is the continuation of colonial practices and policies, which undermine Anishnabeg’s ability to steward the land moose depend on, as we have done since time immemorial.
Industrial logging reduces the quality of moose habitat. While initially, the moose return to the cut area to feed, they are more exposed and vulnerable in these open areas. Furthermore, these cutblocks do not provide food for the moose in the long term. Reducing the amount of forest cover also reduces the important shade and cover habitat they need during the hot summer months and impacts the forest’s ability to adapt to climate change. It is unethical, and goes against Anishnabeg knowledge and ethics, to alter moose habitat into small patchworks of forest, removing the space they need to fully thrive.
Moose are also affected by Quebec and Ontario moose management policies, which focus primarily on economic benefits of selling moose tags and outfitting packages, and prioritize sport hunter access, rather than sustaining a healthy population4. Ontario sport hunting functions with a lottery system, limiting the number of moose tags sold per year for a given area. Through this mechanism, there is some measure of control on the sport hunting pressure. Quebec sport hunting does not limit the number of tags sold per hunting zone, but instead manages which segment of the moose population (e.g. males, females, or calves) can be taken from a given hunting zone, with the objective of achieving a target moose density for the region.
It is clear that both of these systems are failing. The moose density in La Vérendrye sits below provincial targets for this area. Furthermore, neither system prohibits wasteful practices like discarding parts of the moose, collecting only the head of the bull moose as a trophy, or not retrieving moose that have been shot with a bow and arrow. Unfortunately, as reported in the AMC’s preliminary report, these wasteful and unethical behaviours, which go against Anishnabeg values, are often observed in the Algonquin territory.
Mozag kipiwo eja agwamtamigag eja tikanan acitcj nogom ana kitchi kijidek. Kitchi Ogima kan ogizgamasin adi mozan eja madizinjin. Kan obamidinindisin adi keja minajagin awesisan keja mino-madizinjin.
Moose are anticipated to be even more vulnerable in the context of climate change. Moose need shade in the summer to cool off. The shade habitat that forest cover provides becomes even more critical during the longer and hotter summers predicted as a result of climate change. Provincial forestry policies do not account for the needs of the moose and the larger ecosystem in their forest management plans.
Winter ticks, tiny parasites that latch onto moose, are already present, even more so in cutblocks, and are predicted to increase in a warming climate. These parasites cause discomfort in adult moose, causing them to scratch themselves to the point of losing fur, which keeps them warm in the winter. Young moose are more vulnerable to die from winter ticks than adult moose.
Additionally, as the deer population moves northward under a changing climate, moose will be increasingly exposed to the parasites that deer carry, such as brainworm, which is fatal for moose.
Agonen ke postowig ki-tcimankag? Kan Kitchi-ogima o’wesagindamowin kida tagosonan aji | What do we want to bring with us in our canoe? Solutions cannot perpetuate colonial harm
The solutions that first come to many people’s minds when discussing the decline of the moose population are either 1) creating a better management plan, which is what we initially had set out to do, or 2) creating co-management, where there is collaboration between Indigenous Peoples and colonial governments regarding wildlife management decisions. From our perspective, these options are not real solutions.
First, a wildlife management plan cannot in itself address the imbalance of power that colonial governments impose on our Lands. Second, we cannot enter into collaborative agreements if trust is not established at the root.
As described in detail in the following section, the decline of the moose population is a symptom of broader systemic issues resulting from imposed colonial government control on our Lands. To be effective, solutions would need to address that. As one of AMC’s members, Anida Decoursay, offered, “If we think of someone who must pack their canoe for a voyage to a new place, they cannot fit everything in their canoe; they must be selective in what they choose. As a nation, we must decide how we will pack our canoe for the times of climate change ahead. Do we want to bring a moose management plan, a colonial policy tool, with us on this voyage? Or would we rather bring true systems change and Anishnabe governance revitalization with us?” Our solutions must address the root causes. Colonialism is at the root of the moose decline in our territory, so we must find decolonial solutions and ensure future generations inherit a healthy land.

When the Anishnabe Moose Committee began our community-led research process, we were working with the idea of creating and implementing an Anishnabe Moose Management Plan, which would be shaped by what we heard from communities. The solutions brought forth by communities included better wildlife regulations and enforcement, leadership and education for the next generations, inclusion of Anishnabe laws, Elders gatherings, and whole-nation information sharing and decision-making. Additionally, a longer, five- to 10-year moratorium with a comprehensive study on the moose population is needed. These are elements of traditional governance that are explained in more detail below.
Collaborative management, or co-management, is not an acceptable solution for our people either, because of the ongoing legacy of distrust with provincial wildlife departments that have broken agreements with our nation in the past. Elders have shared with us stories of historical agreements with colonial governments. Again and again, the agreements which we made with them were violated. One recent example of these broken agreements specifically relates to the moose in La Vérendrye Wildlife Reserve, which is now the largest wildlife reserve in Quebec, with over 4,000 lakes and rivers and two huge hydro reservoirs. From the 1950s until the 1970s, La Vérendrye was a protected area. In 1964, the Quebec government began a pilot project. It was agreed with the community of Barriere Lake that this would be a five-year pilot project where they would open up the park for the hunting of moose. They said this would be for only five years. At the time of agreement, they agreed that non-Indigenous hunters would need to have an Anishnabe guide during their hunt. After five years, when the pilot project was supposed to end, Quebec changed its position.
They then said that they meant five years of hunting bulls, followed by five years of hunting females and five years of hunting calves, thereby extending this “pilot project” to a total of 15 years, which was not the agreement the community of Barriere Lake had agreed to in 1964. At this point, Quebec also started to increase tourism, bringing in wealthy Americans to hunt and fish on the territory. They established a presence in La Vérendrye. They established game wardens. During this time, they observed all the pine species, white birch, spruce, and poplar, and saw all the wealth within the park, including moose, foxes, rabbits, bears, partridges, beavers, wolves, walleye, northern pike, lake trout, bass, and sturgeon. By 1979, La Vérendrye became a Réserve Faunique (“Wildlife Reserve”), which removes protections from forestry and hunting. In the early 1980s, Anishnabe guides were used as fishing and hunting guides but that practice was dropped in the early 1990s. The original five-year pilot project agreement was violated. Clearly, Quebec had no intention of honoring that agreement and continuously encroached on La Vérendrye in the following decades without the consent of the Anishnabe people.
This was not the first agreement that was broken. During the time of the fur trade and wars between the English and French colonists, our People began to observe resources becoming depleted, as they began to dig for gold and cut various trees. It became abundantly clear that inherent to the colonial presence was the extraction of our resources and destruction of our lands, waters, and communities.
To address this, an agreement was made and ratified through the Hudson Bay wampum belt. Through this treaty, it was agreed that they would not harvest more than one kind of tree and could not dig more than three feet deep in the ground—as long as the sun shines, the rivers flow, the leaves fall, and the wind blows. That is what the agreement said. We knew such limits would be necessary. But they violated that treaty, generation after generation, time and time again. Government and industry have been voraciously extracting resources from our territories, taking from our communities and lands and harming the moose, and offering very little in return.

Kina Kitchi-ogima eja wejigedj acticj eja nagok aki-ni panama nisitagon adi awa eja minosek kija-wedokwagantcj mozag. Kan kidatagosonon minosodiwin e’ja pagejishiwatcj mozag acitcj keja mino-madizitcj kewin mozag mojag.
The living legacy of colonialism and its ongoing consequences for our territories and our communities must be understood and taken into account when we seek solutions for the declining moose population. If not, we will simply perpetuate the same unbalanced and unjust power dynamics of colonialism.
Mitchogozi odanakonagewin odimbabdon Anishnabe Inindamowin eja kijagabidag Od’aki | Colonial laws and policies disrupt our traditional ways of caring for the Land
In Anishnabe territory, we cared for the land through our family territory system, which allowed us to closely observe and monitor a large territory. Each family would share that knowledge with the rest of the nation during an annual gathering. These yearly gatherings are part of our traditional governance, where the state of the Land was discussed, and any needed changes were made through a consensus process. Colonial government assimilatory and genocidal laws and policies aimed to remove Indigenous Peoples from exercising our sovereign rights on the territory through the implementation of the reservation system, the Indian Act, and residential schools, among others.
The Band Council system is a colonial tool created through the Indian Act that usurps traditional governance systems and replaces them with an ineffective top-down administrative structure. It creates division and conflicts within our communities and is a barrier to making decisions as a nation. Our traditional Indigenous governance is foundational to caring for our territories as sovereign people, but it cannot thrive under current policies that function through the Indian Act governance system and outright ignore our sovereignty.
Industries like mining and forestry work through Indian Act structures to extract natural resources within our territories and drastically alter the quality of the whole landscape. In Ontario and Quebec, provincial ministries do not involve Indigenous nations regarding wildlife management decisions (other than those with modern treaties in northern Quebec).
Colonial laws and policies have disrupted our traditional governance and ways of caring for the Land. They do not honour nation-to-nation relationships, such as they were understood in the original treaties. The strength of our traditional governance is tied to the health of the Land. It is our responsibility as Anishnabeg to fulfill our role as caretakers of our territory.
Aki eja kwikitamigog kina kiga animegomin | Climate change affects us all
At the same time, we must acknowledge that moose populations are declining in other territories as well. In Manitoba there is a serious concern about the state of the moose population, and in Mi’kmaq territory (Cape Breton), there has been a severe moose decline. While we cannot speak to the specific causes of the declines in other territories, it is clear that climate change is a common threat. It must therefore be addressed collaboratively. We must renew respectful nation-to-nation relationships to effectively work through climate change solutions. To do so, we need to return to the sacred treaties that mean the most to First Nations people.
Oshi Nigansodewin kija ojitowig Aki eja Kwiktamigog nogom | Treaty renewal under climate change
The original sacred treaties, such as those created with wampum belts, honour traditional governance. While many of these agreements are ignored or forgotten by colonial governments, they are the only way to begin repairing the relationship and to build respectful nation-to-nation approaches. When these original treaties were made, the sovereignty of Indigenous nations—that is, the recognition of Indigenous rights to self-govern and manage our affairs and territory—was respected. Our responsibilities as caretakers of the Land were embedded within them. Treaties ensured peace: peace for the signatory nations, peace for the territory, peace for the Land and peace for all other-than-human beings.
Original treaties between Indigenous nations and European settlers were made when forests were healthy, moose were abundant, and the climate was stable. Even so, environmental clauses were incorporated into the treaties such as within the Hudson Bay wampum. The current climate crisis creates a new urgency for renewing these original sacred treaties to address our shared responsibilities to address climate change. Returning to the original intent of the treaties now would require us to incorporate specific climate change considerations and the specific industrial activities that contribute to climate change, like forestry and the extraction of non-renewable natural resources. True climate adaptation should guarantee Indigenous decision-making about Land use within our territories under our traditional governance systems.
These treaties were forgotten; the accountability toward the treaties and responsibilities were forgotten because they were not revisited, as they were supposed to have been, every two years. This process of accountability was called “polishing the chain”. If this accountability process is maintained, renewed treaties can hold the promise of reversing climate change.
The ultimate goal of treaty renewal is ensuring that seven generations from now will inherit healthy lands. Restoring traditional governance allows for more space for Indigenous rights, language, culture, and ceremony to flourish on the territory. This will lead to healthier moose populations and better climate solutions for all. If we can achieve peace with each other through renewed treaties, then we will have achieved true reconciliation.
Oshki Nigansodewin nogom ta minsidjiade Anishnabeg odinakinagewin keja mikimatcj Aki-Tcojojonam kija wedokwaganitcj. Tadagon mino ijitigewin kija mamikikadeg aki keja minomadizitcj acitcj kina Wabanog Anishnabeg oda shawindana aki onakinagewin. Anish adi keja majitayag bin?
Renewed treaties would restore Indigenous governance systems that allow for the nation-to-nation relationship that is required to find true climate policy solutions. Furthermore, unity within the Anishnabe (Algonquin) nation and other eastern Indigenous nations would strengthen climate action. We acknowledge that this is no small task. So, how do we get there?
Eshpin kijigabidameg nigansodewin, panama nitim Anishnabe eja kendik aki kida mamwisemagin | The first step toward treaty renewal: A community-led forum for knowledge sharing
The revitalization of treaties needs to be community-led, because it depends on the knowledge holders, where treaty is held by community. Elected leadership and colonial governments need to play a part as well, by providing space to have these discussions. Building and bridging understanding is paramount to start repairing the trust necessary for reconciliation and treaty renewal.
Kija tagog nisistemowin oja kina kabi-ijaweybig aki kag. Kina Wabinog Anishnabeg ta-mamwisewag kija tabajamog megis kikendamowin keja wabidameg ishkwag kaja be inakonigewag Anishnabeg weshkitcj (“Keko masigetcj Kizis, Keko nibish nitagog, Keko nodin eh tanoweg acitjc keko nibi pimidjwog”).
To build a common understanding of historical sacred treaties, we must create a sacred space for discussion and knowledge-sharing. We suggest a large multi-day forum, where the community members and knowledge holders of the eastern Indigenous nations gather. Each nation would have the opportunity to recite the treaties they hold, and the conditions under which they were first made (“as long as the sun shines, the wind blows, the waters flow, and the grass grows…”).
In this context, traditional governance takes up the most space; traditional leadership and governance come from Anishnabeg, it comes from the people, it is not a top-down approach. Elders and knowledge keepers must be given the appropriate recognition and respect regarding the knowledge they have of the environment and history and provide the spiritual guidance that is needed to restore our climate.
Elected leadership and colonial governments can take place as listeners and learners in this space. Giving the space to knowledge holders honours the community-led ways of traditional governance. This mark of respect is owed to communities. This would open dialogue between knowledge holders and elected leadership. It is an opportunity for knowledge holders and community members to voice their concerns, visions, and guidance. We expect that this knowledge sharing would need to take place over three days.
This would ground the gathering in ceremony with an understanding of the original intent of the treaties, which creates a greater awareness of how the environmental and social conditions have changed and must be taken into account in modern times.
Following this first period of knowledge-sharing, community members can decide their own path and follow their own protocols regarding treaty renewal. This also provides an opportunity for the elected leadership to be accountable to the wishes of their people. Together, each nation can build their own recommendations and solutions for treaty renewal under climate change. This forum is a first step, an opening, that allows us to build understanding before deciding on the next steps.

Crown governments can get involved in this process by facilitating the funding for this forum, attending and listening, and supporting the community-led treaty research and discussions that will take place before and after the forum. Community-based treaty research allows for communities to discuss treaties within their own nations before entering into discussions with others. In-community discussions will follow the forum, and it will be important to support that momentum and be accountable to each other and the knowledge learned during the forum.
Conclusion
This work started when Elders and Land users warned us about the moose decline. Protecting the moose led us to the bigger questions about how we all care for the land. Moose are our relatives that have taken care of us since time immemorial. Their decline is a warning that we must return to balance.
Treaty renewal must be transparent and inclusive. This means that everyone should have a voice, especially the people who live closest to the Land and see what’s really happening. We need to listen to the grassroots, to the ones who feel the changes in the water, the air, and the animals. We need to talk about responsibility to protect the land, the water, the animals, and each other.
Our communities have always known how to live in balance with the land. We carry that knowledge in our stories, in our ceremonies, and even in our dreams. The systems that hurt the land also hurt our communities. Logging, mining, and dams might create money, but they also destroy the homes of the animals and the health of our waters. These are not peaceful ways.
There is no peace in extraction, no peace in deforestation. These acts harm the animals and the people who have always lived in relation with them.
We know that energy and building homes are necessary, but we also know that change is needed. We must be willing to leave behind destructive ways and choose a new path that respects the Earth.
As Anishnabeg, we’ve faced colonization, language loss, and residential schools. These things disconnected us from who we are. But we’re still here. And we still carry the knowledge we need to rebuild. That’s what treaty is really about: returning to who we are, returning to our laws, our clan systems, our creation stories, and our responsibilities. Treaty is about restoring peace: peace for the land, peace for animals, and peace for our people. What we do now will shape what’s left for the next generations. We must choose wisely.
1 E.g. Manitoba and Cape Breton.
2 Anishnabe Moose Committee. November 2022. Anishnabe knowledge and governance for the protection of the moose populations in and around La Verendrye Park. Preliminary report from the Anishnabe Moose studies.
3 Inventaire aérien de l’orignal de la réserve faunique La Vérendrye réalisé à l’hiver 2020 Résumé des résultats. https://mffp.gouv.qc.ca/documents/faune/RA_inventaire_orignal_RFLV_hiver_2020.pdf
4 Honour’s thesis report led by Ken Downe. https://anishnabeanikiwin.wordpress.com/wp-content/uploads/2024/11/amc-newsletter-november-2024-2.pdf
Composer avec les changements climatiques dans l’écosystème économique autochtone | Kwukwun’utstuhw ‘uw ‘eeye’qtum ‘u thu kw’atl’kwu ni’ ‘u thu hwulmuhw telu’stuhw tumuhw
Aperçu
La toile complexe que forment la pêche commerciale, les changements climatiques et les pratiques culturelles autochtones exige une compréhension contextuelle. Pour favoriser la durabilité, il est essentiel de reconnaître l’influence qu’exercent ces éléments les uns sur les autres. Les impacts de l’industrie de la pêche, dont la surpêche, soulignent qu’il est urgent d’adopter des approches de gestion intégrée.
Ni’ tsetsul’ulhtun ‘uw’ ‘eeye’qtun ‘u’ tthu kwa’atl’kwa, sis uw hwulmuhw snuw’uy’ulh T’a’thut ‘un’ tl’leem’ ‘u ‘un stl’i’ ‘u statul’stuhw. Tspit tthu eeye’qtum tumuhw, eeye’qtum sul’utul’sht’e ‘un stl’i’ huli’stuhw. Tthu tsetsul’ulhtun, hun’utum industry, nan ‘uw tsesul’ulhtun. Tspit ‘un stl’i ‘u’ tu thi’maat shqwaluwun tetsul.
Si l’on ne tient pas compte de ces défis interreliés de manière globale, cela peut entraîner l’effondrement de populations de poissons vitales et la dégradation de paysages culturels et écologiques. Les enjeux sont considérables, des écosystèmes et des modes de vie entiers étant menacés, ce qui démontre la nécessité d’avoir des solutions exhaustives et concertées.
ni’ ‘uwu kwus sul’ul’thuts, ‘ithatul’stuhw shqwaluwuns, ‘i’ nem’ yixw ‘u thithat stseelhtunhwu’alum’sis ‘uw ‘uwu stsi’elh hwulmuhw ‘i tumuhw. ‘i sielh’stuhw ‘i hwtl’i kws mukw tumuhw, mukw’ulup wawa’ stl’eluqun kws hulit, le’lum’stamshnustl’i’ ‘u q’ishintul’ shqwaluwun.
En luttant contre les changements climatiques et en tenant compte des pratiques de l’industrie et de la durabilité environnementale en même temps, on dispose d’une belle occasion de rétablir et d’améliorer la biodiversité marine, de renforcer les économies autochtones et de maintenir les pratiques culturelles. Cette approche globale, qui prend en compte le concept fondamental nuu-chah-nulth de tsawalk (qui signifie « un »), peut accroître la résilience des communautés et des écosystèmes.
thuyt thu tumuhw, thuyt thu hunutum industry paractices, kwutst ts’i’ts’uwatul shqwaluwun ‘i q’ushintul thuyt thu tumuhw, ni’ thithat kw’in ‘u thuyt thuw’mukw kwatl’kwa, kw’am kw’umstuhw, thu hwulmuhw hunutum economies and hakwushus snuw’uyulh. Thuw’ mukw’ nem’, lumstuhw ‘u snuw’uy’ulh ‘u thu Nuu-chah-nulth snuw’uy’ulh 9meaning ts’i’ts’uwatul), nem’ kw’amkw’um thuw’mukw’ ‘i thu tumuhw.
Pour y parvenir, il faut établir un front uni mené par les dirigeants et dirigeantes autochtones, réunissant les gouvernements, les organisations environnementales et l’industrie de la pêche, afin d’élaborer et de mettre en œuvre des stratégies permettant de relever l’ensemble des défis. Cela comprend une réforme des règlements touchant la pêche afin d’empêcher la surpêche, le soutien aux projets de conservation menés par des Autochtones ainsi que la promotion de pratiques qui réduisent les impacts environnementaux des opérations de pêche. En appuyant collectivement des pratiques durables qui tiennent compte des liens complexes entre les changements climatiques, le patrimoine culturel et la pêche commerciale, nous pouvons mettre en place des pêches résilientes au climat pour les générations futures.
‘uy’eey’ ‘u nu’stli’ ts’i’ts’uwatul shqwaluwun ‘imushstuhw ‘u tthu shusi’eem, ‘e’muqth kwun’atul hun’utum governments, hun’utum governments, ‘i hun’utum fishing industry ‘u ‘eey’ ‘uy shqwuluwun ‘i thi’mawt thuytum tthu tumuhw. Ni’ ‘eeye’qtum’ ‘u tsrtsul’ulhtun snuw’uy’ulh ‘u ‘unuhw thuw mukw tsetsul’ulhtun, ‘i hwulmuhw thuytum, ‘i snuw’uy’ulh ‘u kwu’elh xwul ‘u qul’ shqwaluwun ‘u tsetsul’ulhtun’ew’t. Ni’ ‘a’luxut ‘eey’ ‘uy shqwaluwun snuw’uy’ulh tuni’ hwqwel’qwul’i’wun ‘u ‘i’thatul’stuw tumuhw ‘eeye’qtum’, ‘u tthu shtun’ni’iws snuw’uy’ulh ‘u tthu tsetsul’ulhtun’ew’t, tst thuyt ‘u tl’uxw ‘u tthutsetsul’ulhtun’ew’t ni’ ‘u tthu yu’e’wu shhw’a’luqw’a.
La présente étude de cas porte principalement sur les possibilités et les défis qui se présentent aux Quw’utsun Kw’atl’kwa Enterprises (QKE), une société de pêche commerciale de premier plan appartenant aux Cowichan Tribes et exploitée par celles-ci à Cowichan, en Colombie-Britannique. En outre, elle met en évidence les stratégies d’adaptation et fait des recommandations sur les moyens d’atteindre cet objectif.
Ni’ hwtetulum’ qe’is snuw’uy’ulh ‘u tthu qe’is tl’uxw shul’e’shlh yunu’as Quw’utsun Kw’atl’kwa Enterprises (QKE), ‘u shhwuhwi’wuqun ‘u tthu tsetsul’ulhtun’ew’t hakwush thun Cowichan Tribes ‘i ‘e’ut Cowichan B.C., lumstalu qe’is snuw’uy’ulh ‘i ‘aalhtum qwul’qwul sht’e ‘u thuyt thu tumuhw.
Présentation de Quw’utsun Kw’atl’kwa Enterprises
Quw’utsun Kw’atl’kwa Enterprises (QKE) est une société de pêche commerciale chef de file qui appartient aux Cowichan Tribes et qui est exploitée par celles-ci à Cowichan, en Colombie-Britannique. Le nom Cowichan est la version anglicisée de shkewetsen, qui veut dire « se prélasser au soleil ». L’aîné Abel Joe explique que le nom vient de personnes qui ont vu une grenouille se prélasser au soleil sur le mont Tzouhalem (Joe, 1977). Les territoires des Cowichan Tribes ont une superficie de 2 389 hectares (5 903 acres) dans 9 réserves et 7 villages traditionnels : Quamichan (Kwa’mutsun), Comiaken (Qaumi Yiqun), Koksilah (Ulaelu), Somena (S’amuna’), Clemclemaluts (Lhumlhumuluts’), Khenipsen (Xin Ipsum) et Cowichan Bay (L’ul Plus) (Cowichan Tribes 2021). Les QKE font partie intégrante du tissu économique et culturel de ces communautés.
Quw’utsun Kw’atl’kwa Enterprises ni’ ‘u shhwuhwi’wuqun ‘u tthu tsetsul’ulhtunew’t swe’s ‘i nem’ hakwush ‘u Cowichan Tribes, ni’ut Cowichan B.C. ‘u thu sne’ Cowichan ni’ ‘u shwulinitum’a’lh nu’ sne’ ‘u shquw’utsun, nilh “basking in the sun”. Sul’xween Abel Joe qwul’ sht’e ‘u Sne’ tun’untsu hwulmuhw lemut ‘u tthu wuxus shquw’utsun ‘u thu Mount Tzouhalem (Joe, 1977) Tun’ ni’ tsun ‘utl’ Cowichan Tribes sis hun’utum 2,389 hetares (5,903) ni’ untsu toohw tumuhw ‘i tth’a’kwus hwulmuhw tumuhw: Kwa’mutsun, Qwum’yiqun, Xwulqw’selu, S’amunu, Lhumlhumuluts’, Xinupsum, ‘i Tl’ulpalus (Cowichan Tribes, 2021). QKE ‘u thi’mawt ‘u yuse’lu telu ‘i hwulmuhw snuw’uy’ulh ‘u tthu tumuhw.
Pendant des millénaires, la rivière Cowichan a été un réseau vital pour les Cowichan et les peuples salish voisins. Elle a servi de pierre angulaire de leur régime alimentaire, de leur économie et de leurs cérémonies sociales. Les pêcheries de la rivière, historiquement gérées par des systèmes complexes de barrages, n’étaient pas de simples mécanismes de récolte, mais des outils de conservation vitaux, assurant la pérennité des populations de saumons pour les générations futures. La productivité remarquable de ces barrages a soutenu de vastes réseaux de commerce dans les territoires des Salish, illustrant une gérance écologique sophistiquée qui a perduré au fil du temps (Atlas et coll. 2021).
Tu Quw’utsun sta’luw’ ‘uw’ nilh ‘u hulitham’sh ‘ tthu Quw’utsun ‘i hwulmuhw mustmuhw tsi’tsulhuqwt ‘u ‘apun nets’uwuwuts sil’anum, tl’liim’ ‘u ‘uy ‘ulhtun, qtulstuhw ‘i ‘aw’kw’ul’muhw. Tthu sta’luw’ tsetsul’ulhtun, yathulh yaays ‘u thu shxetl’, ‘uwu’ kwus ‘a’luxut yaays ‘i’ skeyxutssum nustl’i’ ‘u thuyt thu tumuhw ‘i stseelhtun ‘e’muqt ‘i’ yuluw’en shhw’a’luqw’a’. Tu qux kwunnuhw ‘u thu shxetl’ yath ‘u thi ‘uya’qtul mukw stem u thu hwulmuhw mustimuhw tumuhw, lumstuhw snuw’uy’ulh ‘u tu lemut ‘u tthu tumuhw mukw stem ‘u thu shtun’ni’’iws. (Atlas et al. 2021).
Aujourd’hui, alors que les QKE doivent composer avec les pressions cumulées des changements climatiques et de la récolte commerciale, elles évoluent dans un contexte marqué par des défis environnementaux et économiques qui menacent ces pratiques traditionnelles. Le principe de l’approche à double perspective (Bartlett et coll. 2012, p. 335), que préconise l’aîné mi’kmaq Albert Marshall, oriente l’entreprise, tandis qu’elle intègre des modes de connaissances autochtones et des connaissances scientifiques occidentales. Cette stratégie d’adaptation cherche à établir un équilibre entre la durabilité environnementale et la croissance économique, en évaluant des solutions novatrices, comme l’aquaculture, l’écotourisme et l’énergie renouvelable afin de tenir compte de l’épuisement des stocks de poissons et de l’évolution des conditions écologiques.
uyqtul ‘u tl’uxw yaays ‘u tsetsul’ulhtun ‘u thu ‘eeye’qtum kw’atl’kwu ‘i hunutum commercial Harvest, ‘u kwunnuhw thu tumuhw sxuxil’ ‘u ‘eeye’tum’ tsetsul’ulhtun ‘i ‘aaya’qtul’stuhw, qul shkwaluwun ‘u hwulmuhw t’a’thut. Tu thu’it ‘u yuse’lu qulum le’lum’nuhw (bartlett et al., 2012, p. 335) sqwi’qwul ‘u Mi’kmaq sul’hween Albert Marshal, lumnuhw ‘u ‘aya’qtul hikwut hwulmuhw hwqwel’qwul’i’wun swe’ ‘u thu hwulmuhw snu’uy’ulh. Kw’i ‘eeye’qtum snuw’uy’ulh lemut tu thu’it thu thu’it thuyt thu tumuhw ‘ehwe’t ‘uya’qtul thithat, lum’stuhw qe’yes snuw’uy’ulh tuni’ ‘u tu hunutum aquaculture, eco-tourism, ‘i renewable energy ‘u hwu’uhwin stselhtun ‘e’muqt ‘i ‘eeye’qtum kw’atl’kwu.
Quw’utsun Mustimuhw
Sur le plan historique et aujourd’hui, les Quw’utsun Mustimuhw (peuples Cowichan) occupent une superficie considérable sur l’île de Vancouver. Leur territoire traditionnel, riche en ressources culturelles et écologiques, s’étend sur plus de 375 000 hectares dans une grande partie du sud-est de l’île de Vancouver et du fleuve Fraser, comme le montre la figure 1, englobant des secteurs clés le long de la rivière Cowichan et de la baie de Cowichan (Cowichan Tribes 2021). Les Cowichan se déplaçaient énormément dans l’ensemble de leurs territoires.
tthu quw’utsun mustimuhw, ni’wulh hith ‘i kweyul, tun ni’ tsun utl’ huy ‘u Vancouver Island. Ni’ thu tumuhws, thi’ mawt shqwaluwun ‘i qtul’stuw, tetsul. ‘utl’ huy ‘u hunutum 375,000 hectares ‘u huy ‘utl’ tl’itl’up s’i’a’lum’iw’s Vancouver Island ‘i ‘u Fraser sta’luw, lum’nuhw ‘u figure 1, sel’ts’t ‘u thithat ‘uw tsetsuw’ tthu Cowichan sta’luw ‘i tlul’pulus (Cowichan Tribes, 2021). Tumuhws.

Avant les contacts avec les colons européens, on estime que les Quw’utsun Mustimuhw comptaient 15 000 membres (Cowichan Tribes 2021), ce qui fait état de l’abondance des ressources dans la région. Cette population considérable souligne l’importance historique des ressources naturelles, en particulier du saumon. Encore aujourd’hui, elles sont à la base de la subsistance et de la structure sociale des Autochtones de la côte ouest.
yuluwen ‘u wi’wul ‘u tthu hwulinitum mustimuhw, skw;she’lu ‘u tthu quw’utsun mustimuhw ‘u wa’lu wulh 15,000 tl’uxw thu mustimuhw (Cowichan Tribes, 2021), lumstuhw ‘u qux ‘u thu sulh’tun ‘u thu tumuhw. Tu’i qux mustimuhw lumstuhw ‘u thi’ mawt thithat ‘u thu sulhtun, hut mukw stem hwu si’em stseelhtun, ‘u hwun tl’ulumthut West Coast hwulmuhw sulhtun ‘i hakwush snuw’uy’ulh.
Le bassin hydrographique local en entier, avec ses multiples lieux sacrés et sa riche mosaïque de récits culturels, est une région essentielle pour les Quw’utsun Mustimuhw. C’est un bastion spirituel et une ressource vitale pour la pêche, la récolte des plantes et la chasse. Les pentes sud de Hwsalu-utsum sont connues pour leurs prairies rares, qui abritent des plantes revêtant une grande importance spirituelle et pratique pour la communauté. Pour cette dernière, le bassin hydrographique est un gardien des histoires anciennes, en plus de fournir des ressources naturelles essentielles.
Thuw mukw kw’atl’kwu, sta’luw, ‘i xatsa’, qa’ ‘u xe’xe’ tumuhw ‘i ts’usts’ustin ‘u snu’uy’ulh, thithut sqwaluwun ‘u thu quw’utsun mustimuhw. Kwus thithat sqaluwun snuw’uy’ulh ‘u thu tsetsul’ulhtun, hwseenhwt, ‘i ‘a’luxut. Tu tl’itl’up t’ahw ‘u Hwasalu-utsum xul’ut ‘u thu saxul tumuhw, stl’ulnup ‘u squqwule’’u thithat ‘u s-a’lhs-stuhw’i nustli’ importance thithat ‘u thu nuts’a’wuqw. Tu kw’atl’kwa, sta’luw ‘i xatsa’ ts’ewut thu nuts’a’wuqw ‘u ‘u kwun ‘u wulh hilh sxwiem ‘i ‘aalhstuhw ‘u thithat thu sulhtun.
Aujourd’hui, la population des Cowichan Tribes, comme on les appelle officiellement, est beaucoup plus petite, soit 5 500 membres (Cowichan Tribes 2024). La superficie actuelle de la réserve est d’environ 2 400 hectares, ce qui représente une fraction du vaste territoire traditionnel (Cowichan Tribes 2024). Ce territoire, même s’il est limité par rapport aux vastes territoires historiques, accueille non seulement des régions résidentielles, mais également des installations communes et culturelles. Cela témoigne de la capacité de la communauté à maintenir et à cultiver son patrimoine et ses pratiques culturelles, malgré les contraintes imposées par le colonialisme et les politiques gouvernementales qui ont considérablement réduit la superficie de ses terres traditionnelles.
Skweyul, tu Cowihan Tribes, ‘u thu sne’ putnuhw, swe’ ‘u ‘uwiin’ul Kw’ushuleem’ wa’lu 5500 mustimuhw. (Cowichan Tribes, 2024). Kws swe’ ‘u tthuu tumuhws Sul’ixw wa’la 2400 hectares, ‘u ‘uhwiin’ kw’ush ‘u quw’utsun ‘u hwulmuhw mustimuhw thi’ tumuhw (Cowichan Tribes, 2018) Tu tumuhw, wa’lu uhwiin’ul ‘u tumuhw ‘u tu shtun’ni’iws tumuhw ‘u tthu quwutsun mustimuhw, tse’wulhtun ‘u tu s-hwun’ts’awqw tumuhw ‘u tu nuts’a’waqwewt. Tun’a lumstuhw ‘u s-hwun’ts’awqws ‘u kw’amkw’umstuhw ‘i lumstuhw ‘u thu hwulmuhw snuw’uy’ulh, ‘u st’e’uw niis sq’equp ‘u sthuthax ‘u hunutum colonialism ‘i government policies ‘u ‘uhwiin’ulstuhw ‘u quw’utsun tumuhw.
Sur le plan historique, la vie économique et sociale des Cowichan et d’autres peuples salish de la côte suivait le cycle de vie du saumon, surtout le saumon frayant dans la rivière Cowichan et ses affluents. Le saumon coho, le saumon chinook et le saumon kéta sont non seulement des sources d’alimentation vitales, mais aussi des produits économiques essentiels, qui facilitent des échanges socioéconomiques sophistiqués avec les tribus voisines. La rivière, décrite par Harold Joe comme le « pourvoyeur de vie et de moyen de subsistance », fait partie intégrante de ces communautés, comme le montre la cérémonie du premier saumon, qui souligne l’importance spirituelle et communautaire du cycle de vie du saumon. Cette cérémonie, durant laquelle le saumon est traité avec un énorme respect et placé de manière à orienter la remontée subséquente, souligne la croyance des Salish en ce qui concerne le caractère sacré du saumon. Ces pratiques garantissent la continuité des cycles du saumon, liant directement la santé des rivières à la viabilité de la pêche commerciale. Lorsque ces saumons regagnent l’océan, ils marquent le début d’entreprises de pêche commerciale durable, illustrant l’interdépendance critique entre les habitats fluviaux et l’industrie de la pêche au sens large.
tu tela’stuhw ‘i s-hwun’ts’awuqw ‘u tthu quwutsun ‘i mukw hwulmuhw mustimuhw wulh Wulh hith ‘u thithat ‘u thu stseelhtun hwualum, tthuw’ ‘u thu xil’a’ts stseelhtun ‘u thu Quw’utsun sta’luw ‘i ‘u ‘i’la’th. The’wun, stth’aqwi’, ‘i kw’a’luhw ‘u thu stseelhtun thithat ‘ulhtunstuhw thithat wulh telu’swtuhw, thuyt, thuytum kw’am kw’umstuhw syaays ni’ ‘u ‘uya’qtul ‘i ‘uya’qtulstuhw ‘u tthu ‘aw’kw’ulmuhw. Thu sta’luw hiiy’ut ‘u tthu Harold Joe ‘u tu hulitun ‘i sulhtun, ‘u thithat ‘u thu s-hwun’ts’awuqw, ‘i lemutstuhw ‘u thu hwun’a stseeltun hwunuwust, kw’u’i nem’ ‘u nilh s’uylus ‘u tthu nuts’a’wuqw ‘u thithat thu stseelhtun ‘e’muqt. Tu syaays, ‘untsu ‘u thu stseelhtun sus ‘uw he’letus ‘u stsi’elh stuhw ‘i snuw’uy’ulh ‘u tu ‘e’qmuqt, thithat ‘u hwulmuhw snu’uy’ulh ‘u thu xe’xe’ stseelhtun. Tu’inulh thuytum ‘u tthu mukw lhwet ‘u thu stseelhtun ‘e’muqt, ‘u xe’xe ‘u hulitun wi’wul ‘u thu snuy’uy’uljh ‘u stseelhtunew’t. ‘U tu’inulh ‘uw stseelhtun ‘e’muqt ‘u thu kw’atl’kwa, ‘eelhtun hwnuwust ‘u thu stseeltunewt yaays, lemutstuhw ‘u thithat nu’stli’ ‘u thu ‘u thu sta’luw s-hwun’ts’awuqw sus ‘u ‘a’luxut stseelhtun Stseelhtunewt.
Quw’utsun Kw’atl’kwa Enterprises : à la croisée de chemins critiques
En exploitation depuis les années 1990, les QKE sont devenues récemment une entité plus autonome. En 2019, elles sont officiellement devenues une société en commandite, dont les Cowichan Tribes sont le seul actionnaire. En raison de cette structure, les investisseurs des QKE disposent d’une responsabilité limitée, ce qui peut encourager les investissements et la croissance, tout en garantissant que les Cowichan Tribes conservent un contrôle important sur les décisions et les activités de l’entreprise. Cette structure offre un équilibre entre le contrôle opérationnel, la sécurité financière et les avantages fiscaux, ce qui la rend particulièrement adaptée aux entreprises qui ont des intérêts communautaires importants et un volet culturel considérable. Cette transition a marqué une étape déterminante, au cours de laquelle les QKE ont mis en place leur propre conseil d’administration et ont renforcé leurs capacités opérationnelles. Fortes de cette nouvelle indépendance, les QKE ont retenu les services d’une équipe dévouée et disposent de deux bateaux stationnés en permanence dans la baie de Cowichan (QKE 2021).
QKE, ‘u thu hwun’a’ sil’anum ‘u 1990s, ‘u qe’is sus ‘uw ‘iye’qtum kw’um kw’umul. ‘u 2019, kwus ‘u hunutum limitedn partnership swe’ ‘u tthu Cowichan Tribes. Tu thuyt ‘aant QKE ‘u ‘aluxut tu’i hunitum limited protection ‘u tthu hunitum investors, ‘u tle’ Q’pels ‘u ‘uy qwulstuhw ‘u thu telu, sisuw’ ‘u tthu Cowichan Tribes sul’utul’ tsulel mukw hakwush ‘u tu snuw’uy’ulh ‘u thu stseelhtunewt. Tu’inulh ‘u hukwush ‘u hwnuwust hukwush, telu’stuhw, sus ‘u hunutum taxation benefits, thuytum ‘u nem’ hakwush ‘u thu snuw’uy’ulh thithat ‘u tthu s-hwun’ts’awuqw ‘u tu hwnuwuststuw. Kw’i ‘iyeqt sxuxits ‘u thithat xutsa’th, tu’untsu lhikw QKE thuytum ‘u tthu hunitum board of directors sus ‘uw kw’a,kw’um yaays hawkwushus. Kwus tthuw’ ta’lut ‘aluxutus yaays, QKE wulh ‘a’luxut ‘u hwkw’amkwum sus ‘u lum’stuhw ‘u thu ye’selu snuwulh ‘u q’p’un’um ‘u thu tl’ulpalus (QKE, 2021).
Les QKE disposent de permis commerciaux pour un vaste éventail de fruits de mer. Les permis sont cruciaux pour les activités commerciales, en plus de soutenir les liens spirituels des Cowichan Tribes avec l’eau et les pratiques de pêche cérémoniales. En gérant les permis et les quotas, les QKE jouent un rôle essentiel dans la préservation des emplois et le patrimoine maritime des Cowichan Tribes, tout en agissant comme gardien de la durabilité économique et de la continuité culturelle.
QKE swe’ ‘u thu hunitum commercial liicences ‘u qux ‘u kw’atl’kw’a sulhtun, ‘u thithat ‘u thu hunitum licence ‘u thithat tu stseelhtunewt yaays sis ‘u ts’ets’uwut ‘u tthu Cowichan Tribes’ nilh s’uylus ‘u tu qa’ sus xe’xe syaays kw’akw’i’ukw. Hawkwushus tu hunitum licences ‘ikwunnuhw, QKE siemstuhw ni’ ‘u hulithut ‘u thu syaays sus ‘uw kw’atl’kw’u’ hwnwust ‘u snuw’uy ‘ulh ‘u thu Cowichan Tribes sus ‘uw sht’e ‘u ‘al’mutst ‘u ‘aya’qtul yaays ‘i s-hwun’ts’awuqw.

Bien qu’elles aient mis en place un cadre opérationnel solide, les QKE doivent composer avec des défis croissants liés à l’évolution des conditions environnementales et des restrictions réglementaires. Le rapport State of Salmon, publié par la Pacific Salmon Foundation (2024), fait état de pressions écologiques considérables. Alors que la population de saumon chinook dans la région de l’île de Vancouver et des bras de mer continentaux est supérieure à la moyenne à long terme, avec un nombre record de retours dans la rivière Cowichan, d’autres espèces, comme le saumon kéta et le saumon arc-en-ciel, ont une population bien en deçà de la moyenne. En particulier, l’abondance des reproducteurs de saumon kéta a diminué pour atteindre de bas niveaux inégalés depuis les années 1960. Ce déclin est attribuable à la hausse des températures de l’eau, à l’augmentation des inondations et à la fréquence accrue des sécheresses, qui perturbent le cycle de vie et l’habitat du saumon. Ces conditions nécessitent des stratégies d’adaptation en ce qui concerne les pratiques de pêche des QKE afin de garantir la pérennité des populations locales de saumon et de soutenir leur résilience dans ces changements environnementaux.
Shte’ ‘uw swe’ ‘u kw’am kw’um ‘u kw’am kw’um snuw’uy’ulh, Q KE na’us thithat tqet ‘untsu ‘u ‘eeye’qtum ‘u quw’uthut kw’atl’kwa’ ‘i hwnuwust. Tu hunitum Pacific Salmon Foundation’s (2024) State of Salmon qwul ‘u lemutstuhw thi’ ‘eeye’qtumstuhw. Shte’ ‘u stth’aqwi’ ni’ ‘u thu hunitum Vnacouver Island and Mainland regions ‘i hith ‘e’muqt, sus ‘uw mukw kwin ‘e’muqt ‘u thu quwutsun sta’luw, nets stseelhtun sisuw kw’a’luhw ‘i sxuw’q’um ‘uwu te’ mukw ‘emuqt. ‘uwu te’ mukw ‘u thu pupun’um kw’a’luhw ‘uwu lemut tun’i tthu 1960s. Tu ‘uwu mukw tun’i ‘u tl’hwum qa’, qux tu’ lhul’qum, ‘i qxelh ‘uwu te’ lhumuhw, kw’i ‘u thu stseelhtun hulithut ‘i ‘uwu t’at’ukw’. tu’nilh ‘u stitum’’u qxelh ‘uw nu’stl’i ‘eeye’qt wsnuw’uy’ulh ‘u thu QKE’s kw’ikw’iyukw ‘u thu ‘emuqt. sus ‘uw thuyt ‘u kw’istuhw ‘u thu s-hwun’ts’uwuqw stseelhtun ‘emuqt tu’nilh ‘u thu kw’atl’kwu ‘eeye’qtum’
Malgré l’efficacité de l’équipe et la gestion stratégique des activités de pêche, les stocks de poissons ne sont plus ce qu’ils étaient. En particulier, la pêche au saumon, une activité économique et culturelle de base pour les Cowichan Tribes, a été fortement restreinte par les règlements de Pêches et Océans Canada (MPO), qui interdisent ou limitent la pêche commerciale afin de préserver les stocks qui s’amenuisent (MPO 2024a; MPO 2024b; MPO 2024c). En outre, bien que les captures de crevettes soient restées constantes, elles sont insuffisantes pour assurer à elles seules la viabilité financière de l’entreprise. La situation est telle que, sans le soutien des subventions du MPO (MPO 2024d), les QKE éprouveront probablement des difficultés financières, allant jusqu’à l’insolvabilité, en raison de l’épuisement des stocks de poissons. Cet équilibre précaire révèle une crise environnementale plus générale qui a des répercussions sur les pratiques de pêche traditionnelles et sur la stabilité économique des entreprises de pêche commerciale autochtones.
Tu hunitun ‘u crew’s kw’am kw’um kw’ikw’utiyukw snuw’uy’ulh ‘u tu kw’ikw’utiyukwstuhw, ‘uwu te’ mukw ‘emuqt ‘u thu stseelhtun. Thuw mukw, s-hwun’ts’uwuqw, uw aya’qtul sus ‘u thithut ‘u xe’xe yaays ‘u tthu Cowichan Tribes, ‘u wulh ‘u tl’ux hwnuwust ni’ hunitum Fisheries and Oceans Canada (DFO) hwnuwust, ‘unuhwstuhw ‘i’ tl’itl’up ‘u thu kw’ikw’utiyukw ‘uw ‘uwu te’ mukw ‘emuqt (DFO, 2024, DFO 2024b, DFO 2024c). Sis uw, kwukwun’ut ‘u thu hunitum shrimp Kwu’elh ‘uy kwiin, kwu’elh ‘uw ‘uwu te’ ‘i tl’umtl’umkw’t ‘i ‘u thu qux telu’i hin’anuts’a’. Tu tl’ux ‘u yaays, ‘uwu te’telu’ ‘u thu hunitum grants from DFO(DFO,2024d), QKE ni’ wa’lu ‘asum ‘u ‘uwu te’ thu telu’, ‘u ‘uwu wulh puqw, shus ‘u ‘uwu te’ mukw stseelhtun. Tu’nilh stl’eluqun ‘u puy’puy’um lumstuhw ‘u thi’ kw’atl’kwa’ ‘eeye’qtum thu hwulmuw kw’akw’iyukw, yaays sus ‘u tele’stuhw ‘u thu hunitum Indigenous commercial fishing enterprises.

Face à cette réalité, les QKE sont contraintes d’envisager de nouvelles voies pour la durabilité qui vont de pair avec ses valeurs traditionnelles et son lien profondément enraciné dans la mer. Cette nécessité entraîne une réorientation stratégique pour permettre l’adoption d’approches novatrices qui pourraient s’ajouter aux méthodes de pêche traditionnelles, garantissant ainsi la résilience de l’entreprise. Au vu de cette dynamique, il devient évident que les changements anthropiques et leurs impacts sur les écosystèmes marins jouent un rôle essentiel pour façonner l’avenir des QKE. L’entreprise se trouve aujourd’hui à la croisée des chemins, cherchant à intégrer des pratiques durables à ses activités économiques afin de maintenir une continuité rentable et le bien-être de la communauté face à la diminution des prises.
Kw’i thu’thu’it, QKE ‘u nu’stl’i ‘u lemut thu shelh ni’ ‘u hulithut tu’nilh tselqun ‘u thu hwulmuhw hwnuwust sus ‘u kw’am kwum ‘u nuts’ul ‘u thu kw’atl’kw’a. Tu’nilh nu’stl’i ‘imushstuhw ‘u shqwaluwun ‘eeye’qtum ‘u qe’is ‘ewunus tu’untsa ‘u ‘i kw’ikw’uti’yukw snuw’uy’ulh, kw’am kw’umstuhw tu stseelhtunewt. Kwsustst hwqwel’qwul’i’wun ‘u ‘eeye’qtum, kwus ‘u sni’nuw ‘eeye’qtum ‘u thu tumuhw ‘i ‘eeye’qtum ‘u thu kw’atl’kwa’ ‘u thithut ‘u thuytum ‘u ‘e’wu ‘u thu QKE. Kwu stseelhtunewt ‘i’ hwthtiwun, lemut ‘u qe’is thu’it hwnuwust snuw’uy’ulh kwus telustuhw ‘u thuytum telustuhw ‘u thu telustuhw ‘i Hulithut ‘u thu s’hwun’ts’awuqw ‘u ‘asum ‘uwu te’ mukw ‘uw q’ep’
Cadre théorique
Le contexte théorique de notre étude de cas repose sur le principe de tsawalk, un concept fondamental de la philosophie nuu-chah-nulth, qui reconnaît l’interdépendance de tout (Atleo 2007). « Tsawalk », qui se traduit par « un », incarne l’interdépendance globale de tous les éléments de la vie : environnementaux, culturels et économiques. Cette vision du monde autochtone affirme qu’aucune composante de la vie ne fonctionne de manière isolée, que chaque partie est un fil dans le tissu élargi de l’écosystème. En pratique, ce principe renvoie au fait que le développement durable ne peut pas se limiter à des gains économiques, qu’il doit veiller à ce qu’ils aillent de pair avec la gérance de l’environnement et l’intégrité culturelle (Nuna et coll. 2021).
Kwthey’’u hwqwel’qwul’i’wun nuts’a yaays ‘uw hiiy’ut ‘u thu snuw’uy’ulh ‘u thu Tsawalk, ‘u thithat shqwaluwun’ ni’ulh ‘u Nuu-chah-nulth snuw’uy’ulh tuni’ lumnuhw ‘u mukw’ stem hwu sp’ulay’tul ‘u mukw’ stem (Atleo, 2007). Tsawalk, tu’untsu ‘uw shhw’iint ‘u “nuts’a” kwus ‘uw ts’i’ts’uwatul shqwaluwun ‘u thu tumuhw: tumuhw, snuw’uy’ulh, ‘i telu’stuhw. Tu’nilh Hwulmuhw tumuhwstuhw sus ‘uw sthuthex ‘u tuni’ ‘uwu te’ ‘u yaays ‘uw hin’anuts’a’, Tuni’ ‘u mukw’ stem ‘u tu’untsa ‘uw hwu sp’ulay’tul ‘u thu tumuhw. Tu yaays, tun’a hwnuwust yaays ‘u ‘uy shqwaluwun ‘u thu syaays, ‘uwu te’ ‘u tu tele’stuhw nu’stli’ yuhw Hwqwel’qwul’i’wun ‘u tumuhw yaays sus ‘u hwulmuhw hwnuwust (Nuna et al., 2021)
Le principe de tsawalk reconnaît le rôle traditionnel que jouent les Autochtones dans le maintien de l’équilibre et de l’harmonie. Il ne s’agit pas seulement d’exploiter les ressources naturelles, mais de réaffirmer le contrôle sur les terres traditionnelles et les modes de vie perturbés par des siècles de politiques coloniales (Murphy et coll. 2023). Parmi les exemples considérables de cette perturbation, il y a l’interdiction coloniale des barrages pour la pêche traditionnelle, qui étaient cruciaux pour la gestion des ressources par les Autochtones. Selon Dale et Natcher (2015), ces interdictions ont considérablement affaibli les pratiques de pêche traditionnelles. Les efforts déployés récemment pour réintroduire ces technologies de pêche autochtones en Colombie-Britannique représentent une étape cruciale pour récupérer des connaissances écologiques traditionnelles.
Tsawalk lumstuhw ‘uw hwnuwuststuhw ‘u tthu hwulmuhw mustimuhw ‘uwts’i ts’uwatul shqwaluwun. Kw’i timuthut ‘uwu te’ ‘uw’ ‘a’luxut ‘u tu mukw stem ‘u swe’ hakwush ‘u thu s-hwunits’awuqw sus ‘u snuw’uy’ulh ‘u ‘eeye’qtum ‘u qux sil’anum ‘u thu hwulinitum hwnuwust (Murphy et al., 2023). ‘u thi’maat ‘eeye’qtum ‘u tu hwulinitum ‘u ‘unuhw ‘u thu hwulmuhw tsetsul’ulhtun shxetl’’u tu’untsa ulh thithat ‘u hwulmuhw ulhtunstuhw. Qwal ‘u Dale ‘i’ Natcher (2015), tu’nilh ‘unuhw’ ‘uw thi ‘eeyeqtum hwulmuhw tsetsul’ulhtun snuw’uy’ulh, sus qe’is ‘uw timuthut ‘u thuyt kw’i ‘u tthu hwulmuhw tsetsul’ulhtun shkwey’xutssum’ ‘u British Columbia lemut ‘u thithat nem’ takw ‘u thuytum thu hwulmuhw tumuhw snuw’uy’ulh.
Cette approche interreliée de tsawalk est essentielle pour comprendre les multiples pressions auxquelles font face les QKE, notamment les changements climatiques, les impacts industriels, la pêche sportive, la pollution et la surpêche. Chacun de ces facteurs n’existe pas en vase clos, mais interagit de manière dynamique avec les autres, influençant la santé des écosystèmes marins et, par conséquent, le bien-être culturel et économique des Cowichan Tribes.
Tu’nilh ‘u kwun’utul snuw’uy’ulh ‘u Tsawalk ‘u thithat ‘uw shtatul’stuhw ‘u qux tl’ux yaays ‘asum QKE, hunitum climate change, industrial impacts, sport fishing, pollution, and overfishing. Tun’untsa ‘eeye’qtum ‘uwu te’ hulithut ‘u hunitum vacuum ‘u hulithut kw’i yu xut’utul’, ‘eeye’qtum ‘u mukw’ stem ‘u thu kw’atl’kwa sus ‘uw ‘eeye’qtum, ‘u hwnuwust sus ‘uw tele’stuhw ‘u tthu Cowichan Tribes.
En conclusion, l’utilisation du tsawalk comme cadre théorique nous permet non seulement de mieux comprendre les activités des QKE, mais crée également un précédent pour relever des défis environnementaux et économiques complexes de manière globale. Plus précisément, le tsawalk oriente l’élaboration de stratégies efficaces d’adaptation aux changements climatiques par les QKE, en mettant l’accent sur une approche intégrée qui allie la pérennité écologique, la viabilité économique et l’équité sociale. Cette approche garantit que les mesures d’adaptation sont profondément ancrées dans les connaissances traditionnelles et les besoins contemporains de la communauté, fournissant ainsi une base solide pour composer avec les impacts des changements climatiques. En évaluant ces défis par la prise en compte de l’interdépendance, les QKE peuvent défendre des voies de développement durable qui respectent et rajeunissent le tissu culturel, écologique et économique des Cowichan Tribes. Cette approche promet d’offrir des données et des modèles à d’autres communautés qui doivent composer avec des pressions semblables, en veillant à ce que le développement économique sur les territoires autochtones se déroule dans le respect, la durabilité et la cohérence culturelle.
tu’nilh ‘e’ut, huqwushus Tsawalk ‘u hwqwel’qwul’i’wun ‘uw huqwushus snuw’uy’ulh thun stat’ul’stuhw ‘u thu syaays ‘u QKE ‘u sht’e ‘u tu hwn hwnuwust thuytum ‘u ‘eeye’qtum tumuhw sus uw telu’stuhw ‘u tqetham’sh ‘uw ‘uy sqwuluwun. Haqwushus ‘u, Tsawalk ‘i’wusth ‘uw nu’stl’i ‘u thuytum tu’ ‘eeye’qtum thu tumuhw hwqwel’qwul’i’wun ‘u QKE thi’ maat sqwaluwun ‘u thu hwulinitum ‘i’ hwulmuhw, thuytum thu tumuhw, ‘i telu’stuhw sus ‘uw kw’am kw’um stuhw thu sqwaluwun, tu’nilh thu slhexun’ shqwaluwun ‘u thuytum s-hwun’ts’awuqws tu hwulmuhw snuw’uy’ulh sus ‘uw nu’ stl’i ch, hulit ‘u ‘uy shqwaluwun ‘uw lumstuhw ‘uw ‘eeye’qtum thu tumuhw. Shte’ lemut ‘u tl’ux yaays le’lum’ut ‘u thu slhexun shqwaluwun, QKE ‘uw thuytum tu syaays ‘uw thuyum tu shelh Kw’i si’em sus ‘uw thuytum thu snuw’uy’ulh, slexun’ tu tumuhw, sus uw hulit thu Cowichan Tribes. Kw’i ‘e’wunus qwil’qwul’ ‘uw ‘uy sqwaluwun sus hw’uw’tsust ‘u thu s-hwun’ts’awuqw ‘asum ‘u tl’ux ‘u thu syaays, ‘uw qwil’qwul’s ‘u telu’stuhw ‘u thu hwulmuhw tumuhw ‘u ni’ wulh hay ‘uw si’emstuhw, thuytum, sus ‘uw ts’its’uwutal shqwaluwun.
Méthodologie
La présente étude utilise une méthodologie d’étude de cas pour évaluer les stratégies adaptatives que les entreprises de pêche commerciale (EPC) mettent en place pour réagir à l’épuisement des stocks de poissons attribuable aux changements anthropiques. L’étude de cas est particulièrement appropriée quand vient le temps d’évaluer des phénomènes complexes de la vie réelle, proposant des données approfondies sur le contexte particulier des QKE et ses processus décisionnels (Yin 2018).
Tu’nilh hwqwel’qwul’i’wun mukw’ stem ‘u tu’nuhw ‘u ‘uy snuw’uy’ulh sisuw’ hunitum Commercial Fishing Enterprises (CFES) huqwush ‘u qwil’qwul’stuhw ‘u ‘uwu te’ qux ‘e’muqt Shus ‘u qul ‘eeye’qtum. Hwqwel’qwul’i’wun ‘uw slexun shqwaluwun lemut ‘uw tl’ux yaays, thu’it ‘eeye’qtum thu tumuhw, ‘uw ‘eehwe’t ‘u kw’am kw’um snuw’uy’ulh ‘u QKE sus ‘uw shqwaluwun hwnuwust (Yin, 2018).
Participants et participantes
Des employés des QKE qui représentent différentes fonctions à l’échelle de l’organisation ont participé à l’étude :
- Shawn Baybutt, directeur administratif – chargé de la planification stratégique et de la prise de décision globale.
- Clyde, capitaine – dirige les équipes de pêche et prend des décisions en temps réel sur la récolte en fonction des conditions environnementales et des contraintes opérationnelles.
- Norman et Theresa, membres du conseil d’administration – fournissent des données essentielles du point de vue du conseil d’administration.
- Harold, gardien du savoir – fournit des données historiques.
Ce groupe diversifié de participants et participante a été sélectionné pour recueillir les perspectives à de multiples échelons de l’organisation, permettant de comprendre, de manière globale, les activités et les stratégies adaptatives de l’entreprise.
Kw’e nut’tul ‘ut sun’ts a’wuqqw wulh ‘ul’mutsun ‘uw lemut thu tl’ux syaays ‘u nutstul Mustimuhw ‘u thu hunitum orginization, thu’it ‘uy sqwaluwun ‘u thu hunitum enterprises Operatons sus ‘uw ‘eeye’qtum sqwaluwun.
Méthodes de collecte de données
Les données de cette étude ont été recueillies dans le cadre d’entrevues semi-structurées, une méthode qui offre un équilibre entre les questions structurées et la souplesse nécessaire pour donner aux participants et à la participante la possibilité d’exprimer leur pensée et de faire état de leurs expériences de manière exhaustive. Cette approche est particulièrement adaptée à l’étude de questions complexes, comme les impacts des changements climatiques, les changements opérationnels et la mobilisation communautaire dans le contexte des QKE. Pour favoriser un environnement confortable et franc, les entrevues ont eu lieu dans des lieux propices à une conversation ouverte et détendue. La plupart des entrevues se sont déroulées lors de repas partagés, de dîners, de soupers ou autour d’un café. Ce cadre honorait l’importance culturelle du partage d’un repas comme forme d’établissement de la communauté et de respect dans de nombreuses cultures autochtones.
Tutuleen-unuq wulh q’pet ‘uw hawqwushus ‘uw qwil’qwul’tul, kw’in ‘u kw’i ‘ehwe’t ‘uw ‘uy shqwaluwun ‘uw thuytum shqwaluwun sus ‘u nuts’tul tu shqwaluwun ‘u mukwalup ‘u qwil’qwul’tul ‘u thu shqwaluwuns sus ‘uw yaaysstuhw shqwaluwun. Kw’i ‘uw hwqwel’qwul’i’wun thuytum thu tumuhw ‘u tl’ux ‘u thu syaays ‘u tu’ ‘eeye’qtum thu tumuhw, ‘eeye’qtum tu syaays, sus ‘uw s-hwun’ts’awuqw ‘uw qwil’qwul’tul ‘u thu QKE. ‘u hwqwel’qwul’i’wun ‘uw thuyt thu tumuhw, qwil’qwul’tul ulh tun ni’utl’ ‘uystuhw ‘u ‘uy shqwaluwun tu qwal’. Mukw qwil’qwul’tul ulh ‘u ‘a’luxut thu lutem ‘u sulhtun, shtuhwskweyulqun, hwtuhw skweyulqun, koffi. ‘u huqwush thu snuw’uy’ulh ‘u yaays ‘’u letem ‘u thu s-hwun’ts’awuqw-ewt sus ‘uw si’emstuhw thu hwulmuhw snu’uy’ulh.
À ces entrevues se sont ajoutées des notes d’observation pour faciliter la transcription et l’analyse exactes des conversations. Cet ensemble de données narratives détaillées et de contexte d’observation permet de comprendre la manière dont les QKE s’orientent en fonction du principe directeur tsawalk1.
Kw’i qwil’qwul’tul wulh sus ‘uw le’lum’ut ‘’u thu pipu xul’tun ni’’u thu’it ‘u thu xulxulul’s sus ‘uw lemut the qwil’qwul’tul. Tu’nilh ‘uw lemut ‘u thu’it xulxulul’ssus ‘uw le’lum’ut ‘u thu mukw stem tu’untsa ‘uw shtatulstuhw ‘u thu snu’uy’ulh thu QKE ta’lut ‘u Thu snu’uy’ulh ‘u thu Tsawalk.
Il faut également souligner que la responsabilisation relationnelle (Wilson, 2008) a orienté le processus de recherche. Les participants et la participante ont été pleinement informés du but de l’étude. On a obtenu un consentement éclairé avant le début des entrevues. Conformément aux principes de propriété, de contrôle, d’accès et de possession (PCAP), les personnes qui y ont participé et la communauté auront droit de regard sur les données et leur diffusion.
Nilh ni’’uw haqwushus thu snuw’uy’ulh (Wilson, 2008) ‘imushstuw tu snuw’uy’ulh syaays. Tu’nilh ‘u swe’ s-hwun’ts’awuqw ‘u niilh ‘uw s’ehwe’ ‘u thu xulxulul’s niilh ‘uw ‘a’luxut ‘u tsusel ‘u thu s-hwun’ts’awuqw. ‘u thu hwnuwust ‘u OCAP (Ownership, Control, Access and Possession) snuw’uy’ulh, ‘uw tutuleen’utul ‘u thu nanum ni’ ‘u tu hunitum data’s ‘u thu s-hwun’ts’awuqw.
Enfin, bien que la présente étude de cas fournisse des données utiles, le fait qu’elle mette l’accent sur une seule EPC signifie qu’il peut être impossible d’appliquer les conclusions tirées à d’autres EPC ou communautés autochtones. Cependant, les leçons retenues proposent une orientation utile dans des contextes semblables.
hay, sus ‘uw thithat snuw’uy’ulh ‘u thu nanum, lemutum ‘u thu nuts’a CFE shhwiint tu’nilh ta’lut ‘u wawa’ ‘uwu te’ haqwush ‘u thu hwulmuhw CFEs ‘u s-hwun’ts’awuqw. Shte’, ‘u hwiw’tsust ‘u thu snuw’uy’ulh ‘u thu wa’lu syaays.
Principales leçons retenues et constatations thématiques
Constatation 1
Les impacts cumulatifs des épreuves environnementales expliquent la diminution des stocks de poissons
Les impacts omniprésents du réchauffement mondial sur la vie marine ont fait partie des thèmes récurrents des entrevues, alors que Shawn (directeur administratif, QKE) a souligné ses effets généralisés : « La grande question générale porte sur le réchauffement de la planète. Si l’on s’y attarde, il y a tellement de points qui y sont liés, comme l’augmentation de la température des océans. » Les personnes interrogées ont souligné que ce défi environnemental élargi est étroitement lié à des questions plus précises, comme le déclin des populations de saumon et la dégradation des aires de fraie.
‘u thi’ ‘eeye’qtum ‘u thu tatum’ kw’atl’kwa ‘u thu kw’atl’kwa hulitun wulh mukw qwul’ ‘u thu nanum’, ‘u Shawn (QKE Executive Director) thi’ ‘u thu qul shqwaluwun: “ ‘u thi’ mukw’ ‘untsu ‘u thu tatum kw’atl’kwa, lemutstuhw, thuw mukw ‘eeye’qtum mukw’ ‘untsu wa’la ‘uw tatum’thu kw’atl’kwa. “nanum ‘u thithat ‘uw ‘eeye’qtum mukw’ ‘untsa tqet ‘u tu’untsu shq’il ‘u kw’in ‘uw nu’ stl’i, shte’ ni’ ‘u tsas ‘uw ‘eqmuqt ‘u thu stseelhtun Sus ‘uw tsas xili’ts ‘u thu sta’luw.
Cependant, les changements climatiques ne sont qu’un seul des nombreux facteurs interreliés qui ont une incidence sur les écosystèmes marins. Les impacts industriels, comme le mentionnent Norm (membre du conseil d’administration) et Harold (gardien du savoir), jouent également un rôle considérable. Norm a souligné les répercussions élargies des activités industrielles sur la pérennité des populations de poissons : « L’industrie est à l’origine d’une plus grande inquiétude et d’un plus grand préjudice. » Harold a souligné plus précisément les pressions qu’exercent la pêche commerciale et la concurrence internationale : « Selon moi, la pêche commerciale représente le facteur principal. En outre, différents pays, comme les États-Unis et le Japon, jouent un rôle important dans la prise de notre saumon kéta. »
Kwu’elh, ‘eeye’qtum thu tumuhw ‘i nuts’tul ‘uw ‘eey’ ‘uw qul slexun thu kw’atl’kwa Hulitun. Hunitum Industrial impacts, ‘u nanum ‘u thu Norm (board member) sus Harold Hunitum Industrial syaays ‘u thuyt thu stseelhtun ‘emuqt: “ ‘u thi’ maat qul shqwaluwun suyum tun ni’ tsun utl’hunitum Industry. Harold ‘uw nanum ‘u qux kw’akw’kw’i’kw ‘u thu hunitum commercial fishing and international competition: “ni’ tsun shteewun huy ‘ul’ hunitum commercial fishing. Sus tl’e’ nuts’tul ‘u thu United States sus Japan, ‘u qux kw’akw’i’ukw ‘u Kwunut thu kw’a’luhw.”
Le déclin actuel des remontées de poissons fait également état des impacts historiques et cumulatifs, comme l’illustrent les réflexions de Theresa (membre du conseil d’administration) sur l’abondance passée par rapport à la rareté actuelle : « Je me souviens que le regretté Moe Henry parlait de la pêche à son époque, lorsqu’il se rendait simplement à la rivière… et qu’il avait déjà une dizaine de poissons, alors qu’aujourd’hui les remontées ne sont pas aussi bonnes. »
‘u qulet ‘u ‘uwu te’ qux ‘emuqt ‘u thu stseelhtun tl’e’ lumstamu ‘u ‘iilh ‘u ‘athut yaays, kwunut ‘uw ‘u lumstamu ‘u thu Theresa (board member) ‘u ‘iilh ‘emuqt ‘u hwi’ ‘emuqt ‘uwu te’ qux: “ni’ tsum hekw ‘u thu ‘iilh Moe Henry qwaqwulstuhw ‘u thu kw’akw’i’ukwulh, u ‘imush ‘u nem ‘u thu sta’luw…sus ‘uw hwun ‘uw kwunut ‘apun ‘u thu stseelhtun, ‘u hwi’ qul ‘emuqt.”
Dans l’esprit du tsawalk, il faut comprendre que ces facteurs environnementaux, industriels et historiques font partie d’un système complexe au sein duquel aucune question ne peut être isolée des autres.
‘u tu snuw’uy’ulh ‘u Tsawalk, tun’untsa hunitum environmental, industrisl, historical factors ‘uw shtatulstuhw ‘uw nuts’tul ‘uw ‘eeye’qmut ‘u thu tumuhw ‘uwu te’ nuts’a ‘eeye’qmut ‘u sul’utul’.
Constatation 2
L’importance culturelle de la pêche fait le pont entre le passé et le présent, les gens et la nature
La pêche occupe une place importante dans le tissu identitaire des Cowichan. Plus qu’une simple activité, il s’agit d’une pratique culturelle vitale, intimement liée à l’essence même de la communauté. Theresa explique cette signification, mettant l’accent sur son rôle fondamental : « La pêche est un aspect très important de notre identité en tant que Cowichan. Je pense qu’on aimerait continuer à pêcher simplement pour continuer à subvenir aux besoins de notre propre communauté. » Cette déclaration souligne que la pêche est une activité économique et un impératif culturel qui soutient et nourrit l’identité et la cohérence de la communauté.
Kw’awk’i’uhw ‘uw kwun’et ‘u thi’ maat shqwaluwun thu quw’utsun hwulmuhw, thithat ‘u thu Kw’awk’i’uhw:tu’inulh ‘u thithat ‘u xexe kw’awk’i’uhw ‘u thu sulhtun ‘u thu s-hwun’ts’awuqw. Theresa qwil’qwul ‘u tu thi’ maat shqwaluwun, ‘u thu snuw’uy’ulhstuw: kw’awk’i’uhw ‘u nanu thi’that ‘u ‘een thu tst ‘u thu quwutsun mustimuhw, sus ni’ sht’eewun ‘u mukw stem ‘uw Kw’awk’i’uhw ‘uw lhew’lhne’num ‘u thu s-hwun’ts’awuqw. “tun’untsa nanum le’lumut’staam Kw’awk’i’uhw ‘uw telustuhw susuw’‘u thu xexe syaays ‘uw lhew’lhne’num thu shwun’ts’awuqw ‘een thu ‘u sus shqwaluwun.
Les impacts des pratiques de pêche modernes et de la dégradation de l’environnement, comme Shawn et Clyde les ont soulignés, suggèrent une perturbation importante de ces pratiques traditionnelles. Des défis modernes, comme la pollution, les changements climatiques et la pêche industrielle, ont modifié les paysages et les paysages de pièces d’eau dont les Cowichan dépendent depuis des générations.
Tun’untsa ‘u qe’is ‘u thu kw’awk’i’uhw snuw’uy’ulh sus ‘u tatum kw’atl’kwa, le’lumutstaam ‘u Thu Shawn ‘i Clyde, nanum ‘uw qul shqwaluwun ‘u thu lhew’lhne’num. Qe’is tqet ‘u thu quliima’ qa’, ‘eeye’qmut thu tumuhw, sus ‘uw hunitum industrial fishing tsu’ ‘eeye’qmut thu tumuhw sus ‘u mukw thu qa’ ‘u tthey nu’stli’ ‘u mukw stem thu quw’utsun mustimuhw.
Les réflexions d’Harold sur les pratiques de pêche traditionnelles nous permettent de mieux comprendre ces dimensions culturelles et leur lien avec l’établissement de relations et la transmission des enseignements. Il relate : « Nous remontions les rivières avec nos lances; nous devions faire tout le sale boulot. Nous éclairions les poissons pour nos cousins plus âgés. Nous avons appris comment le faire. Il y a une façon d’être avec la rivière, tranquille, respectueux. Il ne faut pas prendre plus que ce dont on a besoin. » Ce récit est un témoignage puissant de la transmission intergénérationnelle du savoir, dans lequel la pêche est une question de subsistance et d’apprentissage du respect, de la patience et de la bonne gérance des ressources de la nature. Cela comprend une relation réciproque et respectueuse avec la rivière et les poissons, qui incarne le principe de ne prélever que ce qui est nécessaire pour assurer la pérennité et le respect de la vie offerte par la rivière.
Harold’s nanum ‘u thu kwa’awk’i’uhw snuw’uy’ulh le’lum’uts ‘u stawtulstuhw tthuw’ne’ulh Muhw shqwaluwun sus ‘uw thuyt thhu ‘uy shqwaluwun sus ‘uw snuwun Snuw’uy’ulh. Tthuw’ne’ullh, “ tst ‘uw ‘imush ‘u tuyul kwutst ‘u thu sunums; tst ‘uw thuy tu quliima’ syaays. Tst ulh ‘u hunitum flash fish kwthuna shuyulh. Tst ‘uw ta’lutstuhw. Tun’untsa tst ‘uw tuyul,ts’ewul, si’emstuhw, ‘uwu ch ‘u qux ‘uw nu’stli’ ch. “ tu’nilh ‘uw nanum ‘u Kw’am kw’um qwil’qwul’ ‘u snuwunstuhw ‘u thu snuw’uy’ulh, tun’untsa kw’awk’i’uhw sht’e sulhtun sus ‘uw si’emstuhw, ‘al’mutsun’, sus ‘uw ‘uy shqwaluwun ‘u thu stseelhtun. Kwus ‘uw Nuts’a maat shqwaluwun kwsutst thu sta’luw ‘u thu stseelhtun ‘uw mukw stem si’emstuhw, Haqwushus ‘u thu hwnuwust ‘uw kwunut ch nu’stli’ ‘u hulithut ‘u thu stseelhtun sus ‘uw si’em hwuhe’lit ‘ee’hwet ‘u thu sta’luw.
En somme, l’importance culturelle que revêt la pêche au sein des communautés de Cowichan est profonde, servant de pont entre le passé et le présent, les Aînées et Aînés et les jeunes, et les gens et la nature. Cette vision globale, au sein de laquelle les éléments économiques, environnementaux, culturels et sociaux sont indissociablement liés, fait état de la véritable essence du principe de tsawalk.
tl’uw’, ‘u thu ‘uy shwaluwun ‘u thu kw’awk’i’uhw ‘utl quw’utsun s-hwun’ts’awuqw ‘u thithat, Thuytum ‘uw shqwaluwun ‘u thu kweyululh ‘u tun’u kweyul, sul’eluw ‘i swiw’lus ‘u Thu tumuhw. ‘uw le’lum’ut ‘u thu hunitun economic, enviromental, cultural and social elements niihw hwsuq’a’, le’lum’ut ‘u thu’it shqwaluwun ‘u they’ Tsawalk hwnuwust.
Constatation 3
Les stratégies d’adaptation et les règlements doivent aller de pair
Les stratégies d’adaptation dans le domaine de la pêche commerciale, comme la diversification des produits de la pêche, sont cruciales pour tenir compte des changements environnementaux et économiques qui ont une incidence sur les communautés autochtones (Whitney et coll. 2020). Comme le souligne Shawn, l’élargissement de la pêche traditionnelle à la crevette pour comprendre celle du crabe et du poisson de fond illustre les modifications proactives qui renforcent la résilience face aux fluctuations des populations marines et des demandes du marché. Cette réponse stratégique va au-delà de la diversification des produits pour comprendre des pratiques adaptatives, comme les ajustements saisonniers apportés à la pêche, l’adoption de technologies de pêche respectueuses de l’environnement et des démarches communautaires, dont la remise en état des cours d’eau et l’aménagement d’écloseries. Ces pratiques, ancrées profondément dans les connaissances traditionnelles, améliorent la pérennité écologique et renforcent les liens culturels et la mobilisation des communautés dans la gestion des pêches.
‘eeye’qmut thu snuw’uy’ulh ‘u thu hunitum commercial fishing, ‘uw kwunut nuts’tul stseelhtun, Thithat ‘uw ‘eeyeqtum ‘u kw’atl’kwa sus telustuhw‘eeye’qtum,‘eeyeqtum thu s-hwun’ts’awuqw (whitney et al., 2020). ‘u Shawn xuxil, yu ts’its’usum’ ‘uw hwulmuhw kw’awk’i’ukw ‘u thu mam’ul’ ‘i ‘ey’xe’ ‘uw sts’at’qw’ steelhtun, le’lum’stum’ ‘ut ‘eeye’qtum ‘uw kw’am kw’umstuhw ‘u ‘eeye’qtum Kwatl’kwa kw’iin sus ‘u hunitum market demands. Kw’is nanum ‘i nem’yul-ew’ yaays ‘eeye’qtum ‘u lhikw’ut ‘eeye’qtum tu snuw’uy’ulh kwthu kw’awk’i’ukw ‘emuqt, ‘u ‘eeye’qtum ‘uy tumuhw ‘u sye’yu kw’awk’i’ukwstuhw, sus ‘uw s-hwun’ts’awuqwstuhw sus ‘uw thuyt thu statluw’ ‘u thu hunitum hatchery development. Kw’i hwnuwust, kw’am kw’um hwulmuhw Snuw’uy’ulh, ‘uw thuyt thu kw’atl’kwa’stuhw sus ‘uw kw’am kw’um ‘u thu hwulmuhw ‘u thu s-hwun’ts’awuqw staam ‘uw kw’ikw’i’ukwstuhw.
En même temps, il est essentiel de prendre en considération des cadres réglementaires complexes, car ces politiques ont une influence directe sur la durabilité de la pêche. Shawn a souligné que « les politiques fédérales sur les pêches ont des répercussions considérables sur notre entreprise, surtout lorsqu’il y a des fermetures constantes de la pêche, comme celle du saumon ». Cela souligne la nécessité de disposer d’un environnement réglementaire qui soutient les pratiques durables au lieu de leur nuire. Cette interaction entre les stratégies d’adaptation et la dynamique au chapitre des politiques suggère qu’une approche communautaire exhaustive est vitale pour la viabilité à long terme de la pêche commerciale autochtone.
Tl’e qul’et, ‘uw ta’lut ‘u tl’ux hwnuwust ‘u thu syaays ‘i thithat,’u tun’a hwnuwust ‘uw ‘eeye’qtum’u thu kw’akw’i’ukwstaam. Shawn qwi qwal ‘u,” hunitum federal fisheries hwnuwust sus ‘uw qul shqwaluwun ‘u thu syaays, nan ‘uw ‘u mukw stem ‘unuhw sus ‘uw kw’awk’i’ukw tuw’ne’ullh steelhtun.” kw’i ‘u thu hunitum federal fisheries hwnuwust nu’stl’i’ ‘uy hwnuwust kw’i ‘unuhw kw’ikw’i’ukwstuhw. Kw’i ‘uw yaays ‘u qe’is shqwaluwun sus hwnuwuststaam ‘uw qwiqwal ‘uw ‘u statulstuhw, tu s-hwun’ts’awuqw staam ‘uw thithat ‘u qux silanum ‘uy shqwaluwun ‘u thu hunitum Indigenous commercial fisheries.
Ensemble, ces trois constatations mettent en évidence les défis et les réponses interreliés au sein du secteur, suggérant qu’une approche globale intégrant les données de la communauté et des stratégies adaptatives est essentielle pour aller de l’avant.
Kwun’atul’, kw’i lhew ‘u tatul’ut wi’wul ‘u lh’qet sus ‘uw tqet sus ‘uw qwi’qwal ‘u tun’ni’ tsun ‘utl, wa’lu ‘u ‘uy shqwaluwun nem ‘u s-hwun’ts’awuqw staam sus ‘uw ‘eeye’qtum shqwaluwun ‘i thithat ‘u xwte’.
Recommandations
À la lumière des défis critiques auxquels les QKE et l’ensemble de la pêche commerciale autochtone font face, nous formulons les recommandations suivantes. Bien qu’elles s’appliquent principalement aux communautés autochtones et aux EPC, ces recommandations exigent également une participation considérable des gouvernements fédéral et locaux, reconnaissant leur rôle crucial dans le soutien et la mise en œuvre des pratiques durables. Cette approche réunissant de multiples intervenants et intervenantes est essentielle pour relever les défis environnementaux, culturels et économiques vitaux et assurer la santé à long terme des stocks de poissons et des communautés qui dépendent d’eux.
Wa’lu ‘u thithat ‘uw tqet ‘u nasum ‘u thu QKE, sus ‘uw mukw hunitum Indigenous commercial Fisheries, tst qwi’qwul ‘u kwe’tum thu snuw’uy’ulh. Wulh “uy shwaluwun ‘u thu hwulmuhw s-hwun’ts’awuqw sus CFEs, tthuw’ne’ullh nanum nu’stl’i’ ‘u thithat ‘u nanum thu hunitum federal sus local governments, tul’nuhw ‘uw ‘uy shqwaluwuns ‘u si’ellh stuhw ‘u yaays ‘uw ‘uy Hulitun hwnuwust. Kw’i tu’ul’tun xwte’ ‘u thithat sus ‘uw thuyt thu tumuhw, shqwaluwun, sus telu’stuhw tqet thithat ‘u thu nuts’a maat shqwaluwun ‘u hulitun ‘u steelhtun ‘emuqt ‘u thu s-hwun’ts’awuqwstaam.
Recommandation 1
Défendre la réalisation d’évaluations d’impact environnemental et industriel exhaustives
Nous incitons les communautés et les EPC à plaider en faveur d’évaluations d’impact environnemental approfondies qui intègrent les effets des changements climatiques, de la surpêche, de la pollution et des activités industrielles voisines, comme l’exploitation forestière et le broyage. Ces évaluations devraient fournir une vision globale des interactions entre ces facteurs et de leurs répercussions sur les populations de poissons, en soutenant les pratiques de gestion durable qui vont de pair avec le principe de tsawalk. Bien que la responsabilité première du démarrage de ces évaluations puisse incomber aux gouvernements fédéral et provinciaux, leur promotion et la participation actives des communautés autochtones et les EPC sont essentielles. Il faudrait constamment défendre le recours à ces évaluations, et être particulièrement assertif lors des phases de planification préalables de toute nouvelle activité industrielle susceptible d’avoir des impacts sur les pêches. Cette approche proactive permet de s’assurer que les considérations environnementales sont intégrées dès le départ, plutôt que de manière rétroactive. En outre, leur défense devrait également se concentrer sur les évaluations rétroactives pour les activités industrielles en cours ou établies. En adoptant une approche proactive et rétroactive, on s’assure que les évaluations sont non seulement exhaustives, mais qu’elles tiennent également compte de la culture et de l’environnement, conformément au principe de tsawalk.
tst qwi’qwal’ thu s-hwun’tsawuqw sus CFEs ‘u qwi’qwal ‘u kw’am kwum nanum ‘u thu thuyt thu tumuhw kw’i ‘i ‘uw ‘eeye’qmut ‘u thu tumuhw, qux kw’awk’i’ukw, quliima’ qa’sus ‘uw tl’uts’‘u hunitum industrial activities such as logging milling.Kw’i nanum ‘ehwe’ ‘uw thi’maat shqwaluwun kw’i nuts’tul nanum sus ‘eeyeqmut steelhtun ‘emuqt, si’ellh stuhw ‘uw hulitunstuhw hwnuwust ‘uw kwun’utul’ ‘u thu Tsawalk hwnuwust. Sht’e nuts’a ‘u thu syaays ‘uw xwte’ ‘uw nanum ‘uw kwsutst thu hunitum Federal sus provincial governments, qwi’qwalstaam sus uw thuytum ‘u thu hwulmuhw s-hwun’ts’awuqw sus CFEs ‘u nu’st’i’. Qw’qwalstaam ‘uw nanum thuw mukw stem ‘u kw’am kwum qwi’qwal ‘u tu tse’ul ‘u sqwaluwunthut ‘u qe’is ‘u hunitum industrial activities kw’i ‘eeyeqmut kw’awk’i’ukw. kw’i ‘uy shqwaluwun xwte’ ‘uw thuyt thu tumuhw nanum ‘u hawqwushus ‘u tu tse’ul ‘uw ‘uwu te’ ‘uw yathulh. ‘i’, qwi’qwalstaam nu’stl’i’ yath ‘uw le’lum’ut thu nanum xwte’ ‘u thu nanum hwu thu hunitum industrial activities. ‘u kwun’ut ‘u ‘uy shqwaluwun sus hwu shqwaluwun kw’i yath ‘uw ‘u nanum ‘uw yath ‘uw statulstuhw ‘uw ‘uy shqwaluwun thu hwulmuhw ‘uw ‘u yaays ‘u tumuhw, kwun’utul’ ‘u thu Tsawalk hwnuwust.
Recommandation 2
Diriger une initiative de cartographie de l’écosystème
Nous suggérons que les communautés et les EPC établissent une démarche de cartographie détaillée de l’écosystème qui désigne les acteurs clés de l’industrie de la pêche, y compris les organismes de réglementation, les communautés locales, les groupes environnementaux et les intervenants et intervenantes de l’industrie. Dirigée par les communautés autochtones en partenariat avec des ONG environnementales, cette démarche devrait bénéficier de l’expertise technique des organismes gouvernementaux. Il faudrait obtenir du financement auprès de sources gouvernementales et privées afin de garantir une couverture complète et l’utilisation de technologies de cartographie avancées. Cette cartographie devrait accorder la priorité à la compréhension des causes du déclin des stocks de poissons, en se concentrant d’abord sur les répercussions directes et indirectes, comme la destruction des habitats et le ruissellement industriel afin de faciliter la mise en place de stratégies de conservation ciblées et efficaces. Cette démarche devrait être réalisée sous forme d’activité de base et mise à jour régulièrement, ou lorsque des changements environnementaux ou industriels importants sont proposés. Ces mises à jour permettront de surveiller l’efficacité des stratégies de conservation et les impacts existants.
tst qwi’qwalstaam ‘u thu s-hwun’ts’awaqw sus CFEs thuyt ‘u kw’am kw’um tumuhw nanumstuhw kw’i ‘uw kw’awk’i’ukw hunitum industry mustimuhw, tl’e’ hwnuwust mustimuhw, s-hwun’ts’awuqw, thuyt thu tumuhw mustimuhw, sus Hunitum stakeholders, xwte’ ‘u hwulmuhw s=hwun’ts’awuqw ‘u hunitum environmental NGOs ‘ kw’i xwte’ ‘u nu’stl’i’ ‘uw si’ellh stuhw ‘u hunitum expertise from government agencies. Telu ‘uw lemutstaam ‘u hunitum governmental susprivate sources ‘u tse’ statulstuhw ‘u thi’lut sus ‘uw haqwushus ‘u qe’is hunitum mapping technologies. Kw’i hunitum mapping tse’ ‘u xwte’ statulstuhw shus ‘uw ‘uwu te’ qux steelhtun’’emuqt, le’lum’ut nuts’a ‘u qul Sus wa’wa’ qul shwaluwun, ‘u tsaas tumuhw sus hunitum industrial runoff, ‘u xwte’ ‘u thuyt Thu tumuhw shqwaluwun.Kw’i shuw xwte’‘u thu nanum ni’’u ‘eeyeqtum yaays sus ‘uw thuytumstaam, kwsun’s ‘uw thuytum thu tumuhw ‘u hunitum indutrial changes are proposed. Tthuw’ne’ullh qe’is nunum ‘uw ts’ewut ‘uw le’lum’ut ‘u thu ‘uy shqwaluwun sus ‘uw ts’ewutum.
Recommandation 3
Créer des programmes de partenariat pour la résilience aux changements climatiques
Les programmes de partenariat qui réunissent des communautés autochtones, des pêcheries commerciales, des organismes environnementaux et d’autres intervenantes et intervenants pertinents devraient se concentrer sur l’élaboration de stratégies adaptatives qui atténuent les impacts des menaces recensées, comme les changements climatiques et la pollution industrielle. En collaboration avec les EPC, les communautés autochtones devraient diriger ces programmes, avec le soutien technique et financier d’organismes gouvernementaux. De telles ententes devraient être officialisées au moyen de protocoles d’entente afin de préciser les rôles, les responsabilités et les contributions de toutes les parties visées. Les programmes de partenariat devraient être lancés en réaction aux menaces et aux vulnérabilités recensées dans l’écosystème de la pêche qui pourraient être exacerbées par les changements climatiques ou les activités industrielles. Des audits environnementaux et des évaluations des risques réalisés régulièrement devraient déclencher des examens et des mises à jour de ces stratégies.
kwun’utul’ yaays kwi’es lhilhukw’ut thu hwulmuhw s-hwun’ts’uwuqw, hunitum commercial fisheries, Environmental agencies sus nuts’tul hunitum relevent stakeholders ‘uw thuyt ‘u qe’is snuw’uy’ulh ‘uw ts’ewut ‘u yaays ‘uw thuytum thu tumuhw, tu’inilh hunitum climate change and industrial pollution. Sun’iw’ ‘u kwun’atul’ ‘u CFEs, hwulmuhw s-hwun’ts’awuqw ‘u xwte’ thu syaays, q’a’ hunitum technical and financial support provided by government agencies. Kw’i xte’ q’a’ ‘uw qwil’qwul’tul ‘u hunitum through memorandums of understanding to clarify roles, responsibilities, and contributions ‘uw mukw’lhet. Kwun’atul’ syaays niilh xwte’ ‘uw yaays sun’iw qwi’qwal ‘uw lemut thu qul shqaluwun sus maanthut q’a’ut ‘uw hunitum fisheries ecosystem kw’i ‘uw lhtsiws ‘uw ‘eeye’qmut ‘u thu kw’atl’kwa ‘u hunitum industrial activities. Hunitum regular environmental audits and risk assessments xwte’ staam le’lum’ut pqwutsun qe’is thu snuw’uy’ulh.
Conclusion
L’étude de cas des QKE révèle les couches complexes des défis et des possibilités au sein du secteur de la pêche commerciale autochtone, étayées par le principe d’interdépendance de tsawalk. Cette étude a mis en évidence les rôles essentiels que jouent la gérance de l’environnement, l’intégrité culturelle et les pratiques économiques durables dans le maintien de l’équilibre entre le bien-être de la communauté et la santé écologique. Alors que nous nous tournons vers l’avenir, les recommandations formulées visent à bâtir un lendemain résilient pour les pêcheries autochtones grâce à une gestion exhaustive des écosystèmes, à des approches collaboratives et à l’intégration des connaissances traditionnelles dans les pratiques modernes. La réussite de ces démarches nécessite un engagement de tous les intervenants et intervenantes quand vient le temps de respecter et d’honorer les relations complexes qui définissent la santé de la communauté et de l’environnement.
kw’i nanum ‘u thu QKE ‘uw lumstuhw ‘u tl’ux ‘u thu syaays ‘u tqet staam sus yaays q’a’ suniw thu hwulmuhw hunitum commercial fisheries sector, thithat ‘u thu Tsawalk hwnuwust ‘u nuts’a maat shqwaluwun. Kw’i nunum lemut thithat yaays ‘u le’lum’utstuhw thu tumuhw ‘uy shqwaluwun, sus hulitun telu’stuhw hwnuwust ‘uw kw’am kw’um thu shqwaluwun shhw-e’yu s-hwun’ts’awuqw shqwaluwun ‘u thu tumuhw hulitun. Kwutst lemut xwte’ ‘u nanum qwi’qwul’tul ‘uw thuyt ‘u tl’ux yuluw’en ‘u hwulmuhw kw’awk’i’ukw ‘u statulstuhw Kw’atl’kwa’stuhw, kwun’atul’ xwte’, sus ‘uw hawqwushus ‘u snuw’uy ulh q’a’ qe’is snuw’uy’ulh. ‘uw wulh hay thu syaays ‘uw nu’stl’i’ ‘u thu’it shqwaluwun thuwmukw Hunitum stakeholders ‘uw si’em sus stsi’sulh tl’ux shqwaluwun ‘u thu hulitun ‘u s-uy’aan ‘u thu s-hwun’ts’awuqw sus ’u thu tumuhw.
Références
Alberio, Marco, et Soubirou, Maria. 2022. « How Can a Cooperative‐Based Organization of Indigenous Fisheries Foster the Resilience to Global Changes? Lessons Learned by Coastal Communities in Eastern Québec. » Environmental Policy and Governance 32 (6): 546-59. https://doi.org/10.9734/ijecc/2024/v14i74254
Atlas, William I., Natalie C. Ban, Jonathan. W. Moore, Adrian M. Tuohy, Spencer Greening, Andrea J. Reid et coll. 2021. « Indigenous Systems of Management for Culturally and Ecologically Resilient Pacific Salmon (Oncorhynchus spp.) Fisheries. » BioScience 71 (2): 186-204. https://doi.org/10.1093/biosci/biaa144
Atleo, E. Richard. 2007. Tsawalk: A Nuu-Chah-Nulth Worldview. Vancouver: UBC press.
Bartlett, Cheryl, Murdena Marshall et Albert Marshall. 2012. « Two-Eyed Seeing and Other Lessons Learned Within a Co-Learning Journey of Bringing Together Indigenous and Mainstream Knowledges and Ways of knowing. » Journal of Environmental Studies and Sciences 2: 331-40. https://doi.org/10.1007/s13412-012-0086-8
Cowichan Tribes. 2018. Cowichan Tribes Strategic Plan 2019-2024. https://cowichantribes.com/application/files/4215/9379/6107/Cowichan_Tribes_Strategic_Plan_2019-2024_final_web.pdf
Cowichan Tribes. 2021. About. https://cowichantribes.com/about-cowichan-tribes/land-base/reserves
Cowichan Tribes. 2024. Demographics. https://cowichantribes.com/about-cowichan-tribes/demographics
MPO (Ministère des Pêches et des Océans). 2024a. Dates d’ouverture et de fermeture des pêches. https://www.dfo-mpo.gc.ca/fisheries-peches/oc-of-fra.html
MPO (Ministère des Pêches et des Océans). 2024b. Avis de pêche. https://notices.dfo-mpo.gc.ca/fns-sap/index-fra.cfm?pg=view_notice&DOC_ID=310898&ID=all
MPO (Ministère des Pêches et des Océans). 2024c. Avis de pêche. https://notices.dfo-mpo.gc.ca/fns-sap/index-fra.cfm?pg=view_notice&DOC_ID=311121&ID=all
MPO (Ministère des Pêches et des Océans). 2024d. Initiative des pêches commerciales intégrées du Pacifique (IPCIP). https://www.pac.dfo-mpo.gc.ca/reconciliation/picfi-ipcip/index-fra.html
Deranger, Eriel Tchekwie, Rebecca Sinclair, Beze Gray, Deborah McGregor et Jen Gobby. 2022. « Decolonizing Climate Research and Policy: Making Space to Tell Our Own Stories, in Our Own Ways. » Community Development Journal 57 (1): 52-73. https://doi.org/10.1093/cdj/bsab050
Falardeau, Marianne, Elena M. Bennett, Brent Else, Aaron Fisk, C. J. Mundy, Emily S. Choy et coll. 2022. « Biophysical Indicators and Indigenous and Local Knowledge Reveal Climatic and Ecological Shifts With Implications for Arctic Char fisheries. » Global Environmental Change 74: 102469. https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2022.102469
Fatima, Noor, Sherif Eneye Shuaib et Jude Dzevela Kong. 2023. « Predicting Adaptations of Fish and Fishing Communities to Rapid Climate Velocities in Canadian Waters: a Systematic Review. » Environmental Advances 14 100452. https://doi.org/10.1016/j.envadv.2023.100452
Galappaththi, Eranga K., Vasantha B. Susarla, Samantha J. T. Loutet, Stephanie T. Ichien, Amanda A. Hyman et James D. Ford. 2022. « Climate Change Adaptation in Fisheries. » Fish and Fisheries 23 (1): 4-21. https://doi.org/10.1111/faf.12595
Hatcher, Annamarie, Cheryl Bartlett, Albert Marshall et Murdena Marshall. 2009. « Two-Eyed Seeing in the Classroom Environment: Concepts, Approaches, and Challenges. » Revue canadienne de l’enseignement des sciences, des mathématiques et des technologies 9 (3): 141-53. https://doi.org/10.1080/14926150903118342
Marshall, Daniel P. 1999. Those Who Fell from the Sky: a History of the Cowichan Peoples. Duncan, C.-B. : Cultural & Education Centre Cowichan Tribes.
Murphy, Matthew, Johnny Mack et Lorenzo Magzul 2023. « Place-Based Pursuit of Economic Self-Determination by the Toquaht Nation in Canada. » Advance Praise, 185.
Nuna, Richard, Trudy Sable, Dawn Foxcroft et Marta Da Graça Zacarias Simbine. 2021. « Indigenous Perspectives on Community Conservation. » Dans Communities, Conservation, and Livelihoods, Charles Anthony (dir.). Halifax, Nouvelle-Écosse : CCRN et IUCN-CEESP.
Quw’utsun Kw’atl’kwa Enterprises. 2021. Strategic Plan.
Steel, Jade R., William I. Atlas, Natalie C. Ban., Kyle Wilson, Jayda Wilson, William G. Housty et Jonathan W. Moore. 2021. « Understanding Barriers, Access, and Management of Marine Mixed-Stock Fisheries in an Era of Reconciliation: Indigenous-Led Salmon Monitoring in British Columbia. » Facets 6 (1): 592-613. https://doi.org/10.1139/facets-2020-0080
Kuok Ho Daniel Tang. 2020. « Implications of Climate Change on Marine Biodiversity. » Global Journal of Agriculture and Soil Science, 1 (1): 1-6.
Teh, Louise S. L. et U. Rashid Sumaila. 2020. « Assessing Potential Economic Benefits from Rebuilding Depleted Fish Stocks in Canada. » Ocean & Coastal Management 195, 105289. https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2020.105289
Connors, K., E. Jones, S. Peacock et K. Belton. 2024. State of Salmon: 2024 Report. The Pacific Salmon Foundation. https://stateofsalmon.psf.ca/
Tynan, Lauren. 2021. « What is relationality? Indigenous Knowledges, Practices, and Responsibilities with Kin. » Cultural Geographies 28 (4): 597-610. https://doi.org/10.1177/14744740211029287
Whitney, Charlotte K., Alejandro Frid, Barry K. Edgar, Jennifer Walkus, Peter Siwallace, Iris L. Siwallace et Nathalie C. Ban. 2020. « “Like the Plains People Losing the Buffalo”: Perceptions of Climate Change Impacts, Fisheries Management, and Adaptation Actions by Indigenous Peoples in Coastal British Columbia, Canada. » Ecology & Society 25 (4). https://doi.org/10.5751/ES-12027-250433
Wilson, Shawn. 2008. Research is Ceremony: Indigenous Research Methods. Fernwood Publishing.
1 Les données ont été analysées à l’aide d’une analyse thématique introspective, respectant les lignes directrices de Braun et de Clarke (2006).
Évaluation des systèmes énergétiques distribués dirigés par des Autochtones au Nouveau-Brunswick
Introduction en Mi’kmaq, un dialecte du Nouveau-Brunswick
[Cliquez pour voir en français] L’nue’kati’l ta’n New Brunswick na etekl ta’n nikantuk ta’n tett teliknaq sa’se’wa’sik, ki’s wesuwa’tmkl nuta’ql elkusuwatmkl ukjit nisa’tmk ta’n teliknaq aqq ewikasik ekkat jiltek ta’n nekemowk kepme’kl Utann ukjit na naji-petlewikl ta’n na utann aqq msit New Brunswickewaq (CBC, 2022) ( New Brunswick Mlkikno’ti, 2023) (New Brunswick Mlkikno’ti, 2024). Utann, nkutey Amlamkuk (Amlamkukewey Utan), na kiskajo’ltijik ukjit ta’n wejku’waql elkusuwasikl ula ta’n elteskemk. Ta’n nenmi’titl ankaptmk nike’ na naji-petlewa’tutij teliknaq Wksankewo’ti, teliknaq kelpitasik, aqq we’jitmk kejitmkl maqmikewel ukjit kisitasik kwilutasik-apaji-klusimk kisaptasikl ukjit nisa’tun ta’n siawikwutikl siptaqtestoq ta’n na provincialey wasoqenawek nastaqtek wejiaq kisitasik aqq tewa’tkitasik ta’n utan-enkasik iknmuetasik teliknaq kisitasikl (DES).
Ula telitpiaq ekitk kwilk ta’n teltekl ta’n iknmuetasikl teliknaql kisitasikl, ta’n tel-wikasik aqq tetpaqa’tasik weskewa’timk etek kiskuk ta’n ika’toql anqateskawekl ukjit meski’k wesuwa’luksin ta’n ula kisitasikl, aqq ta’n L’nue’kati’l na kelu’kewe’l telpukuwultijik ukjit sapteskmnew ta’n anqateskawekl.
Les Premières Nations au Nouveau-Brunswick sont à l’avant-scène de la transition énergétique, ayant déjà pris d’importantes mesures pour réduire l’empreinte énergétique et carbone de leur nation respective pour le mieux-être de leur communauté et de l’ensemble des Néo-Brunswickois et Néo-Brunswickoises (CBC 2021; CBC 2022; Énergie NB 2023; Énergie NB 2024). Des nations, comme la Première Nation d’Amlamgog (Fort Folly), sont prêtes à franchir les prochaines étapes de ce parcours. Leurs ambitions se concentrent désormais sur le renforcement de la souveraineté et de la sécurité énergétiques, et sur l’établissement de terrains d’essai pour des solutions novatrices de gestion de la demande afin de réduire la pression toujours croissante sur le réseau électrique provincial grâce à l’élaboration et au déploiement de systèmes énergétiques distribués (SED) à l’échelle de la communauté.
La présente étude de cas évalue les concepts que sont les systèmes énergétiques distribués, les politiques et les règlements existants qui imposent des obstacles à l’adoption à grande échelle de ces systèmes, ainsi que la position unique des Premières Nations quand vient le temps de surmonter ces obstacles.
Systèmes énergétiques distribués
Les systèmes énergétiques distribués (SED) peuvent prendre de nombreuses formes. Ils renvoient à un ensemble de technologies et de protocoles qui permettent la production ou le stockage de l’énergie à un endroit rapproché du point d’utilisation, au lieu de compter sur de vastes réseaux de distribution (Pepermans et coll. 2005). Ces systèmes peuvent comprendre certains éléments, comme les panneaux solaires, les éoliennes, les microsystèmes hydroélectriques, les microturbines au gaz, les centrales électrocalogènes, les solutions de stockage d’énergie (comme les piles et batteries) et d’autres technologies de gestion de la demande.
Voici les principales caractéristiques des SED :
- Décentralisation : la production d’énergie est réalisée à un point plus près de l’utilisateur final, ce qui peut améliorer la sécurité et la fiabilité énergétiques.
- Intégration de l’énergie renouvelable : les SED intègrent souvent des sources d’énergie renouvelable, ce qui aide à réduire les émissions de gaz à effet de serre et la dépendance aux combustibles fossiles.
- Résilience du réseau : en diversifiant les sources énergétiques et leur emplacement, les systèmes distribués peuvent accroître la résilience de l’ensemble du réseau électrique, faisant en sorte qu’il soit moins vulnérable aux pannes.
- Évolutivité : il arrive souvent qu’on puisse déployer les SED de manière progressive, permettant une croissance souple en fonction de la demande localisée en matière d’énergie.
- Production d’énergie locale : cette approche peut outiller les communautés et les entreprises quand vient le temps de gérer leurs besoins énergétiques et leurs coûts de manière plus efficace.
- Démocratisation : renvoie au fait de rendre la production et la gestion de l’énergie plus accessibles, participatives et équitables, en transférant le tout (au sens propre et figuré) des services publics centralisés vers les personnes, les communautés et les entités plus petites.
Au chapitre de l’utilisation, les SED peuvent comprendre ce qui suit :
- Usage résidentiel : les propriétaires peuvent installer de petites éoliennes sur leur terrain ou des panneaux solaires sur le toit de leur résidence pour contrebalancer la consommation énergétique de celle-ci. Lorsqu’ils sont jumelés à un système de stockage d’énergie (comme une batterie), ils rendent possible la production d’énergie lors des heures creuses, son stockage et son déchargement à la résidence lors des périodes de pointe dans le réseau.
- Usage commercial : les entreprises peuvent utiliser des centrales électrocalogènes ou le stockage dans des batteries pour réduire la demande de pointe, ce qui permet de réaliser des économies au chapitre des coûts d’énergie en réduisant la prime de puissance, en plus d’accroître l’efficacité.
- Microréseaux : ces réseaux localisés peuvent fonctionner de manière indépendante ou conjointement avec le réseau traditionnel, en utilisant souvent un ensemble de SED. Les microréseaux peuvent être mis à l’échelle pour desservir des campus industriels ou institutionnels, des quartiers et même des communautés.
La figure 1 ci-dessous compare un réseau centralisé typique à un réseau distribué. Dans l’exemple du système distribué, les groupes de stockage d’énergie illustrés sont très près des utilisateurs finals, ce qui permet l’intégration de centrales électrocalogènes locales, en plus de la production par des consommateurs ou consommatrices sur le plan résidentiel, dont des panneaux solaires et des centrales électrocalogènes.
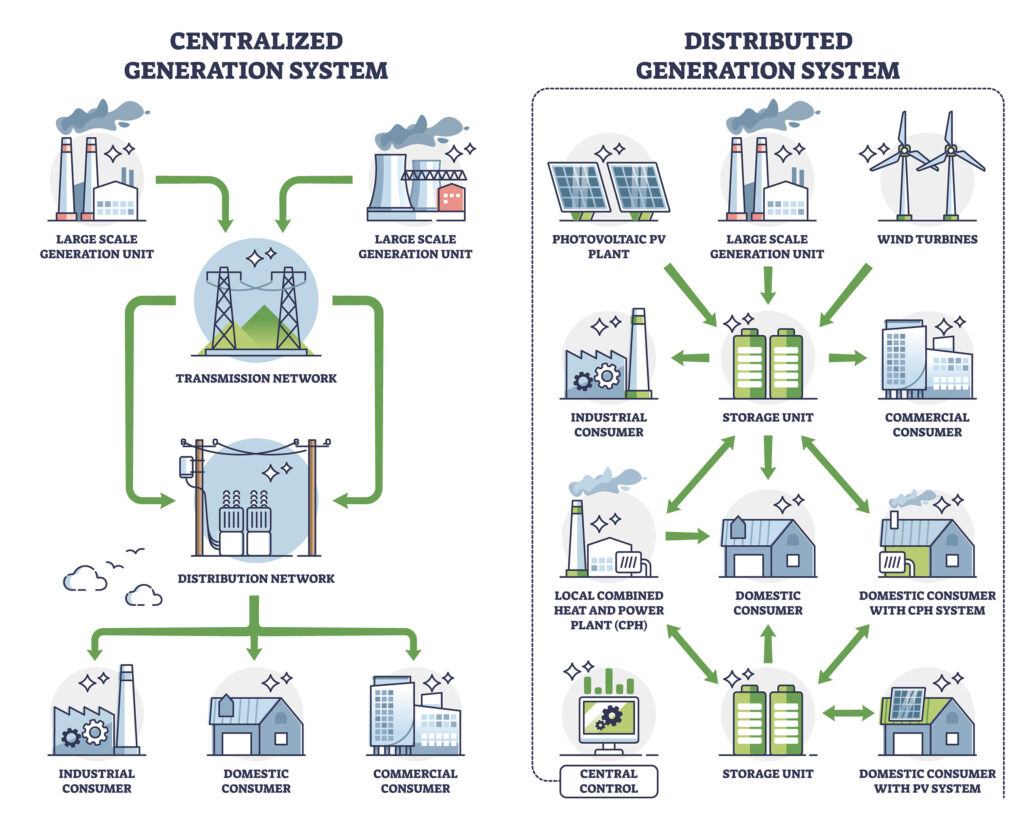
Systèmes énergétiques distribués et réglementation
Différents organismes gouvernementaux, différentes lois et différentes politiques visant à superviser la production, la transmission, la distribution et la vente au détail de l’électricité influent sur la réglementation de l’électricité au Nouveau-Brunswick. Nous décrivons les principales caractéristiques ci-dessous.
- La Loi sur l’électricité décrit le cadre de gestion et de réglementation de l’industrie de l’électricité au Nouveau-Brunswick. Elle englobe les responsabilités de la Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick (CESPNB), en plus d’établir des lignes directrices pour l’exploitation des services publics et la fixation des tarifs. Le Nouveau-Brunswick fonctionne selon une structure de marché réglementée, au sein de laquelle le principal service public, la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick (Énergie NB), occupe une position dominante.
- En outre, la Loi sur l’électricité établit la politique gouvernementale en ce qui concerne le réseau électrique. On peut y lire que « les sources et les installations de la Société servant à l’approvisionnement, au transport et à la distribution d’électricité dans la province soient gérées et exploitées d’une manière compatible avec la prestation d’un service fiable, sécuritaire et économiquement durable ». En outre, la Loi fait état d’un modèle d’exploitation des coûts du service dans le cadre duquel le réseau doit être géré de manière à procurer aux consommateurs des services au coût le moins élevé (gouvernement du Nouveau-Brunswick 2013).
- La CESPNB est un tribunal quasi judiciaire indépendant qui réglemente les services publics que sont l’électricité et le gaz naturel dans la province afin de veiller à ce que la clientèle reçoive un service sûr et fiable à des tarifs justes et raisonnables. Cette dernière réglemente les tarifs imposés par Énergie NB, le service d’électricité appartenant à la province, en plus de mettre en application des normes concernant la fiabilité (Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick 2025).
- Énergie NB est le principal service public dans la province, responsable de la production, de la transmission et de la distribution de l’électricité. Il s’agit d’une société publique qui exploite un ensemble équilibré d’installations de production, dont des centrales nucléaires, hydroélectriques et thermiques/à combustibles fossiles (Énergie NB 2025). On compte trois services publics chargés de la distribution locale dans la province, soit Saint John Energy, Énergie Edmundston et Perth-Andover Electric Light Commission.
Selon la Loi sur l’électricité du Nouveau-Brunswick, « seule la Société [Énergie NB] peut vendre de l’électricité à un consommateur ou à une entreprise municipale de distribution d’électricité dans la province ou l’approvisionner en électricité ». Malgré cela, le règlement permet à des producteurs indépendants d’électricité (PIE) d’exercer leurs activités dans la province, en fonction d’un ensemble strict d’arrangements. Les PIE concluent avec Énergie NB un accord d’achat d’énergie qui définit les modalités de vente de l’électricité au réseau. Ils doivent obtenir un permis d’exploitation auprès de la CESPNB. Il arrive parfois, en fonction de la demande projetée dans le Plan intégré des ressources (PIR) du service public (Énergie NB 2023), qu’Énergie NB publie des demandes de déclaration d’intérêt (DDI) pour de nouveaux actifs de production à l’intention des PIE. Parmi les demande de déclaration’expression d’intérêt (DDI) récentes, il y a eu un appel en 2023 pour des ressources renouvelables d’un maximum de 220 mégawatts (MW) et le stockage d’énergie d’un maximum de 50 MW (Énergie NB 2023) ainsi qu’un appel pour trouver des répondants qualifiés en vue de la construction, de l’acquisition et de l’exploitation d’une centrale de production à turbine de combustion à cycle simple (Énergie NB 2024).
Qu’est-ce que cela signifie? Le marché de l’électricité au Nouveau-Brunswick est fortement réglementé, alors que le service public provincial (Énergie NB) est exclusivement responsable de la production, de la transmission et de la distribution de l’électricité. Même si les PIE ont l’autorisation d’exercer leurs activités, le gouvernement du Nouveau-Brunswick définit les conditions du marché et d’exploitation de ces producteurs. La production d’énergie renouvelable à petite échelle en aval du compteur est autorisée; cependant, ces systèmes sont aujourd’hui limités à 100 kilowatts (kW). Les ententes de facturation nette qui en découlent n’offrent aucun rendement financier pour l’électricité excédentaire produite par ces systèmes sur une base annuelle. En outre, il n’existe pas de marché ouvert de l’énergie au sein du réseau de distribution, ce qui signifie qu’il n’y a pas de possibilité d’échange d’énergie de pair à pair entre les consommateurs.
Si une Première Nation souhaite atteindre un niveau plus élevé d’indépendance et de souveraineté énergétiques, elle ne dispose aujourd’hui que de quelques mécanismes. Elle pourrait notamment répondre à une DDI pour de nouveaux actifs de production de la part d’Énergie NB. Il s’agirait d’un processus d’appel à la concurrence ouvert, visant à acheter de l’électricité à des tarifs avantageux pour le contribuable (c’est-à-dire des économies).
Première Nation d’Amlamgog (Fort Folly) : le leadership à l’avant-garde de la transition énergétique

La Première Nation d’Amlamgog (Fort Folly) est une communauté mi’kmaq située au Nouveau-Brunswick, au Canada. Créée en 1840, la communauté se trouve près du village de Dorchester, sur la côte sud-est du Nouveau-Brunswick. La communauté fait partie de la Nation mi’kmaq élargie, qui a un riche patrimoine culturel et une histoire vieille de plusieurs milliers d’années.
La Première Nation d’Amlamgog compte environ 140 membres inscrits et inscrites (gouvernement du Canada, 2025). Environ 60 personnes vivent dans la réserve. La communauté comprend environ 35 résidences et six immeubles commerciaux appartenant à la bande, y compris une résidence pour personnes aînées de cinq logements construite récemment.

Au cours des dernières années, en fonction d’un engagement pris par le chef et le conseil, la Première Nation d’Amlamgog a adopté plusieurs mesures ambitieuses pour favoriser l’atteinte des objectifs de durabilité de la communauté afin d’assurer le mieux-être des générations futures.
En 2022, elle a commandé quatre systèmes solaires à facturation nette branchés aux immeubles commerciaux dans la communauté (CBC 2021). La capacité totale d’énergie solaire installée atteint 112 kW, ce qui permet de produire annuellement environ 144 000 kWh/an et de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) au cours du cycle de vie de 1 771 tonnes de CO2 (Natural Forces Solar 2024).

- En 2023, la Première Nation d’Amlamgog, avec le soutien du North Shore Mi’kmaq Tribal Council, a entrepris l’élaboration d’un plan énergétique communautaire (PEC) renfermant une évaluation énergétique dans la communauté, un plan communautaire sur l’énergie et les émissions, et une voie pour la réduction des émissions. Le PEC a permis de conclure, entre autres, que la consommation d’électricité par habitant dans la communauté était environ deux fois moins élevée que la moyenne au Nouveau-Brunswick (9 118 contre 17 600 kWh/personne/année) (Quest Canada 2024). Cette situation est attribuable, en grande partie, aux systèmes d’énergie solaire à facturation nette exploités dans la communauté.
- La Première Nation d’Amlamgog s’est engagée à améliorer l’enveloppe de bâtiment de toutes les constructions résidentielles et commerciales neuves à l’aide de certaines méthodes, comme le coffrage à béton isolé pour le système de murs extérieurs, ce qui entraîne une baisse de l’empreinte énergétique et environnementale de tous les nouveaux lotissements. Même si elle n’en a pas fait officiellement une politique, la communauté a indiqué qu’elle voulait en faire un engagement officiel (Quest Canada 2024).
- La Première Nation d’Amlamgog participe activement au programme d’efficacité énergétique pour les Premières Nations d’Énergie NB. D’ici la fin de 2025, environ 17 pour cent des logements de la communauté auront fait l’objet d’une amélioration énergétique exhaustive, dont la conversion des derniers systèmes de chauffage au mazout en systèmes électriques.
- La Première Nation d’Amlamgog s’est engagée à électrifier entièrement les activités organisationnelles, y compris les actifs du parc. Récemment, la Nation a acheté son premier véhicule électrique (VE). Elle poursuit ses plans visant à installer des bornes de recharge pour VE à l’appui de cette transition. La communauté cherche également à installer des bornes de recharge rapide avec compteur de facturation réservées au public, qui lui procureraient une autre source de revenus autonome.
Avec une consommation totale d’électricité de 666 255 kWh en 2023, la Première Nation d’Amlamgog est sur la bonne voie pour devenir une communauté carboneutre. Cependant, pour y parvenir, il faudra investir dans la réglementation et l’infrastructure.
Prochaines étapes – Intégrer les systèmes énergétiques distribués à Amlamgog
[Cliquez pour la version en français] Msit mesnmk nationaley aqq provincialey teliknaq sa’se’wa’sik mesnmkl na nuta’qtital msit ta’n ilapaqewemkewe’l ta’n na ilapaqawemkewe’l-masqwa’tasikl. L’nue’kati’l utann, nkutey Amlamkuk ta’n New Brunswick, na kelu’lkewe’l telpukuwikl ukjit almi’jkan nikana’tu’n tel-lukwen na kisitaqetijik ta’n Kana’taewey waqme’k teliknaq sa’se’wa’sik. Nekemowk apoqnmua’tijikw ta’n ketloqoe’l apoqnmuekl, melkuktmk ta’n westawiasik aqq tel-lukwemk ukjit kaqi tetpaqtek telo’ltimk kjijitaqn elt kiskukewey espitasikewey kelu’lkewe’l telpukuwimkl ukjit na layjitunew sa’se’wa’sik pilu’tek ta’n welapetmkl kitk L’nu’k aqq mu L’nu’k te’sultijik. Ekina’mujik L’nu’k nikanusk Ula ta’n etek na nuta’q ukjit mesnmk na tplutaqniktuk, tetpaqtek, aqq westawiasik teliknaq elmi’knik.
Pour atteindre tous les objectifs nationaux et provinciaux au chapitre de la transition énergétique, il faudrait disposer de tous les outils accessibles dans la boîte à outils. Des communautés autochtones, comme celle d’Amlamgog au Nouveau-Brunswick, se trouvent dans une situation unique quand vient le temps de jouer un rôle de chefs de file à titre d’innovatrices dans la transition vers l’énergie propre du Canada. Leur gérance des ressources naturelles, leur engagement en matière de durabilité et leur capacité à trouver un équilibre entre les connaissances traditionnelles et les technologies modernes les placent dans une position unique pour favoriser l’adoption de changements transformateurs qui seront avantageux à la fois pour les populations autochtones et non autochtones. Il est essentiel de renforcer le leadership autochtone dans ce domaine pour offrir un avenir énergétique juste, équitable et durable.
Si l’on considère les communautés comme une charge électrique unique, la capacité de les faire fonctionner indépendamment du réseau électrique lors des périodes de pointe (en fonction de ce que l’on appelle parfois le « mode îlotage ») améliorerait la résilience et la fiabilité globales du réseau électrique d’une région. Ces réseaux isolés peuvent être également utilisés pour reconstruire le réseau élargi en cas de panne imprévue d’envergure.
Le 4 février 2023, le Nouveau-Brunswick a dû composer avec une demande record de 3 394 MW (Conseil de conservation du Nouveau-Brunswick 2023), en raison d’un épisode de froid intense qui a exercé des pressions considérables sur le réseau provincial et le portefeuille des actifs de production gérés par Énergie NB. Alors que les collectivités publiques voisines étaient soumises à la même contrainte, les importations d’électricité n’étaient pas possibles. Le Nouveau-Brunswick a été contraint de fonctionner en autarcie.
Si les 15 communautés des Premières Nations dans la province du Nouveau-Brunswick (voir la figure 4 ci-dessous) avaient disposé de SED communautaires, cela aurait équivalu au démarrage d’une centrale de moyenne taille, sans le coût et la complexité associés à la construction d’une telle centrale.
Dans une situation où chaque électron compte, le fait de disposer d’une marge de capacité additionnelle aux bons endroits peut faire la différence entre la stabilité du réseau et les pannes.

Dans la Première Nation d’Amlamgog, un SED communautaire pourrait prendre différentes formes. Cependant, il est probable qu’il comprendrait un microréseau associé à un petit actif de production ou à un système de stockage d’énergie. Un microréseau forme un réseau électrique localisé, indépendant du réseau d’alimentation principal. Au moyen d’un contrôleur de microréseau, le système établit un équilibre entre l’offre et la demande sur le réseau.
La production pourrait être faite à l’aide de différentes sources, dont les suivantes :
- Un parc solaire communautaire, comme le projet de communauté énergétique intelligente de Shediac (Énergie NB 2025), associé à un système de stockage de l’énergie dans des batteries. Lors de l’élaboration du plan énergétique communautaire d’Amlamgog, les membres de la communauté ont recensé des lieux potentiels pour installer une centrale solaire communautaire. Ils et elles ont indiqué qu’ils et elles envisageaient l’agrivoltaïsme, soit l’intégration de la production d’énergie solaire aux pratiques agricoles sur le même terrain.
- Un parc d’éoliennes communautaire ou l’intégration d’éoliennes à axe vertical, avec un système de stockage de l’énergie dans des batteries. Lors de l’élaboration du plan énergétique communautaire d’Amlamgog, les membres de la communauté ont exprimé des préoccupations concernant le bruit, exigeant une évaluation plus approfondie en raison de la petite empreinte de la communauté (Quest Canada, 2024).
- Un système communautaire de stockage d’énergie dans des batteries, rechargées avec le réseau d’Énergie NB lorsque la demande est faible, et de dissipation de l’énergie pendant les périodes de pointe dans le réseau.
- Une centrale géothermique communautaire, semblable au projet géothermique Tu Deh-Kah en Colombie-Britannique (Tu Deh-Kah Geothermal, 2025). On considère cette option moins réalisable en raison de l’utilisation limitée de ces types de systèmes au Canada dans son ensemble.
- Une centrale de cogénération électrocalogène, avec comme matière première principale la biomasse, le gaz naturel ou le biocombustible. Un système de chauffage à la biomasse qui dessert l’immeuble commercial existant pourrait être remplacé par une centrale électrocalogène, ce qui permettrait d’ajouter une charge thermique supplémentaire, comme la production d’aliments tout au long de l’année (comme des serres), et d’assurer ainsi la sécurité alimentaire en plus de la sécurité énergétique. Le parc énergétique communautaire de North Bay, en Ontario, est un excellent exemple d’un tel système (Parc énergétique communautaire, n.d.).
Parmi les points importants que la Première Nation d’Amlamgog devait prendre en compte, il y avait la sélection d’un système qui pourrait procurer des avantages carboneutres au chapitre de l’environnement et des émissions, en plus d’accélérer la mission de la communauté pour l’atteinte de la carboneutralité. En 2025, le réseau électrique du Nouveau-Brunswick a une intensité en carbone de 350 g d’éq. CO2/kWh (gouvernement du Canada 2024). Il faudrait utiliser un SED avec production intégrée pour démontrer que les émissions globales de GES de la communauté étaient inférieures par rapport à l’utilisation du réseau provincial.
[Cliquez pour voir en français] Ta’n kespi wikasik: tepiaql espitasikl etekl kiskuk ukjit ika’lan Amlamkuk (aqq pilewe’l utann) ukjit sia’wa’tun ta’n tel-lukwutijik ukjit mesnmk teliknaq Wksankewo’ti aqq teliknaq newtukwa’lukwemk. Ta’n anqateskawekl? Ta’n tetpaqa’qewey weskewita’mk aqq we’jitmk ta’n na melkiknaq lukwaqn telitpiaq ukjit kina’muen ta’n welapetmk ta’n ula kisite’tasikl we’jitasikl kisitasikl ala’tutal msit teliknaq kelpitmk ukjit msit New Brunswickewaq.
Essentiellement, il existe suffisamment de technologies aujourd’hui pour permettre à Amlamgog (et à d’autres communautés) de réaliser sa mission, à savoir assurer sa souveraineté et son indépendance au chapitre de l’énergie. Les obstacles? La réglementation et l’établissement d’une analyse de rentabilisation solide pour démontrer les avantages que procureraient ces systèmes stratégiquement situés dans le domaine de la sécurité énergétique globale de tous les Néo-Brunswickois.
Que doit-il se produire?
Pour faire avancer la mise en œuvre des SED dans les communautés des Premières Nations, la présente étude de cas fait un ensemble de recommandations, notamment la réalisation d’une analyse et d’une modélisation détaillées des avantages potentiels, la mise en place d’un bac à sable réglementaire et la modification de la politique et du cadre réglementaire régissant l’électricité au Nouveau-Brunswick.
- Nikana’te’n L’nuey-nikana’tasik Teliknaql Tel-lukwemkl | Accorder la priorité aux initiatives énergétiques menées par des Autochtones
La modification de la politique énergétique provinciale afin de soutenir précisément les Premières Nations quand vient le temps d’élaborer leurs propres projets énergétiques favorisera la souveraineté énergétique et le développement économique. Le programme gouvernemental de production locale d’énergie renouvelable à petite échelle d’Énergie NB, qui accordait la priorité à des projets d’énergie renouvelable (< 20 MW) à petite échelle auxquels des partenaires des Premières Nations prenaient part, représente un exemple des démarches qui ont donné de bons résultats dans le passé (gouvernement du Nouveau-Brunswick, 2016). L’évolution complète pourrait comprendre la création de mécanismes au moyen desquels les Premières Nations auraient des voies pour commercialiser leurs propres solutions énergétiques novatrices.
- We’jite’n aqq Elte’n ta’n Lukwaqn Telitpiaq | Définir l’analyse de rentabilisation et en faire un modèle
Il faut procéder à une modélisation plus robuste de l’avantage net que pourraient procurer les SED aux contribuables et au réseau provincial. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick ou Énergie NB pourraient commander une telle étude, en partenariat avec les Premières Nations de la province et d’autres organisations non gouvernementales, comme le Smart Grid Innovation Network (Réseau d’innovation Smart Grid, s.d.). Certains partenaires fédéraux, comme le Programme des énergies renouvelables intelligentes et de trajectoires d’électrification de Ressources naturelles Canada, pourraient représenter une source de financement à l’appui de cette initiative, tout comme les accélérateurs de l’innovation, dont Foresight Canada. Les profils de demande de pointe, les études de connexion au réseau, l’intégration et les contrôles du système sont tous des éléments qui nécessitent une étude plus approfondie.
- We’jite’n Amlamkuk ta’n na Wikimk Wetnu’kwatmkuo’kuo’m aqq Espitasik Kejitoq Maqmikew | Faire d’Amlamgog un laboratoire vivant et un terrain de démonstration de la technologie
De la même manière que Shediac, au Nouveau-Brunswick, est devenue un centre de démonstration pour l’intégration de l’énergie solaire à l’échelle du réseau, de l’énergie solaire en aval du compteur associée à des systèmes de stockage d’énergie par batterie et à des thermostats intelligents dans un projet de communauté énergétique intelligente de Shediac, Amlamgog est bien avancée et se positionne comme site d’accueil pour l’intégration d’un microréseau communautaire et d’une production d’énergie durable. La De la même manière que Shediac, au Nouveau-Brunswick, est devenue un centre de démonstration pour l’intégration de l’énergie solaire à l’échelle du réseau, de l’énergie solaire en aval du compteur associée à des systèmes de stockage d’énergie par batterie et à des thermostats intelligents dans un projet de communauté énergétique intelligente de Shediac, Amlamgog est bien avancée et se positionne comme site d’accueil pour l’intégration d’un microréseau communautaire et d’une production d’énergie durable. La meilleure façon d’établir cet écosystème est de le considérer comme une sorte de « bac à sable réglementaire » qui permet aux entreprises, plus particulièrement aux entreprises en démarrage et aux personnes qui innovent, mais, dans ce cas, également aux services publics et aux partenaires du secteur privé, de mettre à l’essai leurs produits, leurs services ou leurs modèles opérationnels dans un environnement contrôlé. La province du Nouveau-Brunswick pourrait définir les conditions nécessaires pour un tel laboratoire au moyen de modifications au règlement.
- Wesuwa’tasik ta’n na Iknmuetmk Teliknaq Apoqnmuek Tel-wikasik Telita’simk | Adopter un état d’esprit axé sur la politique en matière de ressources énergétiques distribuées
Pour aller au-delà de ces projets pilotes, la présente étude de cas recommande à la province d’adopter et d’intégrer un état d’esprit axé sur la politique en matière de ressources énergétiques distribuées à l’échelle de la communauté. Au cours des dernières années, des modifications ont été apportées à maintes reprises à la Loi sur l’électricité, dont le projet de loi no 10 (gouvernement du Nouveau-Brunswick, 2023), qui prévoit la vente d’électricité d’une installation de production à l’aide d’une énergie renouvelable (comme les éoliennes) directement à un nouveau consommateur d’électricité, en plus de permettre l’établissement du tarif maximal qu’Énergie NB peut payer pour l’électricité produite par de petits réacteurs modulaires de pointe par un règlement. Il existe aujourd’hui un cadre stratégique qui permet la production d’énergie renouvelable et à faibles émissions de carbone « dans les limites de l’installation » de grands sites industriels de la province; les modifications qui établissent que les communautés des Premières Nations sont dans les limites de l’installation sont une voie potentielle. D’autres voies comprennent des structures pour permettre la vente au détail d’énergie renouvelable, comme le jardin solaire communautaire de Nova Scotia Power (Nova Scotia Power – An Emera Company, 2025), ou l’élargissement de la production d’énergie renouvelable à facturation nette afin de monnayer et d’encourager la réintégration de la capacité excédentaire dans le réseau, surtout en période de pointe.
Exemples additionnels de projets novateurs en matière d’énergie menés par des Autochtones
Sur l’île de la Tortue, il existe de nombreux autres exemples d’innovations menées par les Autochtones dans le cadre de la transition énergétique qui procurent une valeur à la société. La clé de ces projets repose sur un ensemble de conditions habilitantes, notamment des catalyseurs financiers, des modifications législatives et des conditions sur le marché de l’énergie.
| Projet | Sree Vyàa (projet d’énergie solaire d’Old Crow) | Projet d’énergie géothermique Tu Deh-Kah | Projet de microréseau de la Première Nation de Montana |
| Lieu | Old Crow, Yukon | Fort Nelson, Colombie-Britannique | Première Nation de Montana, Alberta |
| Nation participante | Première Nation des Gwitchin Vuntut | Première Nation de Fort Nelson | Première Nation de Montana |
| Approche | Réseau d’énergie solaire à courant continu de 940 kW, système de stockage d’énergie par batterie de 616 kWh et contrôleur de microréseau ayant remplacé la dépendance historique à l’égard des génératrices diesel. | Production de 7 à 15 MW d’électricité propre grâce à un système géothermique binaire en boucle fermée avec des turbines à cycle de Rankine à caloporteur organique, ce qui est suffisant pour alimenter environ 10 000 foyers. | Akamihk Energy, qui appartient à la Première Nation de Montana, étudiera la possibilité d’intégrer toutes les infrastructures de distribution d’électricité et les services sur les terres de la Première Nation de Montana à un microréseau consolidé, de gérer les flux d’énergie dans ce réseau et de procéder à un échange de compteurs avec l’Alberta Interconnected Electric System. |
| Répercussions | Remplace 190 000 litres de carburant diesel par an, réduit les émissions annuelles de GES de 680 t éq. CO₂ et génère des recettes de 10,5 millions de dollars pour la Nation au cours d’un cycle de vie de 25 ans. | Transformation du champ de gaz naturel existant en installation géothermique durable. Au-delà de la production d’électricité, le projet prévoit exploiter la chaleur excédentaire pour réaliser d’autres activités économiques, comme l’agriculture, le tourisme et le chauffage des bâtiments, favorisant ainsi la sécurité énergétique et la croissance économique dans la région. | Akamihk Energy est une entreprise qui appartient en totalité à la Première Nation de Montana. Elle est exploitée sous la forme d’une association d’électrification rurale. L’entreprise est exploitée sans lien de dépendance avec le chef et le conseil de la Première Nation de Montana. En plus des avantages que procure la production d’électricité à la PN, l’entreprise comprend l’agrivoltaïsme, la construction de maisons neuves et la vente de lampadaires. |
| Conditions habilitantes | Le gouvernement du Yukon a créé des lois, y compris un règlement nécessaire sur la politique visant les producteurs indépendants d’électricité, afin de rendre ce projet possible, ce qui démontre comment les gouvernements et les communautés peuvent s’associer pour tirer parti des possibilités. | Première centrale géothermique commerciale appartenant en totalité à des Autochtones en Colombie-Britannique, Tu Deh-Kah Geothermal est un exemple de leadership autochtone en matière de développement énergétique durable. Le permis pour ce projet a été accordé par le ministère de l’Énergie, des Mines et de l’Innovation à faible émission de carbone. | Financement de la capacité (1 M$) du programme Énergies renouvelables intelligentes et trajectoires d’électrification de RNCan, et marché de l’énergie déréglementé. |
| Références | https://arctic-council.org/news/the-old-crow-solar-project/ | https://tudehkah.com | https://akamihkenergy.com |
Voie à suivre
La voie vers un avenir carboneutre passe par les territoires autochtones traditionnels. Il n’existe pas de voie vers un avenir carboneutre sans l’inclusion des Autochtones.
Alors que le principe généralement accepté de l’inclusion des Autochtones est aujourd’hui centré sur les possibilités de participer aux nouveaux projets d’exploitation énergétique, comme le projet Neweg Energy, la province du Nouveau-Brunswick et le service public provincial (Énergie NB) disposent d’une nouvelle occasion de travailler plus étroitement avec les partenaires des Premières Nations afin de résoudre les défis difficiles auxquels le réseau électrique fait face aujourd’hui.
Les SED ont prouvé leur application et leur valeur dans plusieurs cas d’utilisation, dont certains font l’objet d’une évaluation dans la présente étude de cas.
Les obstacles à l’adoption de ces systèmes à plus grande échelle ne sont toutefois pas de nature technologique. C’est plutôt l’écosystème du marché de l’électricité au Nouveau-Brunswick qui restreint actuellement l’adoption de ce type d’innovation.
Des modifications aux politiques, aux lois et aux règlements ou bien la création d’un « bac à sable réglementaire » pourraient accélérer l’adoption de systèmes énergétiques novateurs, comme l’un des outils de la boîte à outils de la transition énergétique.
Les communautés des Premières Nations au Nouveau-Brunswick, comme le montre la Première Nation d’Amlamgog, ont entamé de premières étapes audacieuses au cours des dernières années pour assurer leur carboneutralité. La planification énergétique communautaire, les investissements dans les actifs de production d’énergie en aval du compteur, les engagements visant à réduire l’empreinte énergétique et carbone de l’infrastructure des immeubles résidentiels et commerciaux et la promotion d’initiatives, y compris l’électrification du parc et le déploiement d’une infrastructure de recharge pour les VE, sont quelques-unes des premières réalisations.
Une grande partie des travaux préparatoires ayant déjà été effectués, une Première Nation comme celle d’Amlamgog, qui est à l’avant-garde de la transition énergétique depuis un certain temps, est maintenant prête à participer pleinement à l’élaboration d’une réforme des politiques et des règlements afin de permettre une vaste intégration des SED sur le marché du Nouveau-Brunswick. Le cas échéant, les avantages pourraient être réalisés dans l’ensemble du réseau provincial.
Les Premières Nations montrent déjà la forme que prendront les communautés durables à l’avenir. Il est venu le moment d’éliminer les obstacles à cette force d’innovation au profit de l’ensemble de la population canadienne. Qui est mieux placé pour le faire que nos Premières Nations?
Travaux cités (certains ne sont accessibles qu’en anglais)
Baker, Oscar III. 2022. Mi’kmaw community hopes net-zero building reduces carbon footprint and saves money. 16 septembre. CBC News. https://www.cbc.ca/news/indigenous/mi-kmaq-net-zero-building-1.6583720
CBC News, 2021. Fort Folly First Nation makes big switch to solar energy.
https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/fort-folly-solar-energy-1.6218146
CBC News, 2022. Mi’kmaw community hopes net-zero building reduces carbon footprint and saves money.
https://www.cbc.ca/news/indigenous/mi-kmaq-net-zero-building-1.6583720
Coalition des grands projets des Premières nations, 2023. Stratégie nationale d’électrification autochtone – Stratégie visant à accélérer la propriété autochtone de l’infrastructure carboneutre au Canada.
https://fnmpc.ca/wp-content/uploads/FNMPC_National_Electrification_digital_final_04222024.pdf
Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick. 2025. https://nbeub.ca/fr/home.
Conseil de conservation du Nouveau-Brunswick. 2023. L’énergie éolienne est fiable : dissipons les allégations selon lesquelles l’énergie éolienne a laissé tomber les Néo-Brunswickois lorsqu’ils en avaient le plus besoin. Mai. https://www.conservationcouncil.ca/wp-content/uploads/2023/05/Wind-energy-is-reliable-FRE.pdf
Énergie NB. 2023. Plan intégré des ressources 2023 : Voies vers un réseau électrique à consommation nette zéro. https://www.nbpower.com/fr/a-notre-sujet/notre-energie/plan-integre-des-ressources-2023-voies-vers-un-reseau-electrique-a-consommation-nette-zero
Énergie NB. 2023. Lignes directrices du programme sur l’efficacité énergétique pour les Premières Nations.
Énergie NB. 2023. Énergie NB invite les Néo-Brunswickois intéressés à soumettre une déclaration d’intérêt pour des solutions d’énergie éolienne, solaire, marémotrice et de stockage. Nouvelle. 10 février. https://www.nbpower.com/fr/about-us/news-media-centre/news/2023/nb-power-inviting-interested-new-brunswickers-to-submit-expression-of-interest-for-wind-solar-tidal-power-and-storage-solutions/
Énergie NB. 2024. Projet énergétique Neweg : Ouvrir la voie à un avenir énergétique durable au Nouveau-Brunswick. Nouvelle. 17 janvier. https://www.nbpower.com/fr/about-us/news-media-centre/news/2024/neweg-energy-project-leading-the-way-to-a-sustainable-energy-future-in-new-brunswick/
Énergie NB. 2024. Notre énergie. https://www.nbpower.com/fr/a-notre-sujet/notre-energie
Énergie NB. 2024. Demande de déclaration d’intérêt – DDI concernant l’intégration de sources d’énergie renouvelable et la sécurité du réseau. 26 juin.
Énergie NB. 2025. Notre énergie.
https://www.nbpower.com/en/about-us/our-energy
Énergie NB. 2025. Projet de communauté énergétique intelligente de Shediac. https://www.nbpower.com/fr/modernisation-du-reseau/reseau-intelligent-de-latlantique/projet-de-communaute-energetique-intelligente-de-shediac
Gouvernement du Canada, 2024. Facteurs d’émission et valeurs de référence – Version 2.0. https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/climate-change/pricing-pollution-how-it-will-work/output-based-pricing-system/federal-greenhouse-gas-offset-system/emission-factors-reference-values.html
Gouvernement du Canada. 2025. Population inscrite – Fort Folly. Janvier. https://fnp-ppn.aadnc-aandc.gc.ca/fnp/Main/Search/FNRegPopulation.aspx?BAND_NUMBER=9&lang=fra
Gouvernement du Nouveau-Brunswick. 2013. Loi sur l’électricité du Nouveau-Brunswick. 21 juin.
Gouvernement du Nouveau-Brunswick, 2016. Énergie NB invite les Premières nations à participer à un projet d’énergie renouvelable.
https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/erd/news/news_release.2016.01.0064.html
Gouvernement du Nouveau-Brunswick, 2023. Projet de loi 10 – Loi modifiant la Loi sur l’électricité.
https://www.legnb.ca/content/house_business/60/3/bills/Bill-10.pdf
Natural Forces Solar. 2024. Fort Folly First Nation. https://naturalforcessolar.ca/commercial/fort-folly-first-nation/
North Bay Hydro Services. s. d. The first microgrid of its kind in Canada. Community Energy Park: How It Works. http://www.communityenergypark.ca
Nova Scotia Power – Une société Emera, 2025. Jardin solaire communautaire : Accessible Solar Power for Nova Scotians.
https://www.nspower.ca/cleanandgreen/innovation/smart-grid-nova-scotia/community-solar-garden-pilot
Parc énergétique communautaire. (n.d.). North Bay, Ontario – Le premier micro-réseau de ce type au Canada.
http://www.communityenergypark.ca
Pepermans, G., J. Driesen, D. Haeseldonckx, R. Belmans et William D. D’Haeseleer. 2005. “Distributed generation: definition, benefits and issues.” Energy Policy 33 (6): 787-98.
Quest Canada. 2024. Fort Folly First Nation Community Energy Assessment. Mai.
Quest Canada. 2024. Résumé de l’atelier d’élaboration d’un plan communautaire en matière d’énergie et d’émissions. 15 avril.
Silberman, Alexandre. 2021. Fort Folly First Nation makes big switch to solar energy. 21 octobre. CBC News. https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/fort-folly-solar-energy-1.6218146
Réseau d’innovation Smart Grid. (n.d.). À propos – Mission & Vision.
https://www.sgin.ca/aboutTu Deh-Kah Geothermal. (2025). Tu Deh-Kah Geothermal – Home.
https://tudehkah.com
Exploiter l’énergie renouvelable non utilisée au Canada

Les auteurs dédient ce document à la mémoire de Byron LeClair. Ces travaux ont été rendus possibles grâce aux efforts qu’il a déployés.
Introduction
En période d’incertitude, une chose est évidente : les communautés autochtones du Canada joueront un rôle central dans la transition évolutive vers l’énergie propre. Un rapport récent de l’Institut climatique du Canada montre que ce processus de réconciliation économique fondé sur la durabilité est sur la bonne voie; au cours des dernières décennies, on a constaté une augmentation des projets autochtones en matière de production d’énergie propre. Les temps changent. Les entités autochtones jouent désormais un rôle important dans d’autres aspects de la transition énergétique, allant au-delà de la production d’énergie classique, comme l’énergie solaire, l’hydroélectricité au fil de l’eau et l’énergie éolienne. Cette évolution nécessaire comprend la mise en service d’une nouvelle infrastructure de transport. L’extrait ci-dessous, tiré du rapport Les vagues du changement de 2022 de l’Institut climatique du Canada mentionné plus haut, confirme l’autochtonisation émergente du transport et l’avenir concret, pratique et aucunement appelé à être normatif de cette augmentation de la participation des Autochtones au chapitre du transport de l’électricité :
La période de 2015 à 2020 a aussi été marquée par une forte augmentation de la participation autochtone aux projets de transport d’électricité. Au total, 19 projets ont été réalisés ou entrepris, dont des projets majeurs raccordés au réseau (ex. : projet hydroélectrique de la Romaine, au Québec), des projets d’interconnexion communautaire hors réseau (ex. : projet de Wataynikaneyap Power, en Ontario) et des projets de renforcement du réseau (ex. : ligne Bipôle III, au Manitoba).
En particulier, les organisations autochtones participent à ces secteurs capitalistiques en tant que dirigeantes et propriétaires majoritaires. Dans ce nouvel environnement participatif, il est nécessaire d’ajouter des commentaires ancrés dans la communauté et axés sur les responsables des politiques. L’intégration des populations autochtones dans les projets de nouvelles lignes de transport d’électricité présente des avantages juridiques, sociaux, économiques et (ce qui est particulièrement important ici, compte tenu des forums) environnementaux. Il est essentiel que les responsables des politiques au Canada prennent soigneusement en compte ces avantages au moment de déterminer la meilleure façon d’affecter le peu de temps et d’argent dont ils et elles disposent à la réconciliation économique avec les Autochtones et à l’atténuation des changements climatiques, deux défis déterminants pour le Canada au 21e siècle.
[Cliquez ici pour voir la version en français] Ōma nīhithaw kakīskīkīmowin-masinahikan ikīmasinahikātīk, kawīcihikocik omistikōsiwak, aniki kātoskātākwāw pithīsīskotīw, ka-kiskīthītākwāw īsi nīhithawak ka-mitho-wītatoskīmīcik, īsi nīhithawak kā-isi-nistōtākwāw ōmītowak atoskīwin.
En gardant ces tendances à l’esprit, la perspective autochtone suivante est axée sur le maintien de l’élan en ce qui concerne la participation des Autochtones aux projets d’infrastructures de transport, en tenant compte des options pragmatiques qui pourraient accélérer les progrès existants.
Nous considérons que notre travail répond en partie à un déséquilibre dans la littérature sur la transition énergétique pour ce qui est de la mobilisation des Autochtones dans la production d’électricité propre. Cette (sur)importance historique, bien que louable et compréhensible, doit maintenant s’étendre à la transmission (ainsi qu’à d’autres sujets pertinents touchant la chaîne de valeur de l’électricité, comme la distribution de l’électricité). Des recherches approfondies montrent que le leadership et la participation des Autochtones sont possibles quant à de multiples dimensions de la transition énergétique complexe (cliquer ici pour voir nos travaux les plus récents sur ce sujet, et ici pour consulter nos travaux antérieurs sur les nouvelles idées autochtones en matière de transport). Dans le présent document, nous mettons l’accent sur des bases conceptuelles concrètes et réalistes à l’intention des responsables des politiques souhaitant faire avancer des projets d’électricité incluant les Autochtones qui auront des retombées générales pour la population canadienne.
Qui nous sommes
Menée par Frank Busch, le premier PDG inscrit visé par un traité d’une entreprise canadienne de niveau 1 cotée en bourse, cette perspective intègre un point de vue autochtone ancré et corroboré par les réflexions et les expériences des auteurs qui y ont collaboré. Nous commençons cette section en insistant sur le fait que cette perspective autochtone est une perspective éclairée, mais très spécifique à une ou à plusieurs personnes, ancrée dans les pratiques de développement énergétique et économique des communautés autochtones. En outre, il ne s’agit pas de la perspective prédominante de chaque communauté. En fait, il ne faut même pas la considérer comme la perspective collective de la nation des Cris de Nisichawayasihk (Nee-chise-away-a-see), dont est originaire Frank Busch. Nous espérons plutôt que ce travail favorisera un dialogue naissant, mené par les Autochtones, sur les aspects qui ne sont pas liés à l’opération de la transformation de l’énergie propre.
En tant qu’équipe d’auteurs autochtones et non autochtones, nous cherchons à fournir ce que sont, selon nos expériences de praticiens et d’universitaires, des pratiques exemplaires et de choix pour les communautés qui cherchent à déterminer à quoi servira finalement leur participation à l’avenir du transport d’électricité au Canada. Nos recommandations tiennent compte de certaines théories et de certains documents existants, tout en restant ancrées dans la pratique (en prenant particulièrement en compte les expériences vécues et les observations directes de l’auteur principal).
Pour ne citer que quelques exemples du contexte sur lequel nous nous appuierons, Frank Busch a visité plus de 300 communautés autochtones au cours des deux dernières décennies, tandis que les autres membres de l’équipe de rédaction ont vécu dans des communautés isolées (Joel Krupa) ou ont soutenu des évaluations environnementales menées par des Autochtones dans l’Ouest canadien (Kevin Hanna – voir Nishima-Miller et coll.). Ces travaux résument l’expérience au chapitre de la transition énergétique et du développement communautaire acquise pendant ces décennies, à laquelle s’ajoutent des exemples tirés de la littérature ou du monde réel, allant des essais de faisabilité à un stade précoce aux opérations à long terme.
Pourquoi le transport importe-t-il et pourquoi la propriété autochtone représente-t-elle un triple avantage rare sur les marchés de l’énergie?
La mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, que le Canada a signée, exige que tous les projets de transport d’électricité prévus dans le cadre de l’objectif du Canada qui est de parvenir à la carboneutralité d’ici 2050 fassent l’objet d’une consultation auprès des Autochtones, que ces derniers et dernières aient part au capital ou aient part à la construction. Même en 2025, de nombreuses communautés autochtones continuent de dépendre d’une électricité produite avec du diesel qui s’avère coûteuse, souvent peu fiable et parfois dangereuse, qui nuit aux efforts déployés par les nations pour développer les économies locales et offrir de meilleures perspectives aux jeunes. Ce statu quo, qui découle au moins en partie des lacunes en matière de transport, aboutit à ce que Kristen van de Biezenbos appelle la pauvreté énergétique persistante au Canada. Comme le souligne Kristen van de Biezenbos, non seulement cette situation crée une injustice énergétique inacceptable, mais elle étouffe également la croissance économique dont nous avons tant besoin. Il est peu probable que la pauvreté persistante en matière d’énergie change sans une nouvelle réflexion sur les projets de transport en particulier.
Au-delà de la base sociojuridique solide des nouvelles actions déployées au chapitre du transport décrites jusqu’à présent, la motivation liée au climat pour accroître la prise en compte des Autochtones dans l’analyse des projets de transport de l’électricité est tout aussi évidente. Cela pourrait se faire dans un vaste éventail de scénarios, comme le prolongement prévu des lignes intraprovinciales existantes ou, à moyen terme, les liens facilitant la hausse du commerce de l’électricité entre les provinces, des lignes supplémentaires reliant le Canada et les États-Unis, ou même (plus théorique) des connexions intraprovinciales de grande distance entre des régions peu peuplées, mais riches en électricité propre, et les centres industriels ou les régions urbaines qui ont besoin d’un approvisionnement supplémentaire en électricité. Souvent, on envisage la transition vers l’énergie propre comme un exercice de mise en service de niveaux beaucoup plus élevés de ressources éoliennes, solaires et hydroélectriques. Toutefois, sans interconnexions de transport adéquates, l’énergie renouvelable produite (qui est souvent située dans des endroits éloignés dotés d’excellentes ressources éoliennes ou d’un ciel ensoleillé) n’a nulle part où aller. Bien qu’il soit sous-estimé, le transport est le point d’ancrage de la réalisation des grandes ambitions en matière de changement climatique.
Des études canadiennes montrent que l’expansion et l’interconnexion des réseaux de transport permettent de réaliser des économies systémiques et de réduire les émissions, par exemple en valorisant mieux l’extraction en matière d’énergie propre et en augmentant la valeur des politiques de tarification du carbone. Comme le suggérait l’article important s’intitulant The cost of decarbonizing the Canadian electricity system, le transport représente également pour la population canadienne l’une des options de réduction des émissions dont le coût est le plus bas.
[Click here to see the English version] ōma pithīsīskotīw atoskīwin ōta ministik kānata kwayask mistahi atoskīwin, mistahi mīna ikota oci kakī-sōniyākipathiw māka, poko nīhithawak kawītatoskīmīcik.
Tout simplement, l’exploitation du potentiel d’électricité renouvelable du Canada nécessite d’importants investissements dans le transport. Ce transport ne peut se faire qu’avec l’inclusion des Autochtones.
Évidemment, obtenir des résultats optimaux est plus facile à dire qu’à faire. En fait, la construction de lignes de transport est un processus long et ardu. Le transport d’électricité exige d’énormes mises de fonds, la capacité de réunir et d’organiser une équipe diversifiée de professionnels et professionnelles (juridiques, techniques et autres) pendant plusieurs années, voire plusieurs décennies, et la capacité de surmonter un nombre remarquable d’obstacles différents. Parmi les sujets préoccupants, la feuille de route historique de l’intégration accrue du transport (comme au Manitoba, la province de Frank Busch) suggère que les résultats environnementaux obtenus ne sont pas uniformément avantageux. Bien que ces contraintes et ces inconvénients dépassent grandement le champ d’application de cette brève étude de cas, nous voulions nous assurer qu’ils soient reconnus d’emblée alors que nous nous apprêtons à fournir des points de départ concrets que les responsables des politiques, en particulier, devraient prendre en considération.
Prochaines étapes pragmatiques pour permettre aux responsables des politiques de soutenir l’intégration des Autochtones dans le transport d’électricité
De nombreuses communautés autochtones cherchent à développer des économies locales, durables et respectueuses de l’environnement, en plus d’accroître l’accès à l’emploi de leurs membres grâce à des actifs générateurs de revenus susceptibles d’améliorer leur situation financière. Les recommandations suivantes sont cinq recommandations précises, qui recoupent toute la série de recommandations beaucoup plus longue fournie dans la récente stratégie autochtone nationale d’électrification de la First Nations Major Projects Coalition. Nous formulons les recommandations suivantes comme points de départ pour les responsables des politiques œuvrant auprès des Autochtones afin qu’ils et elles considèrent les moyens possibles de parvenir à une plus grande souveraineté économique et politique pour leur avenir énergétique.
Piyak-kakīskīkīmowin: kāpacītāniwaki ōki “5 Cs” masinahikan
Recommandation 1: mettre en œuvre le cadre des « 5 C »
Dans l’article publié en 2012 s’intitulant Identifying barriers to Aboriginal renewable energy deployment in Canada, Joel Krupa a décrit les principes fondamentaux d’un cadre réussi de déploiement de l’énergie renouvelable par des Autochtones. À l’époque, on avait souligné qu’il était essentiel de mettre l’accent sur trois « C », soit le capital (l’argent), la clarté (plus précisément au chapitre des règlements et des politiques) et la capacité (particulièrement dans les communautés et les réserves). Offrir un accès accru aux capitaux reste la principale priorité des communautés autochtones à la recherche de possibilités dans le domaine de l’énergie renouvelable, tout comme le fait d’améliorer la clarté des règlements et des politiques pour les personnes à la tête des communautés. Il reste également nécessaire de renforcer la capacité des communautés dans différents domaines (humains, comme nous l’avons déjà indiqué, mais aussi techniques, financiers et autres).
Au cours de la dernière décennie, nous avons élargi le cadre des « 3 C » pour y inclure les champions et championnes de l’absence de corruption et les champions et championnes de la communauté et ainsi former les « 5 C ». Le premier concept est explicite, tandis que le second appelle à une innovation permanente au sein des communautés afin de garantir l’émergence et l’épanouissement de visionnaires communautaires capables de mettre en œuvre une planification à long terme difficile.
Ces concepts prennent racine dans l’expérience sur le terrain de Frank Busch ainsi que dans l’expérience acquise par Joel Krupa pendant les nombreuses années passées à travailler pour la Première Nation Biigtigong Nishnaabeg (anciennement les Ojibwés de la Première Nation de Pic River) et à vivre dans cette communauté, qui fait partie des pionniers dans le domaine de l’énergie propre autochtone. Ce parcours, décrit dans Blazing a new path forward : A case study on the renewable energy initiatives of the Pic River First Nation, a mis en évidence, à maintes reprises, les avantages remarquables du leadership du champion de cette communauté : le regretté Byron LeClair. (Le rôle de ce dernier, plus précisément, est confirmé dans des textes essentiels, comme Aboriginal Power : Clean Energy and the Future of Canada’s First Peoples de Chris Henderson et Phil Fontaine.) La ténacité et le dévouement de LeClair ont joué un rôle prépondérant dans la constitution d’un panier éventuel d’énergies propres comprenant, entre autres, l’un des premiers sites hydroélectriques au fil de l’eau appartenant entièrement à des Autochtones.
[Click here to see the English version] Aniki nīhithaw-itāwina āsay kā-sōki-atoskāsocik, iyakwani mwāci kāmithokāpawicik ispihk ōma pithīsīskotīw-atoskīwin pikiskwācikātīki, iyakwani nīkān kakī-pīkiskwātīcik.
Les communautés affichant une forte capacité, dirigées par des championnes et champions compétents et bien informés, sont les catalyseurs les plus importants pour les projets autochtones de transport d’électricité.
Nīso-kakīskīkīmowin: kanistawinikātīk nīhithaw kiskinwāhamākīwina, nīhithaw itāwina anohc kā-isi-pimipathītāniwaki, mīna īsi ōma pithīsīskotīw-atoskīwin kātī-isi-wathasowācikātīk.
Recommandation 2: reconnaître le lien entre les valeurs autochtones, les communautés autochtones contemporaines et la planification du transport d’électricité
Nous devrions être sceptiques face aux tentatives de présenter une voix « autochtone » homogène parmi l’ensemble des voix qui doivent définir toutes les tentatives faites au 21e siècle de communiquer avec les Autochtones. Néanmoins, on peut dire qu’il existe au moins deux thèmes communs qui tendent à unir les communautés autochtones :
- Elles souhaitent préserver l’intégrité de l’environnement, qui peut se manifester à différentes échelles (mondiale, régionale ou territoriale).
- Les communautés autochtones sont liées à la terre de multiples façons : physiquement, émotionnellement et spirituellement. Cette stabilité s’accompagne d’une probabilité relativement faible d’afflux importants d’immigrants et immigrantes dans de nombreuses communautés autochtones, en particulier dans les régions éloignées qui pourraient être touchées de manière positive par les projets de transport d’électricité.
Autrement dit, les caractéristiques des projets de transport d’électricité (notamment leur longue durée, leurs répercussions minimes sur les terres par rapport à d’autres projets d’infrastructure et leur capacité à faciliter l’intégration de technologies propres et renouvelables) vont de pair avec les valeurs autochtones générales, soit protéger la terre et vivre en relation étroite et respectueuse avec elle. D’autres caractéristiques des lignes de transport (comme leur potentiel de création d’emplois et leur présence physique dans des zones reculées) vont de pair avec les caractéristiques des communautés autochtones d’aujourd’hui.
C’est pourquoi il convient de noter que les communautés préféreront probablement un mode de transport favorable à la décarbonation plutôt que des solutions de rechange comprenant des combustibles fossiles, sauf s’il n’existe pas d’autres solutions de rechange attrayantes. Dans le cas de l’installation de gaz naturel liquéfié flottante Ksi Lisims proposée par la nation Nisg̱a’a, Shannon Waters montre qu’il existe des tensions entre les groupes autochtones à propos de l’exploitation de ce gaz. De toute évidence, il est difficile de demander aux communautés de renoncer à leur autonomie économique au profit d’avantages environnementaux à l’échelle du système. Parmi les domaines clés sur lesquels les responsables des politiques doivent mettre l’accent, il y a le fait de reconnaître l’existence de cette tension et de cet équilibre, et de s’efforcer d’offrir des solutions de rechange écologiques avantageuses et convaincantes aux projets ayant des répercussions plus importantes sur l’environnement.
[Click here to see the English version] Owathasowītinowak poko kamiskawācik aniki nīhithawak kā-nōtī-wītatoskīmīcik, aniki nīhithawak pimiy-atoskīwin kā-nōtī-atoskātākwāw- ōma transmission-atoskīwin kākī-māci-atoskācikātīw.
Les responsables des politiques doivent s’efforcer de trouver des solutions de rechange attrayantes pour les nations qui envisagent d’avoir recours aux combustibles fossiles, en commençant par le transport.
Nisto-Kakīskīkīmowin: manācītāk nīhithaw kiskīthītamowin, kistīthīta īsi kēhtē-ayak kā-isi-kiskīthītākwāw.
Recommandation 3: accorder la priorité aux perspectives des gardiens et gardiennes du savoir et des Aînées et Aînés autochtones
Le rôle indispensable que jouent les gardiens et gardiennes du savoir et les Aînées et Aînés quand vient le temps d’orienter une étape importante pour la communauté, comme la participation à un projet de transport, peut être facilement négligé en raison de l’enthousiasme que suscite la réalisation d’un nouveau projet. Il s’agit d’un processus pratique, qui peut être intégré à n’importe quel stade du cycle de vie du projet, y compris les toutes premières étapes. Il ne faudrait pas sous-estimer les avantages financiers concrets qu’une telle approche pourrait procurer. Par exemple, les promoteurs de longue date (eux-mêmes autochtones) de Five Nations Energy, dans le nord de l’Ontario, ont cherché à assurer la participation des Aînées et Aînés pour définir le tracé final du projet, des lignes de transport d’énergie à travers un terrain complexe sur le plan géomorphologique.
Frank Busch a été le témoin direct de l’élaboration d’un processus participatif novateur à l’occasion de la construction de la centrale électrique de Wuskwatim, un barrage hydroélectrique de 200 mégawatts d’une valeur de 1,3 milliard de dollars, et une ligne de transport d’électricité connexe de 300 millions de dollars construite à l’aide d’un partenariat entre la nation crie de Nisichawayasihk et Manitoba Hydro. Lors de l’élaboration du projet, des Aînées et Aînés reconnus ont été embauchés comme consultants communautaires et ont participé à la sélection du lieu, au droit d’entrée et de sortie et à la mobilisation communautaire, en compagnie d’ingénieurs et d’ingénieures et d’autres professionnels et professionnelles. Même si les spécialistes étaient, au départ, sceptiques, il est rapidement devenu évident qu’il y avait des synergies en raison des connaissances des Aînées et Aînés de la communauté qui étaient consultantes sur le terrain et des résidents et résidentes, le tout associé à des pratiques scientifiques judicieuses et à l’ingénierie.
En plus de ces contributions techniques utiles, il y avait également des avantages au chapitre de l’acceptation sociale. Le personnel de Manitoba Hydro savait qu’il allait devoir évoluer dans un milieu hostile, car nombre de membres de la communauté éprouvaient de la colère et du ressentiment à l’égard du service public provincial en raison du projet de dérivation de la rivière Churchill au début des années 1970. Si les Aînées et Aînés qui ont agi à titre de consultants communautaires n’avaient pas fait les présentations, il est probable que beaucoup de nombreux membres de la communauté auraient évité d’interagir de manière utile avec Manitoba Hydro (ou auraient même décidé de ne pas participer). Grâce à un dialogue approfondi avec la communauté et à un programme d’éducation de la population à l’appui, les citoyennes et citoyens de la nation crie de Nisichawayasihk ont commencé à considérer le projet comme une occasion économique et éducative. Le projet a finalement été achevé avec succès en 2006, créant une nouvelle voie pour les projets d’hydroélectricité au Manitoba (dont le projet Keeyask de 695 mégawatts d’une valeur de 8,7 milliards de dollars achevé en mai 2022).
[Click here to see the English version] Owathasowītino-masinahikīwak, nawac kakī-pimicisāhakwāw nīhithaw kiskīthītamowin ispihk kākithaw ōma pithīsīskotīw-atoskīwin atoskācikātīki -ispihk mīna transmission-atoskīwin atoskācikātīki.
Les responsables des politiques devraient mieux intégrer les connaissances des gardiennes et gardiens du savoir à chaque étape de la chaîne de valeur des technologies propres, y compris le transport.
Nīyo-kakīskīkīmowin: kinawāpāta kākithaw atoskīwina kāmitho-kīsītāniwaki ōta ministik-kānata mīna opimī
Recommandation 4: évaluer les retombées des projets réussis au Canada et ailleurs
Il existe des exemples de projets réussis riches en enseignements. Le premier point de départ le plus évident consiste pour les communautés à exploiter stratégiquement les possibilités que proposent les modèles de partenariat sous forme de consortium qui réunissent plusieurs communautés, tout en procurant une valeur ajoutée évidente à d’autres groupes d’intervenants, comme les contribuables ou les défenseurs et défenseuses de l’environnement. C’est le principe selon lequel « l’union fait la force ». Et c’est possible!
Une fiche de renseignements d’une grande entreprise de service public appartenant au secteur privé, NextEra Energy, fait état de plusieurs principes de base pour ce type de réussite dans une brève étude de cas sur le projet de raccordement électrique Est-Ouest dans le nord de l’Ontario, le long de la rive nord du lac Supérieur. Tout d’abord, sur un plan très élémentaire, le projet de raccordement électrique Est-Ouest de 450 kilomètres, que l’on décrit comme « l’un des plus grands investissements dans le réseau électrique du nord-ouest de l’Ontario depuis des décennies », a facilité l’expansion continue de la capacité (dont les investissements dans des actifs d’électricité propre) dans la région. Cela pourrait comprendre certains projets, comme l’énergie solaire, l’énergie éolienne et l’hydroélectricité au fil de l’eau, ainsi que des possibilités potentielles de décarbonation pour l’avenir, comme le nouveau projet des chutes Chigamiwinigum, situé à la fois dans le parc national Pukaskwa et sur le territoire traditionnel des Biigtigong Nishnaabeg. Le projet de 777 millions de dollars s’est efforcé d’assurer la participation d’une myriade de communautés autochtones et non autochtones le long de la ligne, les communautés autochtones ayant la possibilité de participer à la fois pour ce qui est des capitaux et des emplois au cours de la construction et de l’exploitation. Enfin, cette ligne achetée de manière concurrentielle offre d’excellents avantages en termes de fiabilité et de souplesse pour les contribuables, tout en proposant de nouvelles perspectives au secteur industriel.
Parmi les autres exemples aux États-Unis qui méritent d’être soulignés, il y a le nouveau financement tribal, mis en place grâce à des lois phares sur l’énergie propre de l’ère Biden. Le Greenhouse Gas Reduction Fund et le Loan Programs Office de l’administration Biden a fourni une assistance technique et un renforcement des capacités ainsi que des ressources pour le financement des projets d’énergie tribaux, allant du soutien à l’inclusion de prêteurs commerciaux à l’intégration d’outils de réduction des risques, comme des garanties de prêt pour un vaste éventail de projets.
Plus près de nous, des projets, comme celui de la ligne de transport Wataynikaneyap (ou « Watay »), ont non seulement contribué à l’électrification des communautés situées le long de son tracé, mais ont également aidé à améliorer l’environnement grâce à la réduction de l’utilisation du diesel et au potentiel d’intégration de l’énergie renouvelable améliorée et de croissance économique générale, qui peut comprendre des possibilités d’extraction de minéraux critiques capable de soutenir les technologies de décarbonation. Il ne s’agit là que de quelques idées : on a désormais accès à une multitude de leçons tirées de projets passés. Il serait bien que les futurs promoteurs fassent leurs devoirs.
[Click here to see the English version] Owathasowītino-masinahikīwak poko kakinawāpātākwāw aniki atoskīwina kākī-mitho-kīsītāniwaki, mīna ispihk kāti-māci-wathasowācikātīki nīhithaw-kiskinōtawi-masinahikana, kamamitonīthīcikātīki aniki āsay kākī-mitho-atoskācikātīki -mīna, aniki kīkwāya namwāc kākī-mithopathiki atoskīwina.
Les responsables des politiques doivent s’appuyer sur les réussites passées et, lorsqu’ils établissent les cadres de la participation autochtone, garder à l’esprit ce qui a fonctionné et, peut-être plus important encore, ce qui n’a pas fonctionné.
Niyānan kakīskīmowin: kākiskīthīcikātīk, kākithaw nīhithawak pītos isi-atoskīwak.
Recommandation 5: éviter une participation prescriptive et adapter les méthodes pour qu’elles tiennent compte du contexte
Lever des fonds à l’échelle nécessaire pour participer au transport d’électricité peut s’avérer difficile, mais c’est manifestement possible. Dans notre province, la Colombie-Britannique (C.-B.), des projets de transport et de distribution d’électricité de 36 milliards de dollars prévus par BC Hydro pourraient procurer d’importantes possibilités aux promoteurs autochtones et s’ajouteraient aux projets d’énergie propre de quelque 3 milliards de dollars appartenant à des Autochtones annoncés en décembre 2024 par le gouvernement provincial.
Cela signifie que les communautés doivent continuer de faire preuve de souplesse en ce qui a trait à la forme que pourraient finalement prendre les retombées d’un projet de transport. Ces avantages peuvent inclure des emplois dans le secteur de la construction, au début du projet ou tout au long de sa durée de vie, ou des possibilités de participation aux capitaux propres, leur permettant de détenir une part importante du projet, en fonction du capital humain et financier disponible. L’engagement pris par Hydro One de permettre aux nations autochtones de détenir une participation dans les capitaux propres de 50 % pour ce qui est des nouvelles lignes de transport d’électricité de l’Ontario est un exemple de mesure qui pourrait réduire les risques pour les partenaires autochtones, l’industrie et les prêteurs. Quelle que soit l’entente définitive, les projets de transport d’électricité peuvent offrir un vaste éventail de possibilités d’emploi, qu’il s’agisse de postes pour des membres de professions, comme des gestionnaires de projet qui supervisent des projets de construction pluriannuels, ou de métiers spécialisés et de postes polytechniques, comme des monteurs de lignes, qui assurent la fiabilité des opérations.
L’agnosticisme quant à la participatif s’étend également à l’échelle du projet réalisé. Par exemple, certaines communautés peuvent souhaiter réaliser l’interconnexion énergétique, d’autres pourraient soutenir la souveraineté énergétique, et d’autres pourraient encore accéder à des gains économiques. Cependant, elles doivent toutes faire preuve de pragmatisme au regard de la possibilité de financement du projet. Existe-t-il une politique et un règlement clairs, idéalement soutenus par des outils de réduction des risques, comme des garanties de prêt? Un copromoteur aux moyens importants pourrait-il fournir du financement? Existe-t-il plutôt des options de financement créatives, comme la syndication, les capitaux privés ou autres? Existe-t-il des spécialistes internes ou externes crédibles pour obtenir les meilleures conditions, optimiser la comptabilité et promouvoir une gouvernance organisationnelle responsable? Il faut avoir des conversations honnêtes et franches pour décider de la meilleure façon de faciliter la participation des Autochtones.
[Click here to see the English version] Namōtha kākithaw nīhithawak kakī-isi-pamiyāwak. Kisowāk kakī-wītatoskīmīcik nīhithawak. Īta kākaskītāniwak, kamitho-sītoskācik nīhithawak, nawac kamitho-wīcihisocik.
Les responsables des politiques doivent éviter de proposer des solutions homogènes à des communautés hétérogènes et, dans la mesure du possible, combler les lacunes en matière de capacité afin de garantir des règles du jeu équitables.
Dernières réflexions
Nous ne saurions trop insister sur le fait que, comme dans le cas des autres infrastructures, le transport de l’électricité a des impacts. Ces répercussions peuvent être d’ordre physique et modifier considérablement le paysage. (Les impacts des projets de Manitoba Hydro sur les communautés autochtones sont particulièrement instructifs à ce sujet.) Elles peuvent également être sociales ou émotionnelles, façonnant et modifiant la manière dont une communauté interagit avec son territoire traditionnel. Les responsables des politiques devraient faire tout ce qui est en leur pouvoir pour veiller à ce que les nouveaux projets soient réalisés en tenant compte de considérations économiques, sociales et environnementales (pas nécessairement dans cet ordre).
Cependant, malgré ces problèmes, nous restons optimistes et pleins d’espoir quant à l’avenir des projets de transport incluant les Autochtones au Canada. Comme nous l’avons souligné précédemment, nous avons élaboré cette brève perspective en tant qu’équipe formée de praticiens et d’universitaires autochtones et non autochtones. Les communautés autochtones partout au Canada pourraient faciliter l’établissement de l’infrastructure de transport indispensable pour assister à une révolution de l’énergie propre. En 2025 et au cours des années ultérieures, l’analyse du lien entre l’autochtonité et l’expansion du transport est une priorité essentielle de la recherche sur la décarbonation. L’intégration des voix et des perspectives autochtones sera nécessaire pour la transition énergétique au Canada et ailleurs dans le monde.
Ce n’est pas une simple question d’altruisme; c’est une réalité juridique. Ce n’est pas non plus une question visant à susciter l’enthousiasme. Les populations autochtones ont constaté la réussite de certains groupes hydroélectriques et de transport à l’œuvre, comme le travail de feu le chef Billy Diamond au Québec (comme décrit dans le livre Chief, de Roy MacGregor, publié en 1989), et sont tout à fait conscientes qu’il faut faire beaucoup plus et beaucoup plus vite. Nous soulignons la nature quelque peu atypique de la participation des Autochtones au marché de l’énergie propre au moyen de l’expansion du réseau de transport, qui est de type « gagnant-gagnant-gagnant » sur le plan économique, social et environnemental. Il est essentiel que les perspectives autochtones fassent partie de la planification fondamentale du transport d’énergie au Canada; sans une telle collaboration et de tels partenariats, il sera difficile de susciter la prospérité et d’obtenir les possibilités énergétiques dont le Canada a besoin.
Remerciements
Les auteurs remercient Naoko Ellis, Derek Gladwin, Maria Shallard, Jessie Sitnick, Jason Dion, Grace Donnelly et Avery Velez pour les commentaires et idées qu’ils et elles ont présentés, surtout au début de la rédaction du présent document. Les auteurs assument l’entière responsabilité de toute erreur contenue dans le présent document. Dans le cadre de son travail, Joel Krupa a reçu le soutien de Mitacs, par l’intermédiaire du programme Accélération. Joel Krupa remercie également le Fonds d’excellence en recherche Apogée Canada, plus précisément le programme Accélérer la transition énergétique des collectivités, pour son soutien. Les sources de financement n’ont eu aucune incidence sur la rédaction du présent document. Toutes les opinions exprimées et toutes les erreurs sont celles des auteurs. Frank Busch, Joel Krupa et Kevin Hanna affirment en outre que toutes les opinions exprimées dans le présent document représentent le point de vue des auteurs et ne doivent donc pas être considérées comme représentatives du point de vue de toute organisation à laquelle ils ont été, sont ou seront affiliés. Enfin, Joel Krupa et Frank Busch souhaitent remercier tout particulièrement Adita Ortega Perez et Angie Busch, qui ont offert un soutien considérable pour que cette perspective autochtone franchisse la ligne d’arrivée.
Références
Bennett, N. 2024. B.C. « First Nations want in on power transmission development. » Business in Vancouver. https://www.biv.com/news/resources-agriculture/bc-first-nations-want-in-on-power-transmission-development-9896205
Institut climatique du Canada. 2022. Les vagues du changement : Leadership autochtone dans l’électrification propre du Canada. https://institutclimatique.ca/wp-content/uploads/2022/02/ICE-report-FRENCH-FINAL.pdf.
CBC News.2014. Pic River First Nation plans hydroelectric plant in national park. https://www.cbc.ca/news/canada/thunder-bay/pic-river-first-nation-plans-hydroelectric-plant-in-national-park-1.2710039
Dolter, Brett, G. Kent Fellows et Nicholas Rivers. 2022. « The cost effectiveness of new reservoir hydroelectricity: British Columbia’s Site C project. » Energy Policy 169, 113161. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2022.113161
Dolter, Brett, et Nicholas Rivers. 2018. « The cost of decarbonizing the Canadian electricity system. » Energy Policy 113: 135-48. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2017.10.040
English, J., T. Niet, B. Lyseng, K. Palmer-Wilson, V. Keller, I. Moazzen, L. Pitt, et coll. 2017. « Impact of electrical intertie capacity on carbon policy effectiveness. » Energy Policy 101: 571-81. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2016.10.026
First Nations Major Projects Coalition. 2024. National indigenous electrification strategy. https://fnmpc.ca/wp-content/uploads/FNMPC_National_Electrification_digital_final_04222024.pdf
Gale, S., et J. P. Gladu. 2024. « Indigenous nations are the key to powering Ontario. » National Observer. https://www.nationalobserver.com/2024/10/02/opinion/indigenous-nations-are-key-powering-ontario
Gouvernement de la Colombie-Britannique. 2024. New wind projects will boost B.C.’s affordable clean-energy supply. Communiqué de presse. https://news.gov.bc.ca/releases/2024ECS0048-001643
Gouvernement du Canada. 2021. Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. L.C. 2021, ch. 14. Consulté sur le site https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/u-2.2/page-1.html
Gouvernement du Canada. 2024. Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/u-2.2/page-1.html
Harvey, L. D. Danny. 2013. « The potential of wind energy to largely displace existing Canadian fossil fuel and nuclear electricity generation. » Energy 50: p. 93-102. https://doi.org/10.1016/j.energy.2012.12.008
Henderson, Chris. 2013. Aboriginal power: Clean energy and the future of Canada’s First Peoples. Rainforest Editions.
Hydro One. s. d. Indigenous relations. https://www.hydroone.com/about/indigenous-relations
Keeyask Hydropower Limited Partnership. s. d. The project. https://keeyask.com/the-project/
Krupa, Joel. 2012a. « Blazing a new path forward: A case study on the renewable energy initiatives of the Pic River First Nation. » Environmental Development 3, p. 109-22. https://doi.org/10.1016/j.envdev.2012.05.003
Krupa, Joel. 2012b. « Identifying barriers to aboriginal renewable energy deployment in Canada. » Energy Policy 42 (1): p. 710-14. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2011.12.051
Krupa, Joel. 2013. « Realizing truly sustainable development: A proposal to expand aboriginal ‘price adders’ beyond Ontario electricity generation projects. » Utilities Policy 26: p. 85-87. https://doi.org/10.1016/j.jup.2012.07.008
Krupa, Joel, Frank Busch., Derek Gladwin, et NaokoEllis. 2025. « Financing clean technologies within Canada’s indigenous communities: Perspectives on sustainable energy transition from practitioners and academics. » Energy 322, 134930. https://doi.org/10.1016/j.energy.2025.134930
MacGregor, Roy. 1989. Chief: The fearless vision of Billy Diamond. Viking.
NextEra Energy. 2023. Transmission line continues to empower Indigenous communities and enhance electricity reliability in Ontario.https://newsroom.nexteraenergy.com/Transmission-line-continues-to-empower-Indigenous-communities-and-enhance-electricity-reliability-in-Ontario?l=12
NextEra Energy Transmission Canada. 2022. « East-West Tie. » https://www.nexteraenergycanada.com/content/dam/neecanada/ca/en/pdf/east-west-tie-transmission/EWT-Fact-Sheet-FINAL.pdf
Nishima-Miller, Jeffrey, Kevin S.Hanna, Jocelyn Stacey, Donna Senese, et William Nikolakis. 2024. « Tools for Indigenous-led impact assessment: Insights from five case studies. » Impact Assessment and Project Appraisal 42 (1): p. 70-87. https://doi.org/10.1080/14615517.2024.2306757
Organisation des Nations Unies. 2008. Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. (HR/PUB/08/4). https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2018/11/UNDRIP_F_web.pdf
Parker, Charlotte. 2023. « Finding a new stream of tribal clean energy financing. » Yale Center for Business and the Environment. https://cbey.yale.edu/our-stories/finding-a-new-stream-of-tribal-clean-energy-financing
Rutgers, Julia-Simon. 2024. « A dizzying bird’s-eye view of Manitoba’s hydro-electricity dams. » The Narwhal. https://thenarwhal.ca/manitoba-hydro-dams-photos/
Syed, Fatima. 2022. « Told ‘no’ 37 times, this Indigenous-owned company brought electricity to James Bay anyway. » The Narwhal. https://thenarwhal.ca/ontario-indigenous-owned-energy/
Syed, Fatima. 2024. « This 1,800-km transmission line brings clean, reliable power to 24 remote First Nations — who also own most of it. » The Narwhal. https://thenarwhal.ca/ontario-indigenous-energy-watay-power/
Van de Biezenbos, Kristen. 2022. « Lost in transmission: A constitutional approach to achieving a nationwide net zero electricity system. » Osgoode Hall Law Journal 59 (3): p. 629-66. https://doi.org/10.60082/2817-5069.3813
Wataynikaneyap Power. s. d. Home. https://www.wataypower.ca/
Waters, Shannon. 2024. « B.C.’s second-largest LNG project is one you’ve probably never heard of. » The Narwhal. https://thenarwhal.ca/bc-ksi-lisims-lng-facility-explainer/Wuskwatim Power Limited Partnership. s. d. « Wuskwatim Generating Station. » https://wuskwatim.ca/
