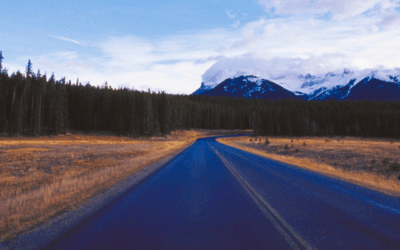La taxe sur les carburants est celle qui fait les manchettes; elle fait payer aux particuliers et aux petites entreprises du Canada le dioxyde de carbone issu de l’utilisation de combustibles fossiles. En faisant augmenter le prix de l’essence, du diesel et du gaz, elle incite les consommateurs à adopter des solutions plus sobres en carbone ou plus efficaces. Le gouvernement fédéral remet les revenus générés aux ménages canadiens sous la forme de remboursements trimestriels.
À l’opposé, les systèmes de tarification du carbone industriel du Canada s’appliquent aux grands émetteurs. Contrairement à l’autre politique de tarification du carbone, ces systèmes se font discrets; plusieurs aspects importants les différencient de la taxe sur les carburants.
Premièrement, les systèmes de tarification du carbone industriel du pays (il en existe plusieurs, adaptés au contexte particulier de chaque province) se distinguent de la taxe sur les carburants du fait qu’ils reposent sur un marché de crédits. Souvent appelés « systèmes d’échange pour les grands émetteurs », ils remettent aux grands émetteurs qui réduisent considérablement leurs émissions des crédits qu’ils peuvent vendre sur ce marché. Non seulement celui-ci offre de puissants incitatifs à la réduction des émissions, mais les crédits projetés peuvent attirer des investissements au Canada dans le cadre de projets sobres en carbone.
Deuxièmement, les systèmes d’échange pour les grands émetteurs sont conçus pour préserver la compétitivité des entreprises, même en face de concurrents qui ne sont soumis à aucune tarification du carbone. Contrairement aux entreprises et particuliers visés par la taxe sur les carburants, les grands émetteurs ne paient que pour les émissions dépassant un seuil donné. Par conséquent, ces systèmes coûtent beaucoup moins cher aux entreprises et, lorsqu’ils fonctionnent comme prévu, incitent fortement ces dernières à réduire la pollution; c’est particulièrement important dans un contexte où les potentiels tarifs douaniers de l’administration Trump menacent leur rentabilité.
Bref, les systèmes d’échange pour les grands émetteurs incitent les entreprises canadiennes à réduire leurs émissions sans les obliger à ralentir leurs activités.
Troisièmement, les systèmes d’échange pour les grands émetteurs ne font généralement pas augmenter les prix des produits de consommation. Cela s’explique en partie par le fait que les coûts du carbone restant bas, comme expliqué ci-dessus, les entreprises n’ont pas de frais élevés à refiler aux acheteurs. De plus, ces systèmes visent surtout les entreprises actives dans les marchés mondiaux (l’électricité étant la principale exception). Le prix de l’acier et des scories de ciment n’est pas établi par les politiques locales, mais plutôt par les marchés internationaux. Les entreprises soumises à la tarification du carbone industriel ne peuvent donc pas transférer les coûts aux consommateurs et aux ménages canadiens. (Lorsqu’inefficaces, les systèmes d’échange peuvent affecter les bénéfices des actionnaires ou les salaires de la main-d’œuvre, mais, comme souligné précédemment, ils sont explicitement conçus pour réduire les coûts pour les entreprises et donc éviter de telles conséquences.)
Quatrièmement – et surtout –, quand ils fonctionnent bien, les systèmes d’échange représentent la politique climatique canadienne la plus efficace. Selon notre analyse, d’ici 2030, ils entraîneront une réduction des émissions environ trois fois plus importante que celle issue de la taxe sur les carburants.
Enfin, les systèmes d’échange pour les grands émetteurs sont en grande partie définis par les provinces et territoires, qui peuvent ainsi prendre les décisions les plus bénéfiques pour leur population. Si la majorité d’entre eux sont maintenant assujettis à la taxe fédérale sur les carburants, ils ont aussi leurs propres systèmes d’échange. Tout en respectant les seuils établis par le gouvernement fédéral pour assurer une certaine harmonisation des mécanismes à l’échelle nationale, ils peuvent adapter leurs systèmes régionaux à leurs priorités et à leur contexte, ce que la plupart d’entre eux ont fait. En fait, c’est l’Alberta qui est à l’origine des principes des systèmes d’échange pour les grands émetteurs, et le règlement TIER (Technology Innovation and Emissions Reduction) de cette province encadre le plus grand marché du carbone au Canada.
Comme toute autre politique, les systèmes d’échange pour les grands émetteurs du Canada peuvent être améliorés. Cependant, ces systèmes régis par les provinces sont le fer de lance des politiques climatiques canadiennes actuelles : on prévoit qu’ensemble, ils constitueront le plus grand moteur de réduction des émissions pour les cinq prochaines années, soit d’ici 2030. Ils sont essentiels pour préserver la compétitivité des entreprises tout en réduisant les émissions industrielles. Ils s’accompagnent de leurs propres mécanismes, coûts et avantages, distincts de ceux de la taxe sur les carburants, et ne doivent donc pas être confondus avec cette dernière.