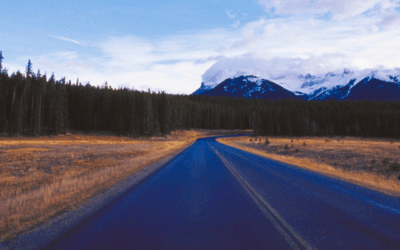Les centres de données prolifèrent sur fond du boom de l’intelligence artificielle, et les provinces canadiennes se précipitent pour profiter de cette manne économique et sécuritaire.
Mais qu’en est-il des émissions de gaz à effet de serre et des répercussions sur l’avenir de l’énergie propre au pays?
D’un côté, il y a des avantages : les centres de données ont des retombées économiques, et l’approvisionnement en électricité propre peut attirer des capitaux pour en établir plus, créant ainsi un cercle vertueux. Les nouveaux centres pourraient aussi stimuler l’investissement dans les infrastructures et accélérer l’expansion du réseau électrique des provinces – un pas dans la bonne direction pour concrétiser le système électrique plus vaste, plus propre et plus intelligent qui est nécessaire à la décarbonisation de l’économie canadienne.
De l’autre côté, l’électricité n’est plus surabondante comme elle l’a déjà été, et les centres de données sont gourmands en énergie alors que l’on ne peut prédire la demande à venir. Si l’on ne fait pas attention, les nouveaux centres pourraient exacerber les problèmes d’abordabilité et de fiabilité de l’approvisionnement électrique, et venir compliquer notre décarbonisation.
Il en ressort que les orientations politiques que se donnent les provinces sont d’une importance critique pour peser le pour et le contre et déterminer si les centres de données vont favoriser la décarbonisation ou lui nuire.
Les gouvernements canadiens jouent de l’électricité propre pour courtiser les promoteurs de centres de données
Prenons un instant pour nous mettre en contexte.
Les centres de données ne sont pas une nouvelle réalité au Canada : il y en a déjà 239 en activité à l’échelle du pays. Mais l’intérêt se porte désormais sur l’IA, et celle-ci requiert des centres à bien plus grand déploiement que les installations traditionnelles.
Les gouvernements fédéral et provinciaux mettent les bouchées doubles pour attirer ces projets, motivés par les retombées économiques ainsi que par des considérations de sécurité technologique et de souveraineté des données. Les dépenses d’investissement potentielles sont massives – en 2023, Google, Microsoft et Amazon ont mis plus d’argent dans les centres de données qu’il en a été investi dans la totalité du secteur pétrogazier aux États-Unis, soit l’équivalent de 0,5 % du PIB américain –, et le reste du secteur privé pourrait profiter d’avantages connexes comme la bonification de l’infrastructure numérique et de l’écosystème technologique local.
Les centres de données ont besoin de diverses ressources (eau, infrastructures numériques, capital humain, expertise technique), mais surtout d’électricité, notamment pour leur refroidissement. Le Canada possède ici un atout sur le plan de l’efficacité énergétique, à savoir son climat froid, auquel s’ajoute son autre avantage concurrentiel : un approvisionnement fiable et économique en électricité issue à 85 % de sources renouvelables et non émettrices.
Les provinces qui cherchent à attirer des centres de données misent sur ce dernier avantage.
Par exemple, les services publics de la Colombie-Britannique et du Québec ont comme argument de vente auprès des promoteurs leur électricité renouvelable à des tarifs parmi les plus bas en Amérique du Nord. En 2022, BC Hydro a introduit un tarif réduit à titre exceptionnel pour les centres de données, et l’incitatif a si bien fonctionné que le programme affichait complet en 2023. Du côté du Québec, une opération séduction antérieure a réussi à convaincre les géants de la technologie que sont Amazon Web Services, Google, Microsoft et IBM de venir établir (ou élargir) des centres de données massifs dans la Belle Province, mais l’épuisement des surplus d’électricité a mis le frein à d’autres campagnes du genre.
L’Alberta, elle, fait principalement miroiter aux entreprises la recrudescence imminente des ressources en électricité avec l’entrée en service prochaine de nouvelles installations de production (gaz naturel et énergies renouvelables), en plus de la dérégulation de son marché de l’électricité – qui laisse présager une expansion rapide de l’offre dans des conditions favorables.
La consommation d’électricité des centres de données monte en flèche – et la demande à venir est difficilement prévisible
Trouver un bassin d’approvisionnement en énergie, c’est une chose, mais encore faut-il que le réseau électrique puisse physiquement accueillir l’installation. Les nouveaux centres de données pour l’IA monopolisent beaucoup plus d’électricité que leurs pendants traditionnels. Si ces derniers consomment typiquement de 5 à 10 mégawatts (MW) d’électricité, ce chiffre peut facilement excéder les 100 MW pour une installation d’IA moderne, ce qui équivaut à peu près à la consommation annuelle de 350 000 véhicules électriques.
Même si l’énergie est disponible, ce n’est pas n’importe quelle ligne électrique qui peut canaliser une telle charge en un même point. Ainsi, il est plus difficile qu’il n’y paraît de trouver un endroit où s’établir. La liste d’attente peut atteindre les sept ans dans les endroits courus comme en Virginie, la nouvelle Silicon Valley des centres de données.
Très énergivores, les centres de données pour l’IA font grimper la demande en électricité. L’Agence internationale de l’énergie estime qu’à l’échelle planétaire, la consommation d’énergie des centres de données va doubler entre 2022 et 2026. Même genre d’expansion pour le marché des centres de données au Canada, qui devrait passer d’une capacité actuelle de 750 MW à environ 1,16 gigawatt (GW) d’ici 2029.
Provincialement, l’exploitant du réseau de l’Ontario estime que les centres de données représenteront 13 % de la nouvelle demande à l’horizon 2035, tandis qu’Hydro Québec les voit dans son plan d’approvisionnement de 2023 comme le plus gros poste à s’ajouter à ses états provisionnels pour les 10 prochaines années. Pour sa part, en date de mars 2025, l’Alberta comptait plus de 10 GW de projets de centres de données dans son pipeline d’interconnexions.
Même si tous les projets ne vont pas se concrétiser, il demeure que la demande en électricité pour les centres de données va augmenter. Sauf qu’il est compliqué de déterminer la courbe et la chronologie exactes que suivra cette demande croissante.
En premier lieu parce que l’infrastructure électrique prend normalement des décennies à planifier et à construire. La demande a beau être là, maintenant, pour les centres d’IA, mais les perspectives sont loin d’être fixées au-delà de 2030.
C’est principalement parce que le rythme de croissance de la demande pour les services d’IA ainsi que la vitesse et l’ampleur des gains d’efficacité énergétique sont de grandes inconnues. L’amélioration de l’efficacité dépend des avancées technologiques, qui sont elles-mêmes difficiles à prévoir. Qui sait quand elles surviendront, et à quel point elles seront transformatrices?
Une chose est sûre : les centres de données pour l’IA ont rajouté une bonne dose d’incertitude aux projections et à la planification de la demande future en électricité.
Satisfaire la demande des centres de données pourrait faire pression sur les tarifs d’électricité
Qu’en est-il de l’abordabilité de l’électricité? L’ajout de centres de données peut soit contribuer à réduire les tarifs pour les autres usagers, soit les faire grimper pour tout le monde. Tout dépend de la capacité du réseau à gérer leur demande forte et continue en énergie ainsi que de la division du coût des infrastructures supplémentaires entre les clients.
Dans certains cas, les centres de données peuvent contribuer à réduire le coût unitaire de l’électricité, ou du moins à compenser les hausses majeures. C’est ce qui s’est passé entre autres en Californie, où s’opèrent un virage vers le renouvelable ainsi qu’une modernisation des infrastructures par les services publics. Dans les faits, les centres ont pu faire baisser le coût unitaire de l’électricité : leur besoin élevé et constant en énergie contribuait à couvrir les dépenses fixes du réseau, et à répartir ces coûts sur une consommation totale plus importante.
Mais tous les réseaux ne sont pas pareils, et ailleurs, les centres de données pourraient faire grimper les prix. Pensons aux provinces comme la Colombie-Britannique et le Québec, qui sont largement alimentées par des installations hydroélectriques en place depuis des décennies. Cela signifie que le réseau a amorti le gros de ses coûts depuis longtemps, et qu’il roule sa bosse depuis à un coût relativement bas. Mais celui-ci étant de plus en plus sollicité avec la croissance démographique et l’accélération de la transition énergétique, le surplus d’électricité s’amenuise. L’ajout de nouvelles infrastructures pour répondre à la demande des centres de données implique des dépenses d’investissement importantes, qui devront progressivement être remboursées. Si cela se produit, le coût unitaire de l’électricité va probablement augmenter, et alourdir du coup la facture des usagers.
Il y a moyen d’éviter de refiler la note au reste de la clientèle. Certaines régions prennent des mesures pour s’assurer que les grands consommateurs d’électricité, comme les centres de données, paient une proportion accrue des nouveaux coûts d’infrastructure et assument une plus grande part du risque que la demande pour leurs services change. Les nouveaux systèmes de tarification établis en Indiana en sont un exemple. Les centres de données peuvent aussi faire leur part pour réduire les coûts (et donc les tarifs d’électricité) en faisant preuve de flexibilité lors des pics de demande. Par exemple, Microsoft au Québec a accepté de réduire sa consommation de 30 % aux heures de pointe afin de réduire la pression sur le réseau.
Alimenter les centres de données en combustibles fossiles fera gonfler les émissions
La course à la construction de centres de données et à leur approvisionnement en énergie soulève également des inquiétudes pour le virage vers l’énergie propre. En Alberta, si les centres de données planifiés s’alimentent auprès des centrales au gaz naturel, les émissions du réseau électrique de la province se multiplieraient virtuellement par deux. Cela aurait pour effet d’effacer les économies d’émissions que la province a réalisées ces dernières années en tournant le dos au charbon. Même constat préoccupant ailleurs, où l’on se précipite au point de proposer le maintien en activité des centrales au gaz et au charbon existantes.
Le renouvelable demeure la filière la plus économique et rapide à déployer pour la nouvelle production d’énergie, mais les problèmes de permis et d’infrastructure ralentissent son expansion. Les entreprises technologiques aux États-Unis ont déjà commencé à s’adjoindre des fournisseurs dans le renouvelable afin de se garantir une source d’énergie propre; il pourrait être gagnant d’en faire de même dans certaines régions du Canada. Déjà, l’Alberta permet aux entreprises de conclure des accords d’achat d’énergie au privé avec des producteurs d’électricité de source renouvelable. Les centres de données qui concluent un accord direct comme ceci se trouvent à réduire leur empreinte carbone et à se protéger contre la volatilité des prix, tandis que leurs partenaires du renouvelable y gagnent en sécurité financière pour investir dans l’expansion de leur capacité.
Les provinces devraient paver la voie à des choix judicieux en ce qui concerne les centres de données et la transition énergétique
Comment savoir, au bout du compte, de quel côté penche le bilan bonus-malus des nouveaux centres de données massifs? Cela dépend de leurs retombées économiques globales; de s’ils favorisent l’utilisation efficace de l’infrastructure électrique existante ou s’ils nécessitent de nouveaux investissements; et des potentiels usages concurrents de l’infrastructure électrique disponible. Mais surtout, cela dépend des choix d’orientation politique des provinces.
Les provinces devront faire des compromis difficiles dans le développement de leur réseau électrique. À l’heure actuelle, à peu près aucun opérateur de réseau au pays ne fait une analyse des coûts-bénéfices relatifs pour déterminer s’il admet un nouveau client. En l’absence d’encadrement ou de directives additionnels, les sociétés qui ont le monopole public des services d’électricité doivent accepter le raccordement de tous les clients sur leur territoire qui en font la demande, tant que la chose est réaliste et sécuritaire. Dans un souci d’équité, les demandes sont traitées selon le principe du premier arrivé, premier servi.
Le Québec est pour l’heure la seule province dotée d’un cadre gouvernemental permettant de discriminer les demandes des nouveaux clients de grande envergure. Fait intéressant : depuis l’instauration de ce cadre en 2023, aucun nouveau projet de centre de données n’a été admis.
Compte tenu de tous les facteurs que nous avons vus et de l’évolution rapide du marché des centres de données pour l’IA, il faut des cadres stratégiques clairs pour guider les services publics canadiens dans leurs décisions concernant les demandes concurrentes à l’échelle industrielle afin d’assurer que les choix immédiats concordent avec les objectifs suprêmes.
Il est tout aussi crucial que les provinces élaborent des plans énergétiques qui leur serviront de feuille de route à long terme. Ces plans devraient prendre en considération et évaluer les possibilités de croissance économique, et établir des orientations en ce qui concerne l’abordabilité de l’électricité, la fiabilité du réseau et la réduction des émissions.
Les décideurs pourront ainsi juger du rythme et de l’ampleur que devrait prendre l’expansion des infrastructures. L’heure n’est plus aux demi-mesures, car les risques – de causer la hausse des tarifs, de faire augmenter les émissions et de laisser filer des occasions économiques – sont bien réels.