Atténuation
Comment le Canada peut-il réduire ses émissions?

Le budget 2024 continuera à faire avancer les progrès en matière de lutte aux changements climatiques de manière à stimuler la croissance et la compétitivité économique tout en maintenant l'énergie à un prix abordable.






Comment le Canada peut-il réduire ses émissions?
Comment le Canada peut-il s’adapter à un climat en mutation?
Comment le Canada peut-il réussir sa transition vers une économie mondiale sobre en carbone?

Arrimer le secteur pétrogazier à la transition vers la carboneutralité.




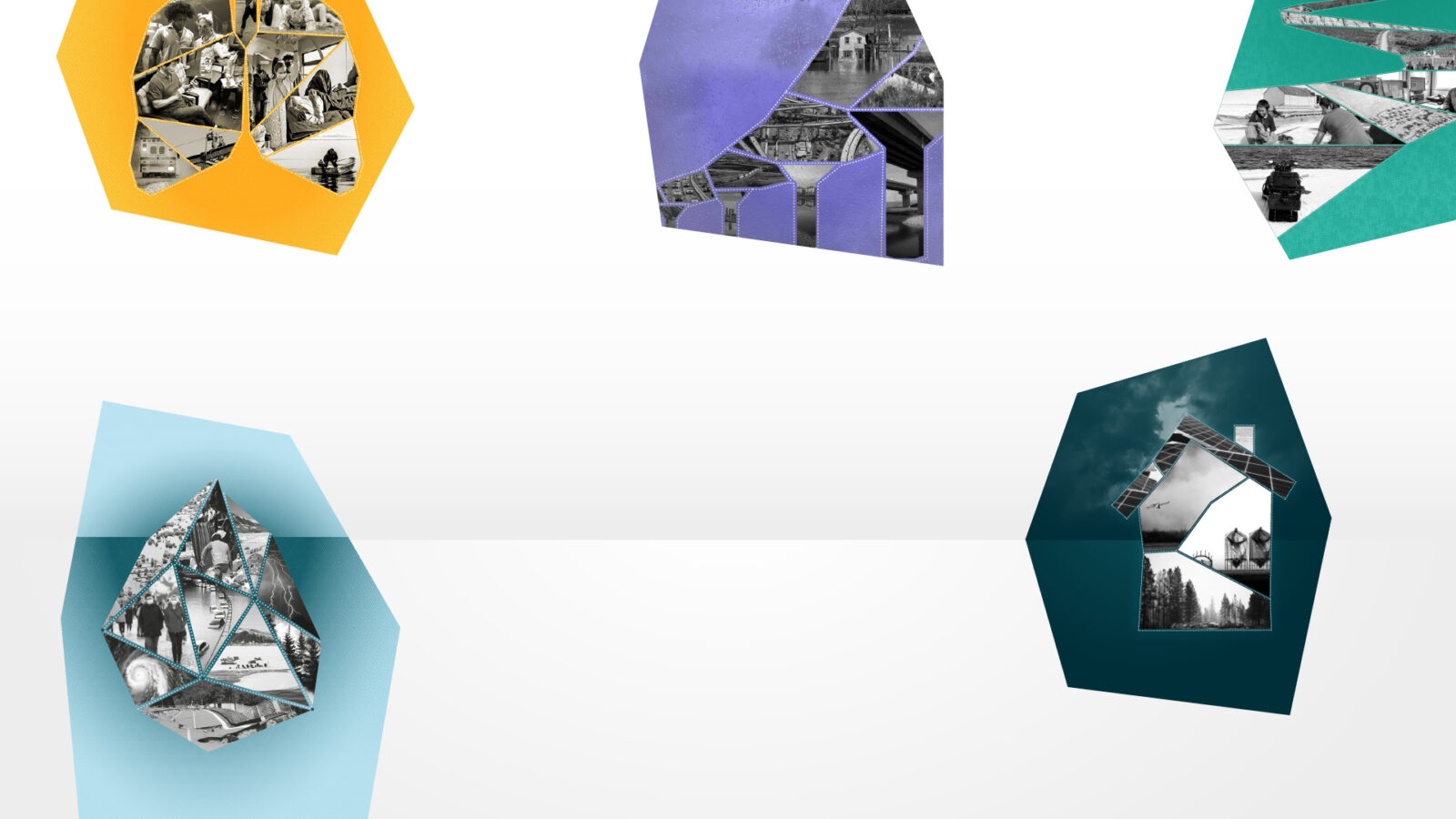
Cette série cherche à mieux comprendre les coûts liés aux dommages climatiques et les pistes d’action qui s’offrent à nous.

Comment le Canada peut-il atteindre la carboneutralité d'ici 2050? Nous avons analysé plus de 60 scénarios à travers lesquels nous avons identifié des valeurs sûres et des paris risqués.